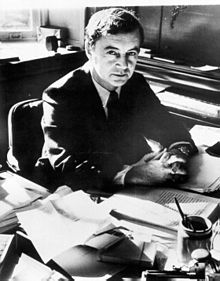Interactionnisme et Constructivisme
| Faculté | Faculté des sciences de la société |
|---|---|
| Département | Département de science politique et relations internationales |
| Professeur(s) | Rémi Baudoui |
| Cours | Introduction à la science politique |
Lectures
- Les approches en sciences politiques de Durkheim à Bourdieu
- Aux origines de la chute de la République de Weimar
- Les approches en science-politique : Max Weber et Vilfredo Pareto
- La notion de « concept » en sciences-sociales
- Marxisme et Structuralisme
- Fonctionnalisme et Systémisme
- Interactionnisme et Constructivisme
- Intérêts
- Institutions
- Idées
- Les théories de l’anthropologie politique
- La Guerre
- La Guerre : conceptions et évolutions
- La raison d’État
- État, souveraineté, mondialisation, gouvernance multiniveaux
- La Violence
- Welfare State et biopouvoir
- Institutions politiques I : Régimes politiques, démocratisation
- Institutions politiques II : systèmes électoraux
- Institutions politiques III : Gouvernements – Parlements
- Morphologie des contestations
- Régimes politiques, démocratisation
- L’action dans la théorie politique
- Introduction à la politique suisse
- Analyse des Politiques Publiques : définition et cycle d'une politique publique
- Analyse des Politiques Publiques : mise à l'agenda et formulation
- Analyse des Politiques Publiques : mise en œuvre et évaluation
- Introduction à la sous-discipline des relations internationales
- Introduction à la théorie politique
L'interactionnisme et le constructivisme sont deux cadres théoriques clés qui enrichissent notre compréhension des dynamiques en science politique.
L'interactionnisme est une théorie qui met l'accent sur les relations entre les individus pour décrypter les comportements politiques. Elle postule que les individus ne sont pas simplement le produit de leur environnement ou des structures sociales, mais qu'ils ont un rôle actif dans la formation et la transformation de ces structures par leurs interactions. Dans un contexte politique, l'interactionnisme peut aider à analyser comment les politiciens, les bureaucrates et les électeurs interagissent, et comment ces interactions déterminent les politiques publiques et les résultats électoraux.
D'autre part, le constructivisme se focalise sur la manière dont les acteurs politiques utilisent leurs idées et croyances pour construire leur réalité sociale et politique. Selon cette approche, les structures politiques et sociales ne sont pas préétablies, mais sont plutôt construites par les acteurs politiques à travers leurs discours, leurs idées et leurs actions. Le constructivisme, dans le domaine de la science politique, permet d'explorer comment les croyances et les idées des acteurs politiques façonnent les structures politiques et les politiques publiques.
Ces deux cadres théoriques peuvent être utilisés conjointement pour une compréhension plus approfondie de la politique. Par exemple, l'interactionnisme peut être utilisé pour examiner comment les acteurs politiques collaborent pour élaborer des politiques, tandis que le constructivisme peut permettre d'analyser comment ces politiques sont influencées par les idées et les croyances de ces acteurs.
Les approches Interactionnisme et Constructivisme
L'interactionnisme et le constructivisme sont deux cadres théoriques essentiels qui ont émergé à partir de contextes de production distincts et ont façonné notre compréhension des processus sociaux et politiques.
L'Interactionnisme
L'interactionnisme, notamment l'interactionnisme symbolique, a ses racines dans l'École de Chicago au début du XXe siècle. Les changements rapides et massifs que la ville de Chicago a connus à cette époque ont servi de toile de fond pour le développement de cette approche théorique.
Chicago est passée d'une petite ville à une métropole florissante en quelques décennies seulement, avec une population qui a explosé en raison de l'immigration et de la migration interne. Cela a entraîné de profonds changements dans la structure sociale et spatiale de la ville. Les nouveaux arrivants de différentes origines ethniques et culturelles se sont installés dans des quartiers distincts, créant une mosaïque de communautés culturelles dans la ville. Face à ces changements, les sociologues de l'École de Chicago ont cherché à comprendre comment les individus et les groupes interagissent dans ces nouveaux environnements urbains. Ils ont commencé à développer des théories interactionnistes qui mettaient l'accent sur le rôle des interactions sociales dans la formation de l'identité individuelle et collective, la construction des communautés, et la création de l'ordre social. Les sociologues de l'École de Chicago, tels que Robert E. Park, Ernest Burgess et Herbert Blumer, ont joué un rôle crucial dans le développement de l'interactionnisme. Ils ont mis l'accent sur l'observation directe des interactions sociales et ont utilisé des méthodes de recherche innovantes, comme l'étude ethnographique et l'observation participante, pour étudier les interactions sociales dans la métropole en pleine mutation.
L'interactionnisme est donc né de l'effort pour comprendre les transformations sociales et spatiales en cours dans une métropole en pleine mutation. Il continue à être une approche théorique clé en sociologie et en science politique, aidant à expliquer comment les interactions sociales façonnent les individus, les groupes, et la société dans son ensemble.
Les sociologues de l'École de Chicago ont été parmi les premiers à s'attaquer de front à ces défis complexes et interdépendants. Leurs travaux ont mis en évidence les difficultés d'intégration sociale, professionnelle et culturelle auxquelles étaient confrontés les nouveaux arrivants dans la ville. Ils ont observé comment ces défis ont conduit à une ethnicisation de la ville, où les différents groupes ethniques se sont installés dans des quartiers distincts, créant une "mosaïque ethnique" complexe. Ils ont également étudié l'émergence de la marginalité sociale, y compris la criminalité et la délinquance, dans ce contexte urbain en mutation. Les phénomènes de marginalité et de déviance sociale, tels que les gangs et la criminalité organisée, étaient des préoccupations majeures pour ces sociologues. Ils ont cherché à comprendre pourquoi certains individus et groupes choisissent de s'engager dans des activités illégales et comment ces choix sont façonnés par leur environnement social et économique. Le travail de l'École de Chicago sur la déviance sociale a été particulièrement influent. Des chercheurs tels que Clifford R. Shaw et Henry D. McKay ont développé la théorie de la désorganisation sociale, qui suggère que la criminalité est principalement le résultat de la désintégration des institutions sociales traditionnelles dans les zones urbaines défavorisées. Cette théorie a profondément influencé la façon dont nous comprenons la criminalité et la déviance aujourd'hui. Les sociologues de l'École de Chicago ont été des pionniers dans l'étude des phénomènes urbains et des problèmes sociaux associés à l'urbanisation rapide et à l'industrialisation. Leur approche interactionniste a ouvert la voie à une compréhension plus nuancée de la façon dont les individus et les groupes interagissent avec leur environnement social et comment ces interactions façonnent leurs expériences et comportements.
L'interactionnisme, tel qu'il a été conceptualisé par l'École de Chicago, place l'interaction au cœur de l'expérience sociale. Cette approche met l'accent sur l'idée que les comportements individuels sont façonnés par les interactions et les échanges avec les autres. En d'autres termes, les individus n'agissent pas isolément, mais sont constamment engagés dans un processus d'interaction avec ceux qui les entourent. Dans cette perspective, la société n'est pas simplement un ensemble de structures rigides qui déterminent le comportement des individus, mais un réseau dynamique d'interactions sociales. Les individus ne sont pas de simples récepteurs passifs de normes sociales, mais jouent un rôle actif dans la création et la modification de ces normes à travers leurs interactions. Cela signifie que pour comprendre les comportements des individus, nous devons examiner la nature des interactions dans lesquelles ils sont engagés. Par exemple, comment les individus interagissent-ils dans différents contextes, comme la famille, le travail, l'école, etc. ? Comment ces interactions influencent-elles leurs croyances, leurs attitudes et leurs comportements ? Et comment ces interactions contribuent-elles à la création et à la transformation des structures sociales ? De plus, l'interactionnisme fait valoir que toutes les relations humaines impliquent une forme d'échange ou d'interaction, qu'elle soit verbale ou non verbale, formelle ou informelle, positive ou négative. Par conséquent, l'interactionnisme offre un cadre précieux pour l'étude des phénomènes sociaux, allant des interactions quotidiennes entre individus aux processus plus larges de changement social et politique.
L'interactionnisme souligne que le comportement d'un individu est profondément influencé par ses interactions avec les autres, et qu'il n'existe pas isolément de son contexte social. Cette perspective met en évidence le fait que le comportement n'est jamais statique ou constant, mais qu'il est toujours en cours de transformation à travers les interactions sociales. C'est en cela que l'interactionnisme se distingue de la théorie fonctionnaliste. Le fonctionnalisme, en se concentrant sur la manière dont les différentes parties de la société travaillent ensemble pour maintenir l'équilibre et l'harmonie, tend à voir les comportements individuels comme étant largement déterminés par le rôle fonctionnel qu'ils jouent dans la société. Cette perspective peut parfois être critiquée pour son manque de considération pour les dynamiques de pouvoir, les conflits et le changement social. Au contraire, l'interactionnisme souligne la manière dont les individus négocient, interprètent et contestent leurs rôles sociaux à travers leurs interactions avec les autres. Il met l'accent sur la complexité et la dynamique des comportements humains, plutôt que sur leur conformité à des normes fonctionnelles prédéterminées. De plus, l'interactionnisme voit la société non pas comme une structure figée, mais comme un processus en constante évolution façonné par les interactions humaines. Ainsi, l'interactionnisme offre une perspective plus nuancée et dynamique des comportements humains et de la société. Il met en évidence le rôle actif des individus dans la création et la transformation de leur réalité sociale, et la manière dont les comportements sont façonnés par les interactions et les échanges avec les autres.
Il y a quatre principes dans l’interaction :
- Unités d'interaction : L'interactionnisme reconnaît que les interactions peuvent se produire entre des individus (interaction interpersonnelle) ou des groupes (interaction de groupe). Ces unités d'interaction sont les acteurs de base de la société.
- Règles d'interaction : Les interactions sont régies par des règles, qui peuvent être explicites (comme les lois ou les règlements) ou implicites (comme les normes sociales non écrites). Ces règles aident à structurer les interactions et à donner un sens aux comportements.
- Processus ordonné : L'interactionnisme voit les interactions sociales comme un processus ordonné. Cela signifie que les interactions suivent certaines séquences et motifs, qui peuvent être analysés et compris. Par exemple, l'interactionnisme a été utilisé pour étudier des phénomènes tels que la violence, en les situant dans leur contexte d'interaction spécifique.
- Échange : L'interactionnisme met l'accent sur l'idée que les interactions sociales sont fondamentalement basées sur l'échange. Cela peut être un échange de biens ou de services, mais aussi d'informations, de sentiments, d'idées, etc. Cela souligne le caractère réciproque et mutuellement influençant des interactions sociales.
Ces principes fournissent un cadre pour comprendre comment les individus et les groupes interagissent les uns avec les autres, comment ces interactions sont structurées et régulées, et comment elles contribuent à la création et au changement social.
Le Constructivisme
Le Constructivisme, quant à lui, se développe dans les années 1960-1970 dans les domaines de la sociologie, la philosophie et l’anthropologie, mais aussi de la linguistique. Un des auteurs de la linguistique va être Jean Piaget à Genève qui développe une théorie du langage comme espace construit.
L’hypothèse de base c’est le fait que toute connaissance possède un caractère construit et construisant. La connaissance n’est pas fragmentée, elle participe à la construction de la connaissance, dès lors, on est dans un processus de construction parce que cela construit, c’est construisant, c’est-à-dire que cela va permettre de construire la réalité.
Dans la théorie constructiviste, la réalité n’est pas ce que l’on observe, elle serait un objet construit par les sciences, les normes et les règles. Afin de comprendre la réalité, qui est un construit social et normatif, il faut développer un système scientifique de la construction. Pour cela, il faut pouvoir comprendre le système scientifique par lequel la réalité s’est construite. Alors, toute connaissance construit un monde, la réalité dans laquelle nous vivons est construite et possède un caractère subjectif.
En d’autres termes, la réalité procède en une construction, la seule façon d’accéder à la connaissance est de scientifiquement de travailler sur la construction de la construiront, c’est la construction de deuxième niveau cela signifie que si nous voulons comprendre la réalité construite dans laquelle nous sommes il faut développer un appareillage scientifique qui permet comprendre la réalité construite. L’hypothèse fondamentale du constructivisme sous-jacent est qu’au fond toute société développe des systèmes de perception du monde. Les sociétés ne développent pas directement une réalité, mais elle interprète le monde selon des réalités construites.
Les constructivistes disent que la réalité construite se fait sur une longue période et font aussi intervenir des acteurs multiples, c’est un ensemble d’acteurs dans une société donnée qui la construise. Ces théories interrogent la société et non pas l’individu. Ces réalités construites possèdent une dimension structurante de la pensée. Si à un moment donné nous sommes dans une réalité construite, les pouvoirs coercitifs de la construction politique forcent à se conformer à réalité construite.
Ces réalités structurent la pensée au même titre que les appréhensions cognitives de chacun. On distingue deux dimensions importantes :
- le constructivisme va s’interroger à la dimension comparative des réalités construites : si les sociétés fabriquent de la réalité construite ce qui est intéressant est d’arriver à les comparer et quelles sont les différentes réalités en jeu qui mettent en place des structurations différentes et des conflictualités possibles.
- le grand domaine de l’analyse constructiviste est les relations internationales parce qu’elles vont pouvoir mettre en valeur des systèmes territoriaux, spatiaux ou cultures, des réalités construites différentes et donc des conflictualités.
La théorie constructiviste nous amène à penser l’espace comme en sommes des réalités construites les unes par rapport aux autres.
Rappelons que la théorie interactionniste critique le fonctionnalisme, car on ne raisonnant que par fonction, on évacue la question de l’individu puisque l’interactionnisme met en place fondamentalement les interactions des individus dans des systèmes sociaux et politiques.
La théorie constructive va d’abord être critique du structuralisme parce qu’en considèrent que c’est une vision très figée de la perception du développement des sociétés, le constructivisme va dire qu’on oublie les questions d’agencement de la réalité, mais elle va aussi critiquer le systémisme, car elle est beaucoup plus dans l’analyse singulière de cas spécifiques. Dans les relations internationales, on va analyser dans le cadre du constructivisme certaines situations spécifiques. On est véritablement dans quelque chose qui rompt avec le structuralisme, le fonctionnalisme et le systémisme.
La théorie interactionniste
Aux origines : l’École de Chicago
Au début du XXème siècle, Chicago passe de la ville à la métropole avec un afflux massif d’immigrants étrangers qui engendre des conflits raciaux, la mise en place de ghettos, de la misère, de la prostitution, de la délinquance juvénile. Vont également avoir lieu de violentes émeutes raciales.
C’est une sociologie très nouvelle parce que nous n’avions pas au début du XXème une sociologie de la déviance qui était située du côté des juristes et de la répression. Au fond, la nouveauté est de s’interroger sur des configurations sociales et de marginalité qui vont révolutionner le champ de la connaissance en sociologie notamment par le fait que l’on va se rendre compte qu’il y a des rationalités qui passent aussi par la question interactionniste.
C’est une tentative de comprendre et régler les problèmes sociaux à partir de la vie des populations déracinées.
Les thèmes majeurs sont les minorités raciales et ethniques, l’homme marginal, la ville, la déviance ou encore le crime et délinquance
L’étude des minorités montre que les systèmes d’interactions sont très forts parce que ce sont des systèmes de défense et de protection. La sociologie de l’École de Chicago va étudier toutes ces questions et montrer qu’il y a des systèmes d’action, de solidarité dans des logiques interactionnelles et qui sont de véritables modes de fonctionnements collectifs.
Parmi les mots clefs de l’interactionnisme, on trouve :
- socialisation : ensemble des mécanismes par lesquelles les individus font l’apprentissage des rapports sociaux entre les hommes.
- interactionnisme symbolique : l’idée que les individus ne subissent pas les faits sociaux, mais qu’ils les produisent par leur interaction. C’est une interprétation très dynamique, les individus sont acteurs du champ social, mais ne sont pas nécessairement soumis au champ social, ils le produisent eux-mêmes par leur interaction.
- observation participante : l’enquêteur à s’impliquer dans le groupe qu’il étudie.
- darwinisme social : le darwinisme se base sur la théorie de la sélection naturelle de Darwin pour décrire le comportement des individus en société.
- fonctionnalisme : théorie qui considère le système social comme une totalité unifiée dont tous les éléments sont nécessaires à son bon fonctionnement.
- ethnométhodologie : démarche sociologique centrant son intérêt sur le savoir et les capacités de chacun des membres de la société.
- écologie urbaine : les sociologues tentent d’expliquer la perpétuelle recomposition à laquelle est soumise la ville de Chicago.
- désorganisation : déclin de l’influence des valeurs collectives sur l’individu ; conséquence de changements rapides dans l’environnement économique.
Erwin Goffman (1922-1982) : la mise en scène de la vie quotidienne
Goffman va publier tout un travail très important après avoir étudié la sociologie à Toronto et à l’Université de Chicago, mais qui a aussi enseigné à Berkeley et à Philadelphie. Il va travailler sur la question de la maladie et des phénomènes sociaux ainsi que sur l’hôpital psychiatrique afin d’étudier l’interactionnisme qui se construit soit d’un côté avec la puissance médicale soit avec les autres malades. Son hypothèses est publiée dans son ouvrage ‘’La mise en scène de la vie quotidienne’’ est que tout individu est un comédien, nous sommes tous des comédiens qui sont des acteurs de comédies et en représentation théâtrale, à chaque instant nous devons exposer notre personnage à travers un cérémoniel et avec des techniques de représentation.
Le constructivisme selon Goffman est que nous nous mettons tous dans des positions de construction en tant qu’être subjectif et en tant qu’être social. Lui-même va reprendre la question de la réalité en disant que toute réalité possède deux sens :
- les représentations de la réalité : on se représente la réalité
- la réalité des représentations : à partir du moment où on fabrique un domaine collectif de représentation, ces représentions acquièrent une réalité active.On a fabriqué des représentations de la réalité qui finalement deviennent acceptées. Cela signifie qu’en tant qu’individu nous travaillons avec des représentations.
Il s’interroge sur l’importance de l’espace public. Pour Goffman, l’espace public et une scène de théâtre. L’individu y est conçu comme un comédien accomplissant des actes de représentations théâtrales devant son public. Le rôle du spectateur est étendu à toute personne dans une activité quotidienne.
Pour Goffman, il y existe trois aptitudes dans lesquelles se joue la réalité qui sont la coopération (1), l’engagement (2) et l'absorption (3).
L’espace public signifie que nous sommes à la fois spectateurs et acteurs : à la fois, nous les fabriquons et à la fois elles sont inscrites dans des réalités construites. Il a des interactions qui vont être de l’ordre culturel.
Selon Goffman, ces systèmes d’interactions s’investissent par la parole, car elle est fondamentale dans l’interaction et par le corps, c’est-à-dire dans les mouvements du corps et sa capacité d’adaptation. Nous sommes dans un champ d’interactions, de gestualité du corps et du langage qui permettent de définir des pluralités de situations dans lesquelles on fabrique collectivement des dispositifs de reconnaissance d’action et de développement.
L’interactionnisme symbolique
Goffman va dire que l’espace public favorise la construction de la théorie de l’évitement. La stratégie d’évitement est quand on sent la menace ; la menace peut être aussi complètement de l’ordre de la représentation qui renvoie à la réalité construite. Cependant, il existe aussi de nombreuses autres stratégies d’évitements.
Ce que l’on observe dans le champ sociologique et qui est important dans le champ politique est que le principe d’interaction est aussi dans le champ du politique qui fonctionne aussi par de l’interaction.
La pensée interactionniste est intéressante parce qu’elle montre que sur le plan politique on est bien dans un domaine ou des situations se négocient. Cela veut dire que quand on va travailler d’un point de vue interactionniste sur le champ du politique on va travailler sur un espace de débat et pas sur quelque chose de clos.
Tous les individus suivent des rites d’interaction ; il va donner trois situations qui mettent à mal le rituel interactif. Souvent, l’interaction est ritualisée, elle ne le relève pas de spontanéité. Goffman identifie des rites de rupture avec l’autorité classique qui dérègle l’ordre rituel :
- l’offense et la réparation : on peut échapper à l’interaction à cause d’une violence ou d’une force importante ;
- la profanation : refus des règles d’interaction qui dépasse le rituel ;
- l’anormalité : ce sont des symptômes qui mettent à mal les règles d’interactions, c’est une rupture de l’intégration ritualisée.
La théorie constructiviste
Aux origines : l’épistémologie Alfred Schütz (1899 - 1959)
Une des origines et l’épistémologie qui est la science du langage. Schütz est un philosophe et sociologue qui a fui le nazisme en se réfugiant aux États-Unis. Dans la lignée de Goffman, il va s’interroger sur la construction scientifique de la réalité construite. En d’autres termes, il va s’interroger sur ce qu’est un objet de pensée.
Dans les sciences, un objet pensé est un objet construit. Au fond, lorsque l’on veut saisir une réalité sociale on va fabriquer un objet construit. Afin d’observer un phénomène nouveau, il va falloir construire un dispositif scientifique afin de l’analyser. La science est un objet construit qui a pour fonction d’essayer de comprendre une réalité sociale elle-même construite : les objets de pensée construits par le chercheur en sciences sociales doivent être fondés sur des objets construits ce qui signifie que toute démarche scientifique est construite.
La grande question va être d’analyser la réalité qui est elle-même est une construction. Pour Schütz, l’objet de la science est la construction de second degré. On est dans une double logique constructiviste et ensuite cet objet de science sociale a pour seul objet de comprendre la réalité construite telle qu’elle se donne à comprendre et non pas telle qu’elle se donne à voir. Là aussi, il y a un écart important entre ce que l’on voit qui est de l’ordre du subjectif et ce qui est en réalité construit, mais, avant tout, il faut élaborer des outils scientifiques constructivistes.
Cela montre qu’on est dans une réflexion philosophique et épistémologique des rapports entre nos capacités à construire des modes d’analyse et la capacité à comprendre le construit de la société dans laquelle nous sommes.
La philosophie du langage de John Searle
John Searle est un philosophe américain qui va travailler sur la question du langage et va publier en 1995 The construction of social reality[1]. Il va partir de l’hypothèse que tout comme Piaget que le langage est une construction, il est fondamental parce qu’il permet de dialoguer. Le langage est une construction dans la mesure où c’est grâce au fait qu’on l’a acquis, qu’on peut échanger, discuter et négocier.
D’autre part, le langage participe à sa façon de la construction sociale de la réalité. Le langage n’est pas simplement un cadre d’échange, mais c’est un outil de construction de la réalité.
L’étymologie en dit beaucoup sur la capacité que l’on a de pouvoir l’utiliser en tant qu’objet scientifique et qui en raconte beaucoup sur ses faiblesses et ses forces conceptuelles. En travaillant sur le langage, on travaille sur un objet fort qui permet de comprendre la construction d’un énoncé et du coup la conception de la réalité.
Non seulement le langage permet de se comprendre, mais il participe à la construction sociale de la réalité.
Peter Berger et Thomas Luckman : « la construction sociale de la réalité »
Pour Berger et Luckman, le langage reste fondamental, la réalité est un construit social et l’objet des sciences sociales peut comprendre la réalité par le langage. Si on a compris comment s’est fabriquée cette réalité dès lors nous avons des moyens de comprendre le monde dans lequel nous vivons et de comprendre le poids des normes et des institutions dans la fabrication de cette réalité.
Berger et Luckman posent la question de savoir comment la réalité se construit-elle ? Ils postulent que le fondement de la connaissance de la vie quotidienne est le langage, d'autres parts que la société comme réalité objective soumet l’individu au pouvoir et que la société comme réalité subjective est l’identification à l’autre.
Du point de vue de la science politique, toute société doit soumettre l’individu au pouvoir : nous sommes tous soumis au pouvoir et à la construction sociale de la réalité qui n’est pas extérieure à nous, mais nous allons y participer par la question du pouvoir.
Le pouvoir est la construction de règles et de normes qui sont en fait des comportements ; au fond, une société ou un État fonctionnent en réalité à partir de la construction des normes qui font fonctionner la réalité sociale construire. En d’autres termes, c’est une réalité sociale construite.
Ensuite, l’enjeu de la société doit coller à la réalité sociale construite. Dès lors le pouvoir est le faite qu’il va falloir faire coller les individus à cette réalité sociale construite. Le pouvoir va avoir une dimension ou l’institution de rassemblement par rapport à un idéal de réalité sociale construite. Celui qui rompt la réalité sociale construite peut être condamné à mort comme ce fut le cas de Galilée.
Comment la réalité se traduit-elle au quotidien ?
Cela signifie que chez Berger et Luckman les sociétés, tout comme le langage, sont fondées sur des stocks qui permettent de définir et d’adapter le comportement dans la vie quotidienne. On va avoir deux phénomènes importants tracés qui vont être que sont le processus d'institutionnalisation et et le processus de légitimation.
Le processus d’institutionnalisation est le fait que toute société doit canaliser le comportement des individus dans un ordre social. On va institutionnaliser les rapports de l’individu vis-à-vis de la société se créée par l’accoutumance et par la division des tâches. L’habitude est une répétition et la transmission de ses valeurs et des modes de pensée vont être transmis comme un héritage à ceux qui viennent derrière nous et doivent adopter les mêmes comportements de cette réalité sociale construite. Le concept de transmission devient un concept fondamental à toute société, car si elle ne transmet plus elle ne peut plus transmettre la réalité sociale construite et ne peut plus transmettre ses modes de représentations,de gouvernements, d’actions et d’efficacités.
Le monde social ne peut pas être séparé de l’activité humaine et de la question de la gouvernementalité. Ils vont décrire un monde social comme un monde d’institutionnalisation et d’intégration sédimenté par le langage et les traditions qui sont de la légitimation.
Dans toutes les sociétés, il y a du symbolique notamment au niveau du gouvernement et du pouvoir, c’est une manifestation d’une continuité qui est du côté de la construction de la réalité sociale.
Le processus de légitimation crée un processus pour légitimer. Il est nécessaire de rester dans l’univers du symbole afin de légitimer en permanence la fonction collective d’intégration des individus face à cette réalité sociale construite. Nous sommes dans un processus de légitimation permanente de ce qu’il faut faire et qui pose à tous des interdits. Ce processus crée de la légitimée et de l’acceptation de tous.
On voit que ce processus a pour objet de faire accepter par l’ensemble des éléments de la société cette réalité sociale construite.
Le constructivisme dans la théorie des relations internationales
Cette théorie va concevoir que le champ des relatons internationales ce n’est un champ établi, mais en construction permanente, dans ce cadre la théorie constructivisme nous ramène du côté d’un processus en action, c’est-à-dire que ce que nous allons analyser à un instant donné décrit le champ des relations internationales comme un domaine en mouvement. En d’autres termes, la théorie constructiviste nous décrit le champ des relations internationales comme un domaine en perpétuel mouvement selon les stratégies interactionnistes.
Dès lors, il faut comprendre les mobilités et les stratégies. Dans un champ interactionniste, les stratégies peuvent évoluer.
L’hypothèse constructiviste va être de dire que l’enjeu fondamental dépend de plusieurs niveaux :
- rôle des acteurs : ils interprètent des situations. Dès lors, on est dans un champ d’interactions qui procède toujours de la construction sociale de la réalité, c’est une construction. Il y a des situations qui évoluent par le rôle des acteurs dans des temps donnés et selon les circonstances. Il faut d’abord comprendre le rôle, les règlements, les valeurs, les idéologies dans le domaine des relations internationales en sachant que ce n’est pas nécessairement suffisant parce qu’on peut avoir des idéologies opposées.
- Il fut comprendre sur quels modes on fabrique ces réalités sociales.
- comprendre le champ des interactions qui existent dans le domaine des relations internationales parce qu’il explique les stratégies au niveau planétaire.
Le constructivisme est intéressant parce qu’il nous met dans un ensemble de considérations, de continuité de mouvements continus dans le champ des relations internationales. Il va s’opposer aux fonctionnalistes dans le champ des relations internationales, on ne peut pas simplement, mais aussi en termes d’interactions qui peuvent être idéologique de longue durée, mais il peut y avoir des interactions de circonstances par rapport à un problème donnée. Mais aussi critique le systémisme qui est une approche qui va se développer à la fin des années 1980 au moment de la fin de la Guerre froide dès lors qu’on en peut plus comprendre le champ composite du multilatéralisme. On peut se demander comment comprendre la complexité du champ des relations internationales si ce n’est justement en revenant sur la question de l’interaction des acteurs dans le domaine des relations internationales.
Au fond, il abandonne les grands récits préstructurés afin d’interroger une réalité sociale d’acteurs. C’est une critique d’une théorie classique des relations internationales pour revenir sur la complexité du champ des relations internationales en mettant aussi en crise des concepts tels que le concept de l’anarchie. En fait, il n’y a jamais d’anarchie, elle est elle-même une construction. Cela signifie que dans un État en situation d’anarchie il faut réfléchir à comment s‘est construite cette situation.
Dans le champ des relations internationales il y a des acteurs nationaux, mais qui ne peuvent pas exister en tant que tel s’ils ne sont pas en interactions. Nous sommes dans un monde de coaction ou de copartage d’action nationale qui autorise la compréhension de la complexité du champ des relations internationales. Si on prend la question des acteurs, on prend aussi la question des rapports de force.
L’anarchie selon la théorie constructiviste n’est pas un état antérieur présocial, c’est quelque chose qui est quelque chose qui est aussi une résultante et du coup l’anarchie dans les relations internationales résulte elle aussi d’un processus.
Dans le champ des relations internationales, les théories constructivistes apparaissent : ils vont penser la réalité des structures et des conflits et aussi penser l’intersubjectivité c’est-à-dire que c’est le fait que nous sommes dans la représentation et comment certain pays peuvent se permettre de caractériser un autre au nom de l’interprétation de son propre développement.
Les constructivistes prônent que le principe général au niveau mondial est la souveraineté des États, mais qui est, en réalité, subjective, c’est-à-dire fonction de ce que les acteurs reconnaissent. Il y a des règles explicites, mais aussi implicites qui doivent être acceptées comme dans l’interaction et si ces règles ne sont pas acceptées alors il peut y avoir des formes de réactivités spécifiques dans le champ des relations internationales.
Surtout, c’est l’analyse du processus de construction des identités sociales et des acteurs de la politique moderne et ensuite comment en fonction de ces règles et de ces énormes comment les acteurs et les agents interagissent et s’influencent réciproquement ou se combattent.
Annexes
- Vers un « constructivisme tempéré ». Le constructivisme et les études européennes, SiencePo - Centre d'études européennes
Références
- ↑ Searle, John R. The Construction of Social Reality. New York: Free, 1995.