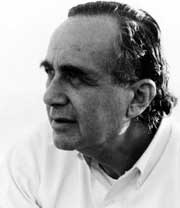Les théories de la guerre en science politique

La science politique s'est longtemps intéressée à la guerre, qui représente l'un des aspects les plus extrêmes et dévastateurs des relations internationales. En effet, la guerre a des implications profondes sur la politique, l'économie, la société et la culture, et elle peut changer radicalement le cours de l'histoire.
L'approche de la science politique à la guerre est souvent multidimensionnelle. Elle comprend des analyses théoriques, historiques, sociologiques, économiques et psychologiques. Cependant, la capacité de la science politique à comprendre et à expliquer la guerre est parfois remise en question. Il y a plusieurs raisons à cela.
- Limites de la théorie : Beaucoup de théories politiques (par exemple, le réalisme, le libéralisme, le constructivisme) ont leurs propres hypothèses et limites. Elles peuvent expliquer certains aspects de la guerre, mais pas tous. Par exemple, le réalisme met l'accent sur le pouvoir et l'anarchie dans les relations internationales, mais il peut avoir du mal à expliquer pourquoi certains États puissants choisissent de ne pas aller à la guerre.
- Prévision et prévention : Bien que la science politique ait fait des progrès dans la compréhension des causes de la guerre, elle a souvent du mal à prédire quand et où les guerres vont éclater. De même, malgré la connaissance des facteurs qui contribuent à la guerre, il est souvent difficile de les prévenir.
- Problèmes méthodologiques : La science politique dépend souvent de données historiques pour construire et tester des théories. Cependant, les guerres sont des événements relativement rares et chaque guerre a ses propres caractéristiques uniques. Cela rend difficile la généralisation à partir de cas spécifiques.
- L'influence de la politique : La science politique, comme toute discipline, n'est pas à l'abri des pressions politiques. Les scientifiques politiques peuvent être influencés par leurs propres préjugés, par les intérêts de leurs sponsors ou par les courants politiques dominants.
Cela dit, la science politique a beaucoup à offrir dans l'étude de la guerre. Elle fournit des cadres théoriques pour comprendre les causes de la guerre, les stratégies de guerre, et les conséquences de la guerre. Elle permet aussi d'analyser les efforts pour prévenir la guerre et pour construire la paix. Enfin, elle offre une perspective critique qui peut remettre en question les discours dominants sur la guerre.
La nature de la guerre a évolué au cours des siècles. Traditionnellement, la guerre était considérée comme un conflit entre États-nations, souvent pour des raisons de territoire, de ressources, ou de pouvoir. Dans ce contexte, les règles de la guerre étaient relativement claires et formelles, régies par des conventions internationales comme les Conventions de Genève. Cependant, avec l'avènement de la guerre de partisan au XIXème siècle, la nature de la guerre a commencé à changer. La guerre de partisan, telle qu'elle a été conceptualisée par des penseurs comme Clausewitz, implique souvent des individus ou des groupes non étatiques qui se battent contre un État. Ces guerres sont souvent asymétriques, avec un déséquilibre de pouvoir entre les parties, et elles peuvent être caractérisées par des tactiques de guérilla, le terrorisme, et d'autres formes de résistance irrégulière.
De plus, nous assistons aujourd'hui à une autre évolution de la guerre. Avec la mondialisation, l'évolution technologique, et l'essor du terrorisme international, nous voyons de plus en plus de conflits qui ne sont pas limités à des frontières nationales et qui impliquent une variété d'acteurs non étatiques, y compris des groupes terroristes, des milices privées, et même des entreprises de cybersécurité. Ces guerres "hybrides" ou "non linéaires" peuvent être difficiles à gérer et à résoudre, car elles ne suivent pas les règles traditionnelles de la guerre. En effet, ces nouvelles formes de guerre soulèvent une préoccupation : elles peuvent sembler ne jamais s'arrêter. Sans un État clairement défini à vaincre ou un territoire spécifique à conquérir, il peut être difficile de définir la victoire ou la fin de la guerre. Cela peut mener à des conflits prolongés, avec toutes les souffrances humaines et les instabilités politiques que cela implique.
Ces évolutions représentent des défis importants pour la science politique et pour la société en général. Il est essentiel de continuer à réfléchir sur ces questions, de développer de nouvelles théories et stratégies, et de travailler pour la prévention des conflits et la construction de la paix.
Pourquoi la science politique s’est-elle intéressée à la guerre ?
La guerre a été un élément omniprésent tout au long de l'histoire de l'humanité, et elle a profondément façonné les sociétés, les cultures, les économies et les politiques. C'est pourquoi la science politique, ainsi que d'autres disciplines comme l'histoire, la sociologie et la psychologie, s'intéressent de près à la guerre. L'Europe a été largement épargnée par les conflits armés directs depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale en 1945 jusqu'en 2022, grâce en grande partie à la construction de l'Union européenne, à la dissuasion nucléaire et à la présence de l'OTAN. Il y a eu des exceptions notables, comme les guerres en ex-Yougoslavie dans les années 1990. L'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022 est un rappel sombre que la paix n'est jamais garantie et que la guerre peut éclater même dans des régions qui ont connu une longue période de paix. La crise a souligné les tensions existantes autour de l'expansion de l'OTAN et de l'Union européenne vers l'est, ainsi que les aspirations de l'Ukraine à s'intégrer davantage à l'Europe. Cette situation a des implications profondes pour l'Europe et le monde, en termes de sécurité, de stabilité politique, de relations internationales et de droits de l'homme. Malheureusement, la paix prolongée dont l'Europe a bénéficié est en effet rare dans l'histoire de l'humanité. De nombreuses régions du monde ont connu des conflits armés réguliers, et même aujourd'hui, des guerres font rage dans des endroits comme le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Asie.
La science politique en tant que discipline académique distincte a commencé à prendre forme à la fin du 19ème et au début du 20ème siècle, une période marquée par des tensions politiques et des conflits internationaux majeurs. L'expérience de la Première Guerre mondiale a certainement alimenté l'intérêt pour l'étude systématique du pouvoir, des institutions, des conflits et de la coopération entre les États. Le 20ème siècle a été marqué par de nombreux conflits, dont les deux guerres mondiales, la Guerre froide, et une multitude de guerres régionales, de conflits civils et de guerres par procuration. Ces conflits ont façonné l'ordre politique mondial et ont eu un impact majeur sur le développement de la science politique. Ils ont conduit à l'émergence de nouvelles théories et approches, comme le réalisme et le libéralisme en relations internationales, qui cherchent à expliquer le comportement des États et la dynamique des conflits internationaux. La science politique a également été influencée par les développements technologiques, économiques et sociaux du 20ème siècle, comme l'émergence de l'arme nucléaire, la mondialisation de l'économie, et les mouvements pour les droits civils et les droits de l'homme. Tous ces facteurs ont contribué à façonner la discipline telle que nous la connaissons aujourd'hui. En bref, la guerre et les conflits ont joué un rôle crucial dans la naissance et le développement de la science politique. Ils ont stimulé la réflexion sur des questions fondamentales comme le pouvoir, l'autorité, la justice, la sécurité et la coopération internationale, qui sont au cœur de la discipline.
Tout d'abord, les guerres de décolonisation. Après la Seconde Guerre mondiale, une vague d'indépendance a déferlé sur de nombreuses colonies européennes, entraînant une série de guerres de décolonisation. Ces guerres ont souvent été caractérisées par des luttes de pouvoir entre les forces coloniales et les mouvements nationalistes locaux. Elles ont eu un impact profond sur la configuration de l'ordre mondial post-colonial. Ensuite, l'époque de la Guerre froide a été marquée par la menace constante d'une guerre nucléaire entre les superpuissances. Cette menace s'est particulièrement manifestée lors de crises comme la Guerre de Corée et la crise des missiles de Cuba. Ces événements ont souligné le risque existentiel que représentent les armes nucléaires et ont eu une influence significative sur les politiques internationales et les théories de la science politique. Enfin, après la fin de la Guerre froide, les Nations Unies ont joué un rôle de plus en plus important dans la gestion des conflits internationaux, notamment par le biais de missions de maintien de la paix. Cependant, des conflits majeurs, comme les guerres du Golfe et la guerre en Afghanistan, ont révélé les défis et les limites de l'intervention internationale. Chacune de ces phases offre un contexte différent pour l'étude des conflits et des guerres en science politique. Les modifications dans la nature des conflits, les acteurs impliqués, les technologies utilisées, ainsi que les normes et institutions internationales, ont tous influencé la manière dont les politologues abordent l'étude de la guerre et des conflits.
L'attentat du 11 septembre 2001 a marqué un tournant dans l'histoire contemporaine et a profondément transformé la politique mondiale, notamment en ce qui concerne la guerre et le terrorisme. Ce tragique événement a non seulement mené à une guerre en Afghanistan, mais a également façonné la manière dont le monde perçoit et combat le terrorisme. La guerre en Afghanistan, qui a débuté en 2001 en réponse aux attaques du 11 septembre, a été une tentative de démanteler Al-Qaïda, le groupe terroriste responsable des attaques, et de renverser le régime taliban qui l'hébergeait. Cependant, la guerre a eu des conséquences complexes et durables, à la fois pour l'Afghanistan et pour la politique mondiale. La guerre en Afghanistan a montré les difficultés associées à la lutte contre le terrorisme à l'échelle mondiale. Elle a révélé les défis de la reconstruction d'un État après un conflit, la complexité de la lutte contre les insurrections, et les problèmes liés à l'engagement à long terme des forces étrangères dans un pays. De plus, la guerre a également eu un impact sur la manière dont les pays perçoivent et abordent la menace terroriste. Elle a conduit à des changements dans les stratégies de sécurité nationale, dans la législation relative à la surveillance et aux droits civils, et a influencé le discours public sur le terrorisme et la sécurité.
Un aspect crucial de l'évolution de la guerre, est le changement dans la proportion de victimes civiles par rapport aux militaires. Les guerres modernes ont souvent un impact dévastateur sur les populations civiles, non seulement en termes de morts et de blessés, mais aussi de déplacements de population, de destruction d'infrastructures et de traumatismes psychologiques. Dans la guerre de Solferino au XIXe siècle, les victimes étaient principalement des militaires. Cependant, avec la Première Guerre mondiale, le bilan des victimes a commencé à changer, avec une proportion presque égale de victimes militaires et civiles. Cette tendance s'est poursuivie et s'est même aggravée au cours du XXe siècle, en particulier lors de la Seconde Guerre mondiale et dans les conflits plus récents. Cette évolution est due à plusieurs facteurs. Premièrement, l'escalade de la technologie militaire, y compris les armes de destruction massive, a rendu les conflits plus dévastateurs et moins discriminants. Deuxièmement, les stratégies militaires ont changé pour viser de plus en plus les infrastructures civiles afin de saper le moral de l'ennemi et son effort de guerre. Enfin, de nombreux conflits modernes ont lieu au sein des États plutôt qu'entre eux, ce qui signifie que les civils sont souvent pris dans la ligne de feu. Ce changement a des implications importantes pour la science politique et pour la manière dont nous pensons la guerre. Il soulève des questions sur la légitimité de l'utilisation de la force, les droits de l'homme, le droit humanitaire international et la responsabilité de protéger les civils en temps de guerre.
Qu’est-ce que la guerre ?
L'évolution de la nature de la guerre a entraîné des changements significatifs dans son économie et dans la proportion de victimes civiles. De plus, les guerres modernes ont tendance à durer plus longtemps, ce qui a des implications profondes pour la société et l'économie. Auparavant, l'économie de guerre se concentrait principalement sur la production d'armements et d'autres biens nécessaires à la guerre. Cependant, à mesure que les stratégies militaires évoluaient, l'objectif est devenu de détruire les outils de production de l'ennemi pour affaiblir son économie et donc sa capacité à faire la guerre. Cela a entraîné une augmentation du nombre de victimes civiles, car les infrastructures civiles sont devenues des cibles militaires. En outre, la nature prolongée de nombreux conflits modernes a également eu un impact sur l'économie de la guerre. Au lieu d'une production intensive à court terme pour soutenir l'effort de guerre, les économies doivent maintenant gérer les effets à long terme de la guerre, comme la reconstruction après la destruction et le soutien aux victimes de la guerre. Ces changements ont des implications majeures pour la science politique, notamment en ce qui concerne les questions de droits de l'homme, de droit humanitaire international et de stratégie militaire. Ils soulignent également l'importance d'une gestion efficace de la paix après le conflit pour minimiser les dommages à long terme causés par la guerre.
Une perspective intéressante sur la guerre est celle d'une extension du dialogue politique, bien qu'elle se présente sous une forme violente et destructrice. Cette idée est en fait une interprétation de la célèbre citation de Carl von Clausewitz, stratège militaire prussien du 19ème siècle, qui a déclaré que "la guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens". Selon cette perspective, la guerre n'est pas simplement un échec de la politique, mais une autre forme de dialogue politique, bien que violent et destructeur. C'est une période où les conflits et les différends sont résolus par la force plutôt que par le dialogue ou la négociation. Dans ce sens, la guerre peut être vue comme une "inversion de la normalité", où la violence remplace la paix comme moyen principal de résolution des conflits. Cependant, la guerre a également des conséquences profondes et souvent dévastatrices. Elle entraîne la mort et la souffrance de nombreuses personnes, la destruction de biens et d'infrastructures, et peut avoir des conséquences économiques, politiques et sociales durables. Par conséquent, bien qu'elle puisse être vue comme une extension du dialogue politique, il est crucial de reconnaître les coûts humains et sociaux élevés de la guerre. C'est précisément pour ces raisons que la guerre est un sujet d'étude important en science politique. Comprendre la guerre, ses causes et ses conséquences, peut aider à prévenir les conflits futurs, à gérer efficacement ceux qui se produisent et à minimiser les coûts humains et sociaux de la guerre.
La définition de la guerre par George Bataille, philosophe et écrivain français, comme "un jeu suprême" souligne la gravité et l'importance des enjeux en jeu. Comparée à un jeu, la guerre, dans ce contexte, n'est pas un divertissement léger, mais plutôt une activité stratégique et potentiellement mortelle qui engage tout ce que les participants ont, y compris leur vie. Le fait de voir la guerre comme un jeu stratégique, cependant, peut avoir des implications importantes pour la façon dont nous la comprenons et la gérons. Dans un jeu, il y a généralement des règles à suivre, des stratégies à développer et des gagnants et des perdants clairement définis. Si nous appliquons ce cadre à la guerre, cela peut nous aider à penser de manière plus stratégique à la conduite de la guerre, aux moyens de minimiser ses coûts et à la façon de gérer ses conséquences.
Cependant, il est également important de noter que la guerre diffère des jeux ordinaires de plusieurs façons importantes. Premièrement, les enjeux sont infiniment plus élevés - ce ne sont pas seulement des points ou des trophées qui sont en jeu, mais des vies humaines, des sociétés et des nations entières. Deuxièmement, contrairement à la plupart des jeux, la guerre n'est pas toujours clairement délimitée avec des règles équitables et universellement acceptées. Enfin, alors que dans la plupart des jeux le but est de gagner, dans la guerre, le but ultime devrait toujours être d'arriver à une paix durable et juste. C'est pourquoi la science politique, en étudiant la guerre, cherche non seulement à comprendre comment les guerres sont gagnées, mais aussi comment elles peuvent être prévenues et comment leurs conséquences peuvent être gérées de manière à promouvoir la paix et la justice.
La guerre peut être considérée comme une "inversion d'un système" dans le sens où elle remplace les mécanismes habituels de dialogue, de négociation et de résolution des conflits par la force. Dans ce contexte, le "dialogue" se fait non pas par des mots, mais par des actes de violence. C'est précisément pour cette raison que la guerre est si dévastatrice et coûteuse, tant en termes de vies humaines que de ressources. Elle est également imprévisible, car une fois que le recours à la force est engagé, il est difficile de contrôler ou de prédire les résultats. C'est également pour cette raison que la science politique, ainsi que d'autres disciplines comme les relations internationales, s'efforcent de comprendre les causes de la guerre et de développer des stratégies pour prévenir les conflits, gérer les guerres lorsqu'elles se produisent et rétablir la paix et la stabilité après un conflit. En fin de compte, la guerre est un "dialogue par la force" qui a des conséquences profondes et durables. Comprendre ce "dialogue" est essentiel pour promouvoir la paix et la sécurité dans le monde.
La guerre : un objet de lutte entre puissances étatiques
Un phénomène ancien vs la guerre moderne interétatique
Un phénomène ancien
L'étude de la dimension mythique de la guerre est un aspect fascinant de la science politique. Les États et les gouvernements ont souvent recours à des mythes et des récits pour justifier la guerre, galvaniser le soutien public, et donner un sens à la violence et au sacrifice qu'elle implique. Ces mythes peuvent prendre de nombreuses formes et peuvent être influencés par des facteurs historiques, culturels, religieux et politiques. Le concept de sacrifice est souvent central dans ces mythes de guerre. Il peut être invoqué pour souligner l'importance de la cause pour laquelle on se bat, pour valoriser les actions des soldats, et pour aider à rationaliser les coûts humains de la guerre. Le sacrifice peut être présenté comme un devoir patriotique, un acte de bravoure, ou une nécessité tragique. Cependant, les mythes de guerre et le discours du sacrifice peuvent aussi servir à masquer les véritables coûts et conséquences de la guerre, à marginaliser les voix dissidentes, et à éviter un examen critique des motivations et des stratégies de guerre. Par conséquent, il est important d'interroger et de critiquer ces mythes, et de comprendre comment ils sont construits et utilisés. La science politique peut contribuer à cette tâche en examinant comment les mythes de guerre sont créés et maintenus, comment ils influencent la politique et la perception publique de la guerre, et comment ils peuvent être contestés ou déconstruits. Cette analyse peut aider à promouvoir une meilleure compréhension de la guerre et à favoriser des approches plus réfléchies et critiques de la politique de guerre.
Lorsqu'un pays entre en guerre, il existe souvent une sorte de "rallye autour du drapeau" où les différences politiques internes sont temporairement mises de côté et un sens d'unité nationale est cultivé. La "mobilisation idéologique"sert à renforcer la cohésion sociale et à faciliter l'effort de guerre. Cette cohésion est souvent soutenue par une rhétorique qui stigmatise la dissidence. Ceux qui s'opposent à la guerre, ou même qui la critiquent, peuvent être accusés de trahison, de manque de patriotisme ou de ne pas soutenir les troupes. Cette pression sociale peut être extrêmement puissante et peut étouffer le débat public et critique nécessaire. L'exemple de la réaction aux attentats du 11 septembre et la décision du président George W. Bush de déclarer la "guerre contre le terrorisme" illustre bien ce point. Ceux qui ont remis en question cette politique ont souvent été marginalisés ou dénigrés. Pourtant, avec le recul, beaucoup de ces critiques ont été validées. Le conflit en Afghanistan, par exemple, s'est avéré être un engagement long et coûteux qui n'a pas réussi à atteindre plusieurs de ses objectifs principaux. Cela souligne l'importance d'un débat public ouvert et critique en temps de guerre. La science politique peut jouer un rôle important en fournissant des analyses rigoureuses et indépendantes des décisions de guerre, en interrogeant les hypothèses sous-jacentes et en mettant en lumière les coûts et les conséquences potentielles de ces décisions.
La guerre a souvent un caractère sublimé qui peut obscurcir les jugements rationnels et analytiques. La rhétorique de la guerre peut créer un sentiment d'urgence et de grandeur qui encourage la pensée binaire (nous contre eux), la glorification du sacrifice et une tolérance accrue pour la violence. Cela peut conduire à des décisions basées davantage sur l'émotion que sur une évaluation rationnelle des coûts et des bénéfices. La sublimation de la guerre peut également affecter la façon dont les sociétés perçoivent et se souviennent des conflits. Les guerres peuvent être romancées ou mythifiées de manière à minimiser leurs aspects plus sombres et désagréables. Les coûts humains et matériels de la guerre peuvent être négligés, tandis que les actes de bravoure et de sacrifice sont mis en avant. C'est pourquoi il est crucial de maintenir une analyse critique et rationnelle en temps de guerre. Les politologues et autres chercheurs peuvent aider à déconstruire la sublimation de la guerre en examinant de manière critique les récits de guerre, en évaluant les coûts réels des conflits et en soulignant les alternatives à la violence. Cette approche peut aider à prévenir les décisions de guerre précipitées et à encourager des politiques plus pacifiques et humanitaires.
La guerre moderne
la guerre de Trente Ans, qui a eu lieu principalement en Europe centrale, est souvent considérée comme un tournant dans l'histoire de la guerre et de la diplomatie. Bien que cette guerre ait commencé comme un conflit religieux au sein du Saint Empire romain germanique, elle a rapidement impliqué plusieurs grandes puissances européennes, dont la France, la Suède, l'Espagne et le Danemark, et est devenue une lutte pour le pouvoir politique et territorial.
La guerre de Trente Ans est particulièrement importante en science politique pour plusieurs raisons :
- Le traité de Westphalie : Ce traité, signé en 1648, a marqué la fin de la guerre de Trente Ans et a posé les bases de l'ordre international moderne basé sur le système d'États souverains. Ce système, souvent appelé système westphalien, définit les principes de souveraineté nationale et de non-ingérence, qui sont encore au cœur du droit international aujourd'hui.
- La transformation de la guerre : La guerre de Trente Ans a été l'un des conflits les plus destructeurs de l'histoire européenne, marqué par une violence généralisée contre les civils et un niveau de destruction sans précédent. Cela a conduit à des changements dans la façon dont la guerre était menée, y compris l'utilisation croissante d'armées permanentes et de tactiques de siège.
- La politisation de la religion : Bien que la guerre ait commencé comme un conflit religieux, elle a finalement évolué vers une lutte pour le pouvoir politique. Cela a marqué une étape importante dans le processus de sécularisation de la politique européenne, où la religion est devenue un outil de légitimation politique plutôt qu'un moteur de conflit.
En fin de compte, la guerre de Trente Ans et le traité de Westphalie ont eu un impact profond sur la formation de l'État moderne et du système international, ce qui les rend d'une grande importance pour la science politique.
Le traité de Westphalie en 1648 est souvent considéré comme le moment où le concept de souveraineté des États a été formellement reconnu dans le droit international. Ce traité a mis fin à la guerre de Trente Ans en Europe et a établi un système d'États souverains, où chaque État avait le contrôle exclusif sur son territoire et sa population.
La souveraineté des États a plusieurs implications pour la guerre et la politique internationale :
- Les guerres interétatiques : Dans le système westphalien, la guerre est principalement une affaire entre États. Cela signifie que les guerres sont généralement déclarées par les gouvernements, menées par des armées régulières et régies par des lois et des coutumes internationales.
- Le rôle de l'État-nation : L'idée d'État-nation implique que chaque État a le droit de gouverner sa population sans ingérence extérieure. Cela donne aux États le droit de défendre leur territoire et leur population, ce qui peut conduire à des conflits avec d'autres États.
- Le droit à la guerre : La souveraineté des États implique également le droit de déclarer la guerre et de conclure la paix. Cela signifie que les États ont le droit de recourir à la force pour défendre leurs intérêts, bie
Le droit international public, en particulier le droit de la guerre, est principalement axé sur les relations entre États souverains. Il établit un certain nombre de règles et de principes qui régissent le comportement des États en temps de guerre. Parmi ces règles, on peut citer :
- La diplomatie moderne : Le droit international a joué un rôle clé dans l'établissement de normes et de procédures diplomatiques, y compris l'immunité diplomatique, les relations diplomatiques et consulaires, et les négociations de traités.
- La souveraineté des États : Le principe de la souveraineté des États est fondamental en droit international. Cela signifie que chaque État a le droit de gouverner son propre territoire et de mener ses relations internationales comme il l'entend, à condition de respecter les droits des autres États.
- La déclaration de guerre : Traditionnellement, le droit international exigeait qu'un État déclare officiellement la guerre avant de commencer les hostilités. Bien que cette pratique ait été largement abandonnée, le droit international exige toujours que les États respectent les principes de la guerre juste, y compris la proportionnalité et la discrimination entre combattants et non-combattants.
- La conclusion de la guerre : Le droit international prévoit également que les guerres doivent être terminées par un traité de paix, qui définit les termes de la fin des hostilités et établit un cadre pour la résolution des différends restants. Cela est important pour assurer une transition pacifique vers une paix durable après un conflit.
Ces règles sont essentielles pour maintenir l'ordre et la stabilité dans le système international. Cependant, leur application et leur respect peuvent varier en fonction des circonstances, et leur violation peut avoir des conséquences graves, y compris des sanctions internationales et des poursuites pour crimes de guerre.
La théorisation de la guerre
Le grand débat est que d’un point de vue de la science politique on a longtemps vécu sur une pseudo évidence de la guerre parce que la guerre historiquement était ramenée du côté de l’art à avoir « l’art de la guerre ». Pour Platon et Aristote, ce qui définit la politique est que la politique est un « art ».
L’art de la guerre est une technique construite comme l’est l’art de la politique qui fait que l’on a attiré la guerre du côté de la stratégie. Le génie militaire de Napoléon est qu’il contrevient aux lois de la guerre, il s’organise toujours en système pour que ses adversaires croient qu’il n’y a pas de surprise alors que l’art de la guerre est défini selon des procédés. Dans ce paradoxe, la guerre est à la fois de la norme et du dépassement de la norme qui crie un effet de surprise. Il y a un espace de la stratégie qui permettait de ne pas analyser la guerre comme un objet plus compliqué des sciences sociales.
La guerre est un objet de philosophie qui pose un problème de culture et de conscience : Du coup, la question fondamentale est de savoir si l’on peut de la même façon que le suicide est un fait social, la guerre est un phénomène social que l’on peut étudier en tant que tel, dès lors la guerre peut être pensée, c’est quelque chose que l’on peut analyser du côté de la philosophie et notamment la philosophie politique.
Hugo Grotius
Grotius a rédigé un ouvrage intitulé De jure belli ac pacis sur le droit de la guerre et le droit de la paix, il va s’interroger sur la possibilité d’un droit de la guerre. Ce sont des questions toujours d’actualité avec les notions de guerre juste et de guerre injuste. Grotius s’interroge sur le fait de savoir si peut-on construire un droit de la guerre et dans quelle mesure peut-il jouer la guerre elle-même ou l’arrêter. Le droit de la guerre est possible dans deux cas précis:
- guerre défensive : seul la guerre défensive est juste : protéger des populations contre un agresseur extérieur.
- guerre coercitive : destinée à punir ceux qui détournent et s’opposent au droit.
Par contre, il va rendre la guerre illégitime dans les autres cas comme la guerre de conquête, car un État-nation n’a pas pour objet de conquérir d’autres États donc cette guerre est injuste.
Le droit de la guerre dans la théorie de Grotius est aussi un droit de la paix, c’est parce que l’on va qualifier le droit de guerre que l’on pourra qualifier les conditions de paix. Si l’agresseur est dans une position d’injustice, il doit être sanctionné par d’autres États.
Thomas Hobbes
Dans Le Léviathan, Hobbes va réfléchir sur les causes de la guerre civile en s’interrogeant sur les motivations de la guerre. Cela va être au fondement de la construction de l’État moderne de nous dire que cela va être l’état de nature.
L’état de nature peut être soit le chaos ou au contraire l’absolue égalité. Hobbes est du côté de l’interprétation chaotique parce que l’état de nature relèverait les pulsions des individus qui sont des pulsions destructrices menant à la guerre.
Pour éviter la guerre, il faut construire un État fort en instaurant la raison par l’abandon de la théorie du droit naturel pour passer à un contrat social. Ce qui fonde l’État moderne est la capacité à vivre à travers le contrat qui garantit la paix. Dans les missions que Hobbes pensent à l’État moderne il y a la construction d’une armée, car elle garantit la paix.
Emmanuel Kant
Kant va s’interroger sur ce qu’il appelait la construction de la paix et sur les moyens pour arriver à la paix perpétuelle et comment fabriquer une théorie juridique de la paix.
La paix ne peut pas se fonder sur l’émotion et sur l’affect, elle est fondée sur la rationalité. Dès lors, seule la raison peut conduire les hommes à accepter la paix, c’est une raison morale. La seule solution est de penser une mutualisation de différents.
Il faut inventer un droit international de la paix qui est la gestion des rapports de force entre nations sur la base que la régulation est nécessaire parce qu’il y aura toujours des guerres.
L’apport important de Kant va être de dire que le droit international public qu’il faut construire ne sera pas le droit du plus fort. Cela doit être quelque chose d’autre qui est un droit de la paix qui n’est pas un droit de la guerre. Il faut fabriquer une paix universelle, mais il est avant tout nécessaire de penser trois niveaux de paix :
- droit de politique interne : si tous les pays adoptent une constitution républicaine, les conflits à l’intérieur des pays pourraient être gérés.
- droit international interfédéral/interétatique : si un droit de la paix a été créé à l’intérieur des États par un système de constitution républicaine il peut y avoir un système de relations partenariales entre les États.
- droit international d’hospitalité : c’est la capacité des États à dialoguer dans une paix perpétuelle. C’est un droit international cosmopolite.
C’est un penseur intéressant, car c’est l’auteur et le concepteur de l’émergence d’un droit international public de la paix sur la base que tout doit être librement consenti et qu’il faut lutter contre tout système autocratique, c’est-à-dire de personnalisation du pouvoir, pouvant amener la guerre. La paix entre les États se construit par des souverainetés limitées.
Hegel
Hegel va s’interroger sur la guerre en l’interprétant comme un comportement subjectif de l’être. Au fond la guerre ne peut pas s’arrêter, car elle permet à la subjectivité de l’individu de se situer dans un champ politique. Dès lors la guerre ne peut pas disparaitre parce que d’une certaine façon elle permet aux subjectivités d’exister et va permettre aux différents peuples de surmonter ses oppositions pour se solidifier.
La guerre a un avantage extraordinaire, car elle arrive à sublimer les différences des individus dans l’espace de l’État-nation, elle rassemble et efface les contradictions renvoyant directement aux théories de René Girard.
Machiavel
Machiavel est un humaniste dans une principauté de Florence qui organise les milices de citoyens et il rédige Le Prince où il va décrire les modes de gouvernement. Machiavel travail sur les qualités du gouverneur et pour cela il doit s’approprier l’art de la guerre qui est nécessaire pour son pouvoir qui détient une vertu morale. Dès lors, la fin justifie les moyens, car ce qui est le plus important est d’atteindre des objectifs peu importe la façon de les obtenir. Un objectif moral par la guerre n’est pas grave s’il n’est pas en lui-même moral, car l’objectif tient l’ensemble du dispositif.
Lorsque l’on qualifie un individu de machiavélique, on suggère qu’il y a une contradiction entre l’affirmation des buts et la gestion des moyens pour arriver à ses fins.
Chez Machiavel, il a y une tendance très inquiétante parce que la question de la guerre est valorisée.
Antoine-Henri de Jomini
Antoine-Henri de Jomini fut capitaine de l’armée suisse et rédigea un traité de l’art de la guerre avec une méthode d’analyse stratégique en posant la question : qu’est-ce que la stratégie ?
C’est un ensemble d’éléments sur lequel on voit un effort de gestion du terrain :
- le positionnement des troupes ;
- l’analyse in situ des forces en présence ;
- les modalités de l’attaque des points faibles ;
- les conditions tactiques de la poursuite de l’ennemi ;
- les conditions de la maîtrise du mouvement ;
- l’intégration du concept de mobilité et de surprise ;
- la ruse comme les fausses attaques, l’apparence de décrochements et les contre-attaques.
Carl von Clausewitz
Pour Clausewitz, la guerre est une relation entre des objectifs politiques et des buts de guerre. Lorsque l’on dit que les guerres d’aujourd’hui sont des guerres sans fin, c’est parce qu’on a perdu leurs objectifs politiques.
La guerre sans fin se développe parce que s’oublie un des principes fondamentaux de la guerre westphalienne qui est que si nous faisons la guerre dans un système westphalien, c’est pour aller vers la paix et non pas pour rester en guerre. Lorsque l’on dit que le temps de la guerre est un temps d’inversion, cela veut simplement dire que la guerre est un temps d’inversion pour revenir vers la paix.
La guerre est une parenthèse dont la construction du rapport de force n’a que pour objet la sortie de la guerre. Lorsque Clausewitz parle de la guerre comme une construction politique, il rappelle une chose fondamentale qui est que la guerre est la continuation de la politique par d’autres moyens.
Dans l’esprit de la guerre westphalienne, la guerre est subordonnée au politique. Si la guerre d’aujourd’hui est si dangereuse, c’est parce qu’elle devient une guerre sans fin parce que l’objectif politique est oublié. Dès lors, on rentre dans un état de guerre permanent parce que l’on a plus les structures étatiques ou institutionnelles qui rappellent que la guerre à un moment donné doit s’arrêter.
Lorsque l’on étudie des territoires en guerre comme le Darfour, au fil des années, les structures nationales, internationales et étatiques se dissolvent montrant que ce sont des guerres presque privatisées parce que les structures ne sont plus là.
Clausewitz est important, parce qu’au fond, la guerre est la continuation de la politique par d’autres moyens, cela signifie qu’il va falloir à un moment donné revenir vers la politique. Sans politique, c’est-à-dire de capacité à structurer le conflit, il est impossible de sortir de la guerre ce qui explique que certains pays d’aujourd’hui sont dans un état de guerre permanent.
Pour Clauswitz, le danger est que la guerre échappe au politique. Il faut absolument que la guerre soit maitrisée par le politique, car c’est la capacité et le registre même de la guerre. Si la guerre échappe au politique, c’est la guerre qui va remplacer le politique, dans ce cas nous rentrons dans la folie dans quelque chose qui nous échappe.
La guerre peut être une formidable machine de négociation de la paix. La guerre se fait parce que la discussion n’est plus possible, mais aussi parce la guerre permet de renégocier la paix.
Maurice Davie
Selon Davie dans l’article The Evolution of War publié en 1930[1], la guerre dans les sociétés primitives renvoie à :
- la concurrence vitale pour la survie du groupe :
- les différends religieux ;
- la vengeance de sang ;
- la gloire.
Marvin Harris
Pour Harris, comme relaté dans son ouvrage Cows, Pigs, Wars and Witches: The Riddles of Culture publié en 1973[2] dans une société traditionnelle, il existe quatre théories sur l’origine de la guerre dans les sociétés primitives :
- la guerre comme solidarité : elle soude une population, c’est une mode de préfabrication de la légitimité ;
- la guerre comme jeu : dimension ludique de la guerre, le sport peut être perçu comme la continuité de la guerre ;
- la guerre propre à la nature humaine ;
- la guerre comme continuation de la politique : elle permet de fabriquer de la politique.
La guerre et la paix : un objet juridique et de gouvernance internationale
Le droit de la guerre ou droit de La Haye
Nous avons parlé du traité de Westphalie qui engageait une première réflexion sur l’état central de la guerre et le droit de la guerre que l’on appelle aussi le droit de la Haye. C’est le droit qui consiste à pouvoir faire la guerre ; la guerre est soumise au droit public international, il y a des règles. L’attaque de Pearl Harbour est une rupture de la condition même de la guerre.
Le droit de la guerre fixe des droits est des devoirs pour les belligérants dans la conduite des hostilités. À partir du moment où l’on rentre en guerre, il y a des devoirs et des droits.
Ils portent sur la limitation des moyens comme par exemple l’interdiction de munitions qui peuvent affecter les populations civiles. De plus, le droit de la guerre définit des règles et prévoit des sanctions pour ceux qui les enfreindraient. C’est pourquoi il y a souvent au Conseil de sécurité des Nations-Unies des textes qui sont pris contre certains pays qui ont outrepassé les règles de la guerre.
Le droit international humanitaire ou droit de Genève
C’est un droit humanitaire qui a pour objet de protéger ceux qui ne participent pas aux combats et notamment les populations civiles. Ce droit est important, car il a été créé à Genève en 1949 et il est un des fondements juridiques de la protection de civils en cas de conflits armés.
Il y a des lois importantes qui font des distinctions fondamentales entre civil et militaire en temps de guerre. Ce qui est en jeu est le statut du combattant et du prisonnier de guerre.
Ces protocoles ont été plus ou moins adoptés par différents États et justifient la jurisprudence du crime de guerre. Le principe de crime de guerre est celui qui enfreint les règles de la guerre. Le paradoxe est que l’on a un droit international de faire la guerre, un droit international humanitaire de la guerre, mais il n’y a pas de droit international de sortie de guerre.
Il y a deux concepts globaux qui dictent la recherche mondiale d’une gouvernance de la sécurité :
- l’universalité : tous les êtres humains appartiennent à l’universel ;
- d’humanité : tout le monde appartient à une communauté humaine qui ne peut accepter tout acte inhumain. Si on appartient à une collectivité humaine il est possible dès lors de qualifier des actes d’inhumanité, c’est-à-dire le droit international public s’intéresse au principe d’inhumanité parce qu’il met en cause le principe des droits de l’homme. C’est parce qu’il a le principe d’humanité que l’on peut poursuivre des tortionnaires et des dictateurs.
Ces deux concepts ont été au fondement de la gouvernance mondiale d’abord au cœur de la Société des Nations, mais qui n’a pu éviter la Première guerre mondiale et puis à travers l’Organisation des Nations-Unies en 1945 avec la création du Conseil de Sécurité, du peace-keeping et du peace-making.
Les guerres des partisans
La guerre de partisans est un type de conflit dans lequel des groupes ou des individus, appelés partisans, s'engagent dans une guerre irrégulière contre une force ennemie. Les partisans opèrent généralement en petits groupes et utilisent des tactiques de guérilla, telles que les attaques en rafale et les embuscades, pour harceler et affaiblir l'ennemi. Ils peuvent également se livrer au sabotage, à la collecte de renseignements et à d'autres formes de guerre asymétrique. La guerre de partisans est souvent associée à des mouvements de résistance et peut se produire en période d'occupation ou lorsqu'un gouvernement lutte contre une insurrection.
La guerre de partisans introduisent les modifications substantielles qui interviennent aux XIXème siècle et XXème siècle. C’est un changement de paradigme, car le concept de parti entend celui qui va défendre une position. La guerre du partisan nous ramène du côté de la gestion des individus plutôt que du côté de la gestion de l’État.
Une nouveauté : la guerre du partisan
Le partisan est celui qui prend parti en défendant une position. C’est quelqu’un qui n’appartient pas au corps régulier de l’armée, il prend les armes pour défendre une cause.
Aymon de Gingins-La-Sarraz
Gingins-La Sarraz était un officier Suisse au service de la principauté de Naples et publie un livre qui s’intitule La guerre défensive en Suisse. Sa théorie est que la Suisse est neutre et il faut renforcer ses capacités défensives, pour maintenir la neutralité suisse il faut fabriquer des partisans qui puissent se mobiliser en cas d’agression.
Pour défendre la Suisse, il faut renforcer les capacités de la guerre en renforçant les insuffisances des troupes par des troupes de partisans. Les partisans servent à pallier le manque de troupes régulières.
La guerre partisane renvoie à des groupes irréguliers qui peuvent se mobiliser dans des systèmes d’attaque et de réponse. Ici, la guerre des partisans est pensée comme un moyen de résister à l’invasion étrangère pour protéger la Suisse ou les Autrichiens.
Carl Schmitt : la théorisation de la guerre des partisans
Carl Schmitt est un personnage sulfureux par sa prise de position pour les nazis en 1933. Dans la Théorie du partisan, ouvrage publié en 1962 apparait que la guerre moderne va être une guerre de partisans. Ce sont des groupements d’individus qui vont s’engager dans la bataille et cela va se faire à partir d’un moment important qui est la guerre napoléonienne en Espagne .
La guerre de Napoléon en Espagne montre pour la première fois la naissance du partisan en tant que sujet et en tant que personnalité qui va se mobiliser pour chasser les troupes napoléoniennes.
La théorie du partisan est très importante, car Schmitt est le premier à penser que nous entrons dans une nouvelle ère de conflit et que cette nouvelle ère de conflit n’est plus essentiellement des conflits interétatiques, mais des conflits de partisans c’est-à-dire des fractionnements de guerres sur la planète dans lesquels des groupes d’individus en tant que partisan soumis à une radicalité du discours et a une idéologie vont se mobiliser contre un ou plusieurs États. Dès lors, le partisan est une armée irrégulière.
Le concept des guerres révolutionnaires
Les guerres irrégulières émergent dans les grandes phases de libération qui vont mobiliser des populations contre la puissance dominante. Pendant la Seconde guerre mondiale, cela sera les résistances contre les nazis, mais ensuite cela va être le FLN contre les français et en Égypte les partisans égyptiens contre le pouvoir anglais, etc.
Les caractéristiques de la guerre de partisan est que ce sont des guerres qui n’ont pas d’uniforme et qui ont un engagement ainsi qu'une idéologie forte. De plus, la guerre de partisan est une guerre asymétrique, le partisan n’a pas les armements de l’État-nation. Pour remporter ces guerres, il faut jouer d’outils différents à savoir la ruse la surprise. C’est une mobilité extrême qui ‘oppose à la guerre classique.
La guerre révolutionnaire est un concept maoïste qui considère que la révolution ne peut être faite que dans le cadre d'une action politico-militaire. C’est un passage à la guérilla urbaine, car la ville devient la jungle du combat partisan qui se situe principalement dans les années 1960 et 1970. Le grand échec de la guerre de partisan est la guerre du Che en Bolivie.
Des guerres aujourd’hui
De nouvelles incidences
Les guerres modernes mettent à mal le système westphalien
La grande question en science politique et en relations internationales s’interroge sur le passage entre la fin des guerres westphaliennes à des guerres sans fin qui montreraient qu’au fond la guerre a changé de sens. C’est ce que certains auteurs appellent le retour à l’anarchie hobbsienne, c’est-à-dire à un état de guerre permanent.
L’anarchie hobbsienne serait un retour à l’état de nature dans un état de guerre perpétuelle dans un recours massif à la force dans les relations internationales qui est une force de régression et cela dans un état d’anarchie généralisé et dans l‘hypothèse que chacun veut construire son pouvoir au détriment de l’autre.
C’est l’idée que la guerre revient de façon très rapide dans le système des relations internationales et va avoir un impact extrêmement important. Ce sont des guerres diffuses qui vont toucher beaucoup plus les civils que les militaires et ce sont des guerres qui vont être plus radicales parce qu’il n’y a pas de règles de régulation.
L’état de guerre perpétuelle
Ce sont des guerres qui vont avoir des impacts considérables sur la nature, on a des destructions de ressources naturelles accélérées : on en vient à l’hypothèse dans ces guerres qui ne n’ont plus de structure que si l'on veut détruire l’autre il faut détruire ses ressources. Dès lors, on utilise la nature comme facteur de pollution et agent de destruction massive.
D’autre part, dans ces guerres ont va détruire la culture de l’autre, car c’est la destruction d’autrui en tant qu’être humain, on détruit son identité et sa mémoire.
Des guerres sans fin
La guerre relevait d’un exceptionnel et la paix d’une normalité ce qui nous amène à nous demander si la guerre en devient pas être une normalité et la paix ne devient pas quelque chose de l’ordre de l’extraordinaire. La paix peut relever presque comme un horizon impossible à atteindre.
La guerre sans fin est une guerre qui n’a plus de but en s’insérant dans le quotidien par des destructions. Elle va d’autre part instaurer une économie spécifique. Dans les guerres sans fin, il faut constituer des économies spécifiques qui se situent généralement autour de la drogue qui se fait dans une paix impossible, car il n’y a pas d’interlocuteur légitime pour construire de la paix.
Selon certains cas, on peut l’expliquer à la guerre en Irak, depuis le début de la guerre du Golfe, nous entrons dans un cycle permanent de la guerre. Dès lors, la paix devient un horizon conceptuellement impensable.
Une nouvelle théorie politique Michael Walzer
Walzer a publié un ouvrage intitulé Guerres justes et injustes[3] qui pose une réflexion d’un point de vue philosophico-politique sur la guerre et sur la notion guerre juste. Il reprend l’interrogation initiale de Hobbes sur la qualification de la guerre, il va être un théoricien du paradigme légaliste, car il considère que pour que la guerre puisse devenir juste il faut que ce soit une guerre encadrée.
Une guerre juste est une guerre maitrisée, c’est une guerre de combattants légaux. En d’autres termes, il y a une légalité de la guerre. Il va pointer les paradoxes, à savoir le lien entre concepts de guerre juste et morale disant que la guerre est un objet d’anormalité,dans le concept de guerre il n’y a pas quelque chose de moral.
La préoccupation philosophique de Waltz et sa théorie politique est de s’interroger sur la fabrication de la morale sur un objet qui est profondément immoral et où peut-on qualifier la question de la morale.
Il va s‘interroger les situations dans lesquelles la morale peut être restaurée dans la guerre. La guerre est morale lorsqu’il y a une situation défensive face à une agression extérieure. Il y a une situation morale de guerre dans la nature employée. Si on institue une codification des armements, il y a une sorte de morale même si nous fabriquons des armes immorales.
La gestion du terrorisme est amorale, car dans une gestion de conflit asymétrique, on pose la question de la surprise comme un acte militaire, en plus le terrorisme a besoin de publicité, il est nécessaire d’effrayer et de terroriser. Dans la dimension terroriste, il y a une dimension amorale. On ne s’attaque qu’aux plus faibles dans un axe qui n’est pas déclaré par la guerre.
Il va de plus réfléchir sur la question de la moralité et le retour du politique. Pour Waltz, le paradigme légaliste ne peut refuser la question des règles de la conduite de la guerre. C’est pourquoi Philippe Delmas pose la question dans son livre éponyme du Bel Avenir de la Guerre[4].
Annexes
- "Clausewitz and the Blue Flower of Romanticism: Understanding."International Relations And Security Network. N.p., n.d. Web. 25 Sept. 2014. <http://www.isn.ethz.ch/Digital-Library/Articles/Detail/?lng=en&id=183843>.
- "(Audio) Conférence #2 - Pierre Hassner, "Guerre Et Paix Au XXIe Siécle" - 27 Janvier 2014. <https://www.youtube.com/watch?v=fJJ3ptIm5Pg&list=PLai4NNFe3eJMYFKhqqNLe0VqrB5av3ljQ>.
- NATO StratCom COE; Mark Laity. (2018, August 10). What is War?. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=Gj-wsdGL4-M
- ouvrages
- Un souvenir de Solferino, Henry Dunant : ouvrage complet à télécharger
- Léviathan : Traité de la matière, de la forme et du pouvoir ecclésiastique et civil, Thomas Hobbes : ouvrage complet à télécharger
- Le Prince, Miachavel : ouvrage complet
Cours
Références
- ↑ "Book Review:The Evolution of War: A Study of Its Role in Early Societies. Maurice R. Davie." Am J Sociol American Journal of Sociology 35.6 (1930): 1114.
- ↑ Cows, Pigs, Wars and Witches: The Riddles of Culture. London: Hutchinson & Co. 1975. ISBN 0-09-122750-X. Reissued in 1991 by Vintage, New York. (version complète pdf:http://monoskop.org/images/5/5b/Harris_Marvin_Cows_Pigs_Wars_and_Witches_The_Riddles_of_Culture_1974.pdf)
- ↑ Walzer, Michael. Guerres Justes Et Injustes: Argumentation Morale Avec Exemples Historiques. Paris: Belin, 1999.
- ↑ Delmas, Philippe. Le Bel Avenir De La Guerre. Paris: Gallimard, 1995.