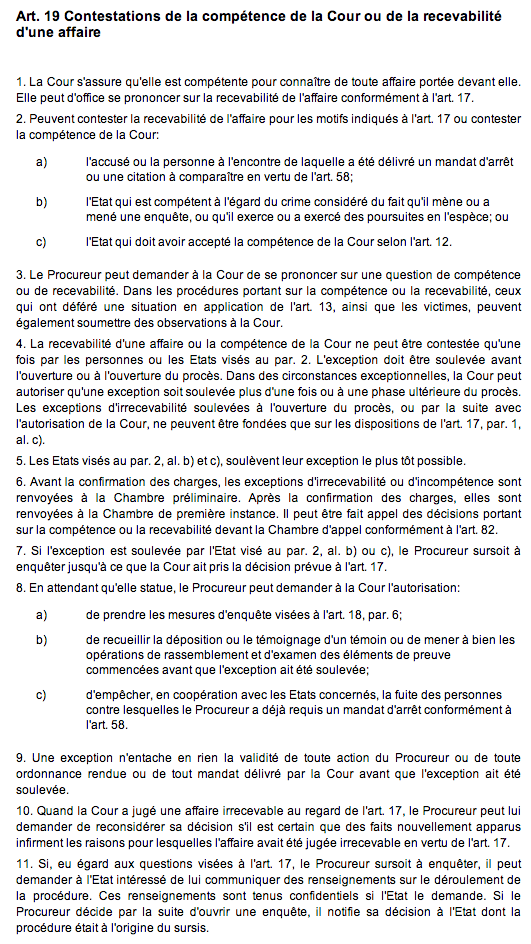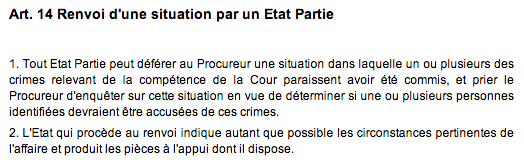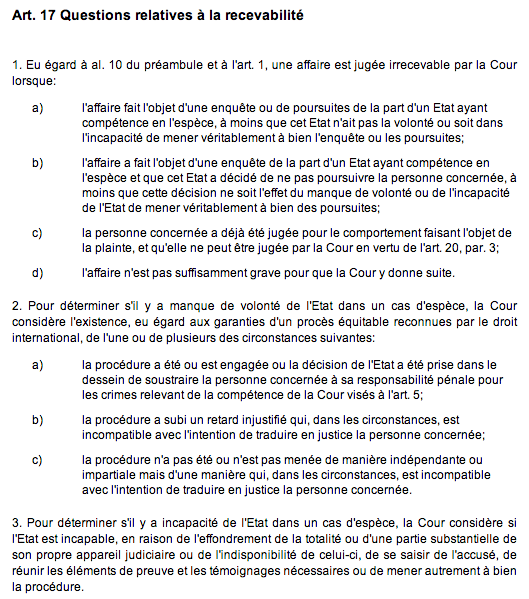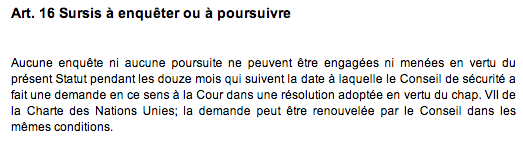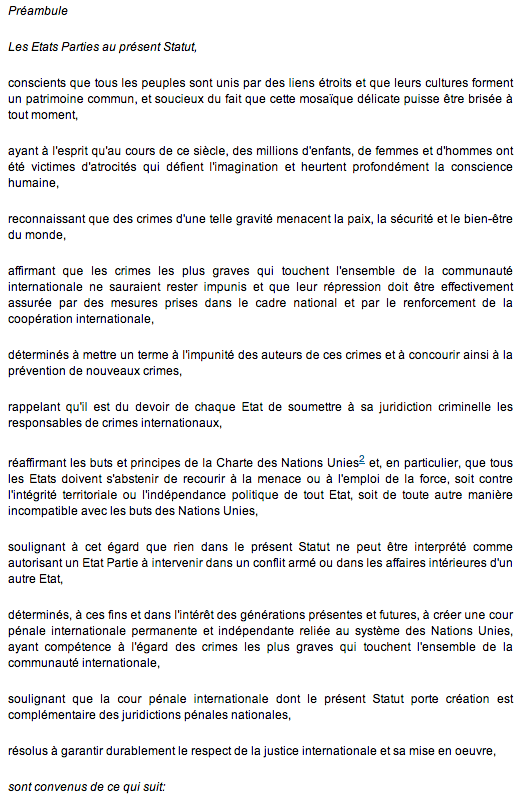L'individu en tant que sujet du droit international
- Dans quelle mesure les individus que nous sommes sont des sujets du droit international ?
Il est nécessaire de faire à cet égard quelques remarques historiques très brèves, mais avant un point définitionnel.
Lorsque nous parlons des individus comme sujet du droit international donc des individus capables d’avoir des droits et des devoirs en vertu du droit international ; le terme « individu » ici a une connotation plus large juridiquement, les juristes disent parfois des choses surprenantes.
Individu au sens juridique veut dire tout sujet de droit international, donc l’être humain, mais aussi une entreprise commerciale avec une personnalité juridique, mais aussi une fondation, non pas évidemment que tous les individus aient les mêmes droits, mais « individu » est pris au sens plus large.
L’individu, avant 1945, avait un statut très particulier en droit international, ce statut était qu’il était pratiquement absent du droit international, il pouvait être l’objet d’une règlementation du droit international, mais il ne jouissait pas en tant qu’individu direct de droits et de devoirs en vertu de l’ordre juridique international.
Objet du droit international ? Toute une série de traités et de règles coutumières concernait les individus, il y avait des traités protégeant les minorités, il y avait en droit coutumier le « standard minimum » qui était à l’époque une série de règles coutumières prévoyant la manière dont les États devaient traiter les étrangers ; il y avait un certain nombre de droits pour les étrangers, si les ressortissants d’un pays se trouvent dans un autre État, l’État initial a le droit d’exiger un standard minimum de traitement.
Toutes ces réglementations bénéficiaient peut être à l’individu, dans ce sens l’invendu était un objet du droit international qui s’en préoccupait aussi, mais l’individu ne pouvait pas prétendre directement sur la base du traité ou de la règle coutumière parce qu’il n’avait pas directement de droits ou directement d’obligations en vertu du droit international.
Les régimes précédents fonctionnaient d’une manière différente, ils n’accordaient pas des droits et des devoirs directement applicables en vertu du droit international et que l’individu pouvait réclamer en son nom devant les organisations internationales.
Il était prévu que les États inséraient ces traités dans leur droit interne, c’est dans le cadre du droit interne que les individus pouvaient bénéficier des règles de ces traités.
Le fonctionnement du régime était de fixer un certain standard en droit international et de la faire incorporer en droit interne ; la violation de ces régimes en pouvait donner lieu qu’à la protection diplomatique.
Si un ressortissant suisse se trouve en Russie accusé de piraterie et qu’on estime que cela viole le standard minimum alors on pouvait demander des comptes à la Russie relativement à la protection diplomatique, mais seulement d’État à État. Le droit international prévoyait des régimes qui bénéficiaient aux individus, mais les droits passaient toujours par le droit interne, l’individu ne pouvait faire valoir de droits et d’obligations directement en vertu du droit international.
Cela a changé après 1945, cet espèce d’écran qui consiste à dire que le droit international sont uniquement les relations interétatiques, et que l’individu relève du droit interne, cela à changé puisque maintenant on accorde certains droits et on impose certaines obligations aux individus directement en vertu du droit international, ce sont des droits subjectifs fondamentaux que l’on résume sous le terme droit des Droits de l’Homme et de l’autre coté des obligations qu’on impose aux individus relève du droit pénal international qui concerne les grands crimes pour lesquels on peut directement demander des comptes à un individu.
Pour qu’un traité des droits de l’Homme puisse être appliqué à un État, il faut qu’il soit ratifié, pour ce qui est des droits de l’Homme basés sur le droit coutumier, il n’y a pas l’obstacle de la ratification.
- Pourquoi a-t-on adopté cette nouvelle optique ?
La raison de ce changement est tout simplement l’expérience qui a été faite de l’entre-deux-guerres qui montre que le droit interne peut être gravement défaillant, même des États de culture peuvent sombrer dans une relative barbarie, le droit interne peut dysfonctionner ou être utilisé à des fins obscures.
On s’est dit que le droit international n’offre pas une garantie suffisante parce qu’il peut fluctuer alors qu’une protection internationale qui lie les États et qu’ils ne peuvent unilatéralement modifier permet à l’individu d’avoir un minimum de garanties.
C’était une optique optimiste, mais l’idée est de maintenir un certain standard lorsqu’avec le droit interne on n’est pas sûr, par le fait que les États soient liés par des standards communs c’est une protection accrue que le droit interne ne prévoit pas.
Le droit international des droits de l’homme[modifier | modifier le wikicode]
Dans le domaine du droit des Droits de l’Homme nous allons nous limiter à donner un aperçu des éléments institutionnels, qui fait quoi, quelles sont les compétences des différents organes et les droits fondamentaux à protéger.
En français, le terme traditionnel est Droit de l’homme ou plus justement droit des Droits de l’Homme qui sont les droits subjectifs, nous discutons de la branche donc du droit objectif des droits de l’homme.
Ce qui demande une explication est plutôt l’utilisation du terme « homme ». Quelques-uns ne jurent que par le terme humain. Le professeur Kolb refuse de parler de droits humains, car on ne réduit pas un individu à un adjectif.
Le point de départ est la Charte des Nations-Unies, c’est la toute première fois que dans un texte de droit positif, dans le soft law, il y avait déjà la Charte de l’Atlantique de 1942, mais dans un texte de droit positif contraignant on voit pour la première fois mentionnée la notion de Droits de l’Homme.
Toutes ces mentions dans le préambule, dans l’article 1, l’article 13, dans l’article 55, toutes ces dispositions ne contiennent qu’une mention générique des Droits de l’Homme et utilisent des termes savamment dosés et restreints, par exemple le rôle de l’Assemblée générale est de pouvoir les droits de l’Homme, il n’est pas dit que l’Assemblée ait un pouvoir de contrôler la manière dont les États se comportent dans le domaine des Droits de l’Homme, c’est une fonction normative, prévoir des textes.
Sur la base de ces dispositions de la Charte et notamment de l’article 13 l’Assemblée a décidé exactement comme pour le droit international qu’elle ne pouvait s’occuper de ce sujet elle-même et a créé un organe subsidiaire qui est la Commission des Droits de l’Homme en 1946.
Cet organe subsidiaire aurait dû être un organe subsidiaire de l’Assemblée, mais comme toute une série des États membres était frileuse sur le domaine des Droits de l’Homme, on a préféré que l’organe subsidiaire soit décalé vers l’ECOSOC qui a des compétences en matière des droits de l’Homme à l’article 55.
Cette Commission des Droits de l’Homme était un organe de 53 délégués gouvernementaux avec quelques autres éléments comme des organisations non gouvernementales.
Que faisait la Commission des Droits de l’Homme jusqu’à 2006 ?[modifier | modifier le wikicode]
Le Conseil des Droits de l’Homme a succédé à cette commission en 2006. L’organe successeur applique encore ses trois fonctions :
- fonction de développement du droit en matière des Droits de l’Homme, « standards setting », développement en matière de standards, c’est une fonction normative.
- fonction de contrôle de la mise en œuvre des Droits de l’Homme, la pratique subséquente a eu longtemps le dessus.
- système de rapport sur des sujets spéciaux : il peut s’agir de groupes vulnérables, de problèmes particuliers, de droits de l’Homme dans des conflits armés ou des constitutions extrajudiciaires, avec des thématiques particulières que l’on choisit en fonction de l’actualité et des urgences.
La première tâche est la fonction normative de la Commission, elle était dans sa tâche littéralement originaire. L’article VII de la Charte prévoit que l’organisation a pour mission de promouvoir les Droits de l’Homme, l’intention des rédacteurs de la Charte était de dire que les Nations-Unies doivent se préoccuper de préparer des textes en matière de Droits de l’Homme pour que les États puissent les ratifier, les insérer dans leur droit interne et ainsi les rendre applicables.
Pendant de longues années, la Commission a fait cela et uniquement cela, toute une série de textes importants conventionnels est passée entre ses mains notamment concernant les pactes de 1966.
Cette Commission a contribué aussi dans toute une série de textes de soft law dont quelques-uns sont célèbres comme la Déclaration sur la Protection contre les disparitions forcées, c’est un texte de la Commission des Droits de l’Homme qui a ouvert la voie en la matière et c’est suite à ce texte qu’il y a eu des conventions en la matière.
La seconde est la fonction de contrôle de la mise en œuvre des Droits de l’Homme qui est une fonction qui n’était pas couverte par la Charte, c’est dans les années 1970 que la Commission a pu s’arroger ce pouvoir contre des résistances.
C’est à travers la résolution 1503 de l’année 1970 que la Commission des Droits de l’Homme a mise sur pied une procédure de contrôle de mise en œuvre dans le cas de violations massives et systématiques des Droits de l’Homme dans un pays déterminé ; il y a une possibilité de se plaindre soit par des individus à travers des pétitions soit par un autre État qui se plaint de violations massives et systématiques des Droits de l’Homme dans un État déterminé.
La terminologie ou la limite de compétence du au terme de violations massives et systématiques et du au fait que la Commission a du se prévenir contre le reproche de s’engager dans une procédure sans en avoir une autorité, la Charte ne prévoit qu’une promotion des Droits de l’Homme, on se trouve à découvert.
Comme il y avait des résistances en la matière, la Commission a estimé qu’on devait limiter ce contrôle pour ne pas donner l’impression de s’occuper de cas individuels ce qui serait trop inclusif, mais on interprète la promotion en disant qu’on ne peut ignorer des situations où il y a des violations extrêmement massives et on doit pouvoir faire quelque chose dans ce cas.
La Commission initiait un dialogue constructif avec l’État accusé de commettre ces violations massives et systématiques dans une procédure confidentielle. C’est la raison pour laquelle encore aujourd’hui il est difficile de juger la procédure 1503 et de son efficacité.
Il est assez difficile de pouvoir faire une étude sérieuse parce que tout s’est passé confidentiellement et tout s’est passé par des fuites.
Pourquoi un dialogue constructif ?[modifier | modifier le wikicode]
Les Nations-Unies n’ont aucun pouvoir d’intervenir dans les affaires intérieures et d’imposer une manière déterminée de considérer les Droits de l’Homme. À défaut de pouvoir prendre des décisions en la matière et qu’elles n’ont même pas obtenues par la pratique subséquente, à défaut de cela, la seule chose que puissent faire les Nations-Unies et la Commission des Droits de l’Homme est d’obtenir des améliorations pragmatiques.
Pour se faire, il faut entrer dans un dialogue avec les acteurs concernés et engager les choses dans un climat favorable. La pire des choses à faire est de stigmatiser, on ne peut obtenir quelque chose. Pour obtenir quelque chose, il faut engager les gens.
Il faut exclure la presse et la publicité, si la presse est présente, les acteurs se braquent immédiatement et font les choses pour la galerie ; on ne résout pas les problèmes de fond, les problèmes de politique intérieure ne peuvent pas être cédés, il faut montrer qu’on défend telle ou telle cause, agir confidentiellement permet de se « relaxer ». Ainsi on a une certaine chance de pouvoir parler ouvertement.
Voilà donc les deux règles essentielles que suivait la Commission ; c’est un bilan très contrasté que la procédure 1503.
D’aucuns l’ont appelé « la procède de la plus grande poubelle du monde » et d’autres disent que c’est une procédure qui a apporté quelques améliorations.
La confidentialité est le fait du dialogue constructif, la commission a pu faire un certain travail utile. L’idéologie des Nations-Unies et dans la protection universelle des Droits de l’Homme reste dans le dialogue constructif parce qu’on n’a pas de compétence de contrainte, il n’y a pas de Cour des Droits de l’Homme au niveau universel, à défaut de pouvoir contraindre il en reste que le dialogue constructif.
La presse a tendance à avoir une attitude sanctionnatrice, voire très dirigiste. On estime que les Nations-Unies devraient imposer aux États des limites, voire même devraient punir ceux qui violent les Droits de l’Homme, mais cela est tout simplement impossible en l’état des textes, les Nations-Unies n’ont pas les compétences en ce sens.
La troisième fonction est le système des rapports dont on s’est rendu compte que promouvoir les Droits de l’Homme était rendre compte des problèmes ici ou là non pas à cause des violations systématiques, mais aussi à cause de situations particulières. On a pu se rendre compte ainsi que les conflits armés posent des problèmes particuliers en matière de Droits de l’Homme, etc.
On a donc inventé depuis les années 1970 le système des rapports avec des rapporteurs spéciaux ; la Commission nommait un rapporteur spécial sur tel ou tel sujet qui va faire une étude des problèmes concrets et présenter son rapport menant à une discussion. Par la cristallisation du problème et la discussion collective, on se promet des améliorations potentielles.
L’esprit qui préside cela est qu’on se dit que les États ne violent pas toujours les Droits de l’Homme parce qu’ils ont de la mauvaise volonté, mais c’est aussi parce certains problèmes ne sont pas suffisamment connus, en nommant un spécialiste qui va ausculter le problème et imaginer des solutions de façon collective par la consultation des gouvernements, il peut en sortir quelque chose de favorable surtout parce que les problèmes deviennent conscients.
Peut-être que tel ou tel gouvernement confronté à des problèmes similaires a imaginé quelque chose d’intéressant de façon confidentielle, mais qu’on peut désormais mettre en lumière.
La commission des Droits de l’Homme a été dissoute en 2006 et le Conseil des Droits de l’Homme a pris sa place. Il ne faut pas confondre avec les comités des Droits de l’Homme.
Pourquoi la Commission des Droits de l’Homme a été dissoute ?[modifier | modifier le wikicode]
Il y a deux raisons principales.
On disait que l’ancienne Commission des Droits de l’Homme était trop politisée c’est surtout quelque chose qu’on lui reprochait en occident et qu’il valait mieux avoir un organe ou l’expertise prévaudrait un tout petit peu plus sur les débats politiques parfois extrêmement houleux. La critique était que la Commission s’était discréditée. Ce discrédit donnait lieu à des débats épiques de nature politique, mais cela vient aussi d’autres facteurs. On estimait par exemple comme le tiers-monde dominait numériquement la Commission et les Nations-Unies, certains États « passaient à la casserole » plus que d’autres. Par exemple, Israël passait très souvent devant la Commission et se faisait critiquer vis-à-vis des territoires occupés.
Toute une série d’États était plus soucieuse de se faire condamner par leur pratique que de promouvoir les Droits de l’Homme ; c’est être présent pour éviter des condamnations, ce sont des jeux politiques. Ce n’était pas très compatible avec l’idée même qu’on se faisait de la promotion et de la défense des Droits de l’Homme dans le système onusien.
Comme souvent lorsque le bloc occidental veut quelque chose il l’obtient, la Commission a été dissoute et le Conseil crée à sa place afin d’obvier à ces problèmes.
Pour le professeur Kolb, les critiques sont dues au système même, car tout simplement on appelle toujours politisé ce que font les autres ; le problème est que la politisation est toujours de l’autre et comme les États du tiers-monde restent plus nombreux dans le Conseil actuel on retrouve les mêmes débats et les mêmes clivages comme dans l’ancienne commission.
Ce qu’on souhaite faire aux Nations-Unies et d’engager les gouvernements, les experts n’engagent personnes, il faut parler avec les acteurs, il faut parler avec des délégués gouvernementaux qui raisonnent politiquement puisqu’ils représentent des gouvernements. C’est parfois un peu cocasse de les accuser de faire de la politique puisqu’ils sont là pour ça.
Nous n’avons pas véritable pu obtenir un progrès fondamental sur ces points pour les raisons à peine dites.
Cela ne veut pas dire que le Conseil des Droits de l’Homme n’apporte pas d’innovations ; les fonctions sont restées à peu près les mêmes, mais il diffère sur quatre points particuliers.
Institutionnellement le Conseil est plus élevé que la Commission[modifier | modifier le wikicode]
Il est un organe subsidiaire de l’Assemblée générale. Le Secrétaire général voulait en faire un organe principal, mais cela n’a pu être réalisé, car il aurait fallu réviser la Charte et la révision de la Charte est compliquée.
Ne pouvant réviser la Charte on a fait au mieux en en faisant un organe subsidiaire, l’Assemblée adopte une résolution et l’organe est créé. C’est de l’ordre de la symbolique, mais c’est un rehaussement signalant qu’on attache une importance accrue aux Droits de l’Homme aujourd’hui.
Membership - Les États représentés au sein du Conseil[modifier | modifier le wikicode]
On est passé de 53 États à 47 États, c’est un effort, mais qui n’est pas énorme, cela représente plus de 25 % des États membres de Nations-Unies.
Ces États sont élus pour trois ans une fois renouvelables, après pendant au moins trois ans il faut être hors du Conseil pour y revenir alors que dans la Commission on pouvait être élu période après l’autre.
Au Conseil, on a un tout petit peu plus de mouvement. En plus, il est dit dans la résolution pertinente 60251 de l’année 2006 que les États élus dans le Conseil doivent observer les normes les plus strictes en matière de Droits de l’Homme.
On a octroyé selon le même texte à l’Assemblée générale la possibilité de suspendre tel ou tel membre du Conseil des Droits de l’Homme en cas de violation flagrante et systématique des Droits de l’homme par un vote de 2/3 de l’Assemblée générale soumis à l’article 18.3 de la Charte le prévoit lui-même. On n’obtient pas grand-chose par ce genre de disposition, selon le professeur Kolb, personne n’a une veste blanche, ni les États, ni les êtres humains, c’est une situation hypocrite parce qu’on n’a pas changé les États membres ; de quel droit sommes-nous nécessairement meilleurs, etc.
Pour les violations flagrantes et systématiques, l’Assemblée n’a encore exclu personne, on comprend que la majorité des 2/3 pour exclure un État on ne voit pas quand elle pourrait être appliquée. Nous avons tous l’habitude de considérer toujours l’autre.
L’intensification de la fréquence et de la longueur des sessions[modifier | modifier le wikicode]
On a estimé que l’ancienne session était buissonnière, quelques sessions par années et pas assez de présences. On a fixé dans le règlement du nouveau Conseil qu’il y aurait un minimum de trois sessions par année qui doivent correspondre à un minimum de 10 semaines et il est possible pour chaque membre de proposer des sessions extraordinaires et pour cela 1/3 de membres du Conseil doivent suivre cette proposition.
Il y avait même des propositions plus hardies sur la longueur des sessions. Il faut contester la foi entre la longueur des sessions et la qualité des résultats. Le professeur Kolb constate que lorsque les réunions sont longues les résultats sont piètres. Avec un bon état d’esprit, on peut avancer rapidement sur les points fondamentaux. Il est vrai que prendre le temps nécessaire pour prendre le temps de discuter les rapports peut avoir du bon.
L’examen périodique universel parfois on parle en anglais de pair review[modifier | modifier le wikicode]
Cela signifie que le Conseil doit évaluer l’état des Droits de l’Homme de tous les États membres des Nations-Unies, mais l’essentiel de l’examen périodique universel est que c’est un examen dans lequel tout le monde « passe à la casserole ». Il y a des petits jeux politiques, mais tout le monde doit présenter sa situation périodiquement. C’est un progrès dans le sens où on n’a pas l’impression de choix arbitraire ; il s’agit de dialogues constructifs, les États présentent des rapports qui sont discutés.
Les textes principaux des Droits de l’Homme adapté après la Charte des Nations-Unies ont l’avantage d’être beaucoup plus détaillés et précis tant lorsqu’il s’agit de lex speciali que de lex posteriori.
Le premier texte est la Déclaration universelle de Droits de l’Homme de 1948 soit la résolution 217 ; cette déclaration a été adoptée en 1948 parce qu’on la considérait comme un préambule au pacte des droits de l’homme qui devait suivre, au regard de la gravité de la violation des droits de l’homme notamment par les puissances de l’Axe qu’il fallait faire quelque chose de solennel comme la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 en France, il fallait faire suivre cette déclaration solennelle par un texte juridiquement contraignant.
La déclaration solennelle a une vertu symbolique et politique et derrière il y a une convention sur les Droits de l’Homme. Il été vite possible de se mettre d’accord sur une déclaration universelle d’inspiration politique et solennelle et de la proclamer dans l’Assemblée générale. Le problème est que le traité et le pacte n’a pas suivi, il faut attendre 30 ans pour avoir un traité universel généraliste sur les Droits de l’Homme, il y a eu deux pactes en 1966 qui été du à la scission des camps antagonistes. Les occidentaux croient toujours que I acte numéro est le Pacte civil et politique alors que c’est le II et le premier est le Pacte relatif aux droits sociaux économiques et culturels.
La Déclaration universelle était considérée comme du soft law au début, mais aujourd’hui la doctrine la considère comme le reflet coutumier en matière des Droits de l’Homme, dans nombre de tribunaux internes les tribunaux recourent à la Déclaration universelle des droits de l’homme.
La dernière remarque est qu’il n’y a pas de système de contrôle, c’était une déclarions solennelle qui n’était pas prévue de rester isolée, il était prévu de lui adjoindre un texte juridiquement contraignant avec des mécanismes de contrôle.
Les Pactes restent les deux traités en matière de Droits de l’Homme universels les plus importants parce que ce sont les seuls traités de Droits de l’Homme au niveau universel qui soient complet traitant de l’ensemble des catégories des Droits de l’Homme existants et reconnus. Toutes les autres conventions traitaient de secteurs particuliers comme la Convention contre la Torture ou il s’agit d’intégrité physique et de torture alors que dans les pactes de 1966 il y a tout le spectre.
On se réfère généralement et toujours aux Pactes lorsqu’on se réfère aux Droits de l’Homme, mais en fonction des matières que l’on traite aux conventions spécialisées.
Les Pactes étaient initialement réalisés de manière différente que les procédures de mise en œuvre et de contrôle.
Les deux pactes étaient organisés initialement de manière un peu différente : il y avait un Comité des Droits de l’Homme avec certaines fonctions comme le Pacte sur les Droits civils et politiques, depuis 1985 il y a un Comité des Droits de l’Homme sur les Droits sociaux, économiques et culturels et ce n’est que depuis 2009 que ce Comité peut recevoir des communications individuelles à l’instar du Comité sur les Droits civils et politiques.
Le premier Comité à avoir fonctionné et celui du Pacte numéro II, pourquoi cette différence avec un comité plus musclé et un Comité plus diaphane ?[modifier | modifier le wikicode]
La raison été une raison de justiciabilité, dans la vision de 1966 les droits sociaux, économiques et culturels étaient plutôt des droits à insérer dans le processus politique soit des droits que l’État devrait reconnaître à travers sa légitimation en prenant compte de ses aspects juridiques ; on estimait que le droit au logement n’était pas justiciable au contraire du droit contre la torture.
Dans le droit civil et politique, il y a un Comité des Droits de l’Homme, le Comité des Droits de l’Homme est un organe de traité, c’est un organe des Nations-Unies, mais indirectement, c’est un organe du pacte numéro II, c’est un organe ayant compétence vis-à-vis des États partis au pacte civil et politique.
Ce Comité a fondamentalement trois fonctions :
fonctionne avec les rapports périodiques[modifier | modifier le wikicode]
Les rapports sont examinés par le Comité : les délégués gouvernementaux de l’État en cause présentent le rapport qui est ensuite examiné par un rapporteur soit l’un des 18 experts comme présidant un groupe de travail, il examine le rapport et dresse une liste de questions qui sont des questions de clarifications, parfois on demande des mises à jour, des éclaircissements, des développements ultérieurs, etc.
Les questions sont remises à l’État qui a un certain délai pour y répondre ; la réponse est faite par l’État par écrit, sur la base de ces réponses qui complètent le rapport un dialogue est établi entre le Comité et les délégués gouvernementaux. C’est une discussion « à bâtons rompus » où l’on échange tous azimuts.
À la conclusion de ce processus, le Comité à travers son rapporteur dresse un document dans lequel il exprime ses félicitations si nécessaire pour des progrès accomplis, des préoccupations aussi pour les choses qui prêtent encore à critique et des recommandations sur la manière dont du point de vue du Comité on pourrait et résoudre les problèmes identifiés.
L’État a la possibilité d’étudier les recommandations et de faire connaître ses positions, l’État prévoit un devoir de prendre position, ce que l’État prend position, l’État n’est pas obligé de suivre la recommandation, il n’y a pas de pouvoir de coercition.
Lorsque la Suisse passait devant le Conseil des Droits de l’Homme et que des recommandations ont été faites, la Suisse a accepté sauf quelques exceptions comme pour les minarets.
Les rapports sont utiles, ce n’est pas simplement de la bureaucratie parce que c’est une procédure de cristallisation du problème, parfois il y a des problèmes dans tel ou tel canton sans que Berne ne connaisse les détails.
Là où il n’y a pas de mauvaise volonté, on peut faire des choses, il y a une possibilité d’actions qu’on n’avait pas avant, il faut d’abord être conscient d’un problème pour l’attaquer, lorsqu’on n’a pas de conscience ou qu’on nie le pouvoir on ne peut avancer.
Les échanges sont également fructueux parce que « quatre yeux valent mieux que deux », il ne s’agit pas de stigmatiser, mais d’avoir un dialogue constructif, il ne s’agit pas de contraindre, mais de stimuler. Il y a une valeur ajoutée.
les Comités dressent ce qu’on appelle les observations générales, en anglais ce sont les generals comments[modifier | modifier le wikicode]
Il s’agit d’une fonction interprétative du Comité qui est un organe de traité. C’est l’organe le plus spécialisé à qui on demande de faire un commentaire de chaque article du pacte afin d’expliquer ce que signifient ces termes en donnant la pratique.
Il y a en effet des observations générales très importantes non seulement sur des dispositions concrètes, le Comité étudie même des questions transversales. Une observation générale très connue portait sur les réserves aux pactes sur les droits civils et politiques, quels sont les réserves admissible, sur quelles dispositions les États peuvent faire des réserves - le critère essentiel est qu’on ne peut faire de réserves si elles sont contraires à l’objet et au but du pacte –, quels sont les droits importants sur lesquels ont ne peut pas faire de réserve et jusqu’à quel point on peut faire des réserves ? Toutes ces questions se posent dans l’observation générale 24 ou le Comité s’y exprime en 1995.
Fonction consistant à prendre position sur les communications individuelles[modifier | modifier le wikicode]
C’est une compétence facultative dans le système du pacte, cette fiction du Comité n’est donc pas automatique alors que les deux précédentes sont automatiques, c’est une compétence optionnelle.
C’est du contrôle de mise en œuvre qui ressemble à 1503, on ne démontre pas qu’il y a un ensemble de violations massives et systématiques, chaque individu d’un État parti au Pacte droits civils et politiques et aussi partie au protocole facultatif peut faire une communication individuelle soit une plainte.
Le Comité reçoit une communication individuelle, c’est une plainte fondée sur une violation alléguée dans le droit inséré dans le pacte. Le Comité examine la situation et rédige ses conclusions, souvent ce n’est pas très motivé contrairement aux tribunaux, le Comité sauf dans quelque cas et court sur l’argumentation juridique et conclus rapidement.
Cette prise de position du Comité n’est pas une décision et encore moins une décision juridique, aucun organe au niveau universel n’a une compétence contraignante en matière de Droits de l’Homme, même dans les communications individuelles il n’y a qu’une recommandation au sens technique du terme avec une obligation en vertu du pacte des États d’informer suite aux vues des recommandations faites par le Comité.
Jusqu’à présent il n’est pas rare que les États obtempèrent, très souvent comme à la Cour européenne des Droits de l’Homme, le Comité renonçait qu’il y a une violation, pour les États tout cela est beaucoup moins grave que de continuer à être sur l’agenda et de se justifier devant le Comité, si bien qu’ils obtempèrent le plus souvent.
Pendant tout un temps il n’y avait qu’un système de rapports où les États étaient informés sur les efforts à faire, ces rapports n’étaient initialement pas contrôlés par un Comité, mais à travers Secrétaire général cela remontait à l’ECOSOC.
L’ECOSOC n’exerce pas lui-même sa fonction de contrôle à l’article 16 du pacte numéro I. En 1985, on a créé un comité sous ce pacte afin qu’il y ait une spécialisation, on ne voulait pas lui imposer et lui infliger le contrôle du pacte numéro I.
C’est depuis récemment qu’on a changé de ce point de vue et estimé qu’il y avait des communications individuelles.
Les communications individuelles qui aboutissent à des recommandations peuvent aboutir à quelque chose d’utile. Lorsqu’un comité est établi et une compétence lui est donnée, il faut une dizaine d’années pour juger de son efficacité.
Les deux Pactes de 1966 ne sont pas les seuls instruments en matière de Droits de l’Homme universel, il y en a toute une série d’autres ; il y a très anciennement la Convention contre la discrimination raciale venant de l’époque où les États du tiers-monde étaient devenus indépendants, cette convention fut adoptée en 1965 puis les deux pactes de 1966 suivent.
Très tôt il y a une convention contre la discrimination à l’égard des femmes, c’est une convention progressiste, mais toute une série de réserves assez mauvaises a été faite, qui veut se mettre contre cette convention dans le système international ? Des exceptions néfastes ont été introduites.
La Convention contre la torture de 1984 est une convention qui a également un comité, mais la convention contre la torture a ceci de particulier que son comité n’examine pas des rapports et ne reçoit pas de communications individuelles, elle fait de visites in loco sur des lieux ou il y a des personnes particulièrement sujettes à la torture.
Il y a la Convention sur les Droits de l’Enfant de 1989, elle est importante par son contenu et la publicité qu’on lui a donnée. Il y a aussi la Convention sur les Droits des migrants en 2003, sur les personnes particulières en 2006 et les disparitions forcées en 2008. Ces conventions ont des comités.
Cela fait beaucoup de comités, soit 9 comités en fonction. Cela est assez lourd à gérer.
Le système connaît d’ailleurs des défis auxquels on n’a pas répondu de manière adéquate, il y a des retards dans la présentation des rapports, parfois dans beaucoup d’États les structures sont tel qu’il n’y a pas de personnel adéquat. Il y a des rapports tellement mauvais qu’on y comprend presque rien et on ne sait pas comment y répondre. Le premier problème est la qualité des rapports.
Il y a comme problème la multiplication des procédures, il est difficile pour les États d’être devant autant de comités, à chaque fois il faut utiliser des ressources supplémentaires, cela fait lourd. On avait imaginé fusionner ce comité et n’en faire qu’un.
D’un côté, toute une série de lobbys en voulait lâcher leurs conventions, dans le domaine des Droits de l’Homme c’est un milieu très concurrentiel, il y a beaucoup d’égos surdimensionnés.
C’était aussi la peur que ce soit une première étape pour mettre en place un Tribunal mondial des Droits de l’Homme ; la Russie et la Chine étaient fortement opposées à la fusion des comités.
Les rapports sont utiles, mais on arrive quelque part à une saturation.
Il y a d’autres textes en dehors des Nations-Unies, il y a d’autres organisations universelles ou régionales qui font aussi des textes en matière des Droits de l’Homme.
Il faut mentionner l’Organisation internationale du Travail pour le système universel qui s’occupe de la protection des travailleurs qui a élaboré toute une série de conventions depuis 1919 ; il y a aujourd’hui plus de 200 conventions numérotées, ce sont des conventions dans les matières les plus diverses comme le travail des enfants, le travail de nuit des femmes, l’abolition du travail forcé, la liberté syndicale et patronale, des conventions contre la discrimination sur le travail, etc. il y a aussi un système de contrôle très développé à l’OIT basé sur un système de rapports individuels.
L’organe de contrôle n’est pas simplement des experts, mais c’est un conseil qui se compose des représentants des associations professionnelles, il y a un certain nombre d’experts et un nombre de délégués syndicaux et patronaux en parité. Donc c’est une partition de la société civile.
Il y a des systèmes régionaux, le plus connu, le plus copié et le plus ancien est celui de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1955 avec ceci de particulier qu’il y a une Cour de Justice qui décide de manière contraignante, généralement elle condamne l’État pour les violations à payer des sommes d’argent.
Il y a la Convention interaméricaine des Droits de l’Homme, c’est la Convention de San Jose de 1969 qui reste dans un modèle binaire, il y a une Convention interaméricaine des Droits de l’Homme et une Cour interaméricaine de Droits de l’Homme ; la commission interaméricaine des Droits de l’Homme a notamment une fonction diplomatique.
En dernier lieu il y a la Charte africaine des Droits de l’Homme de 1981 qui s’est enrichie depuis 1998 d’une Cour africaine des Droits de l’Homme et des Peuples ; cette Cour a été prévue plus tard, le continent africain se distinguait à une certaine époque des mesures juridictionnelles, il avait une approche plus collectiviste. Dans les années 1990, les africains ont changé estimant qu’il fallait une Cour pour juger.
L’Asie n’a pas de système comparable, c’est un continent trop hétéroclite avec des solidarités trop faibles pour avoir un système unique.
Quels types de droits sont protégés, qu’attend-on des Droits de l’Homme et du droit humain du point de vue matériel ?[modifier | modifier le wikicode]
Si nous allons à l’essentiel, on déterminera relativement rapidement qu’il y a six types de droits de l’homme projetés par divers instruments de droit international tantôt comme des pactes, tantôt par du droit généraliste :
- Libertés physiques : droit à la vie, de l’intégrité physique et des traitements dégradants. Ce sont plus généralement les libertés relatives à la sécurité de la personne – habeas corpus– : liberté de mouvement, il s’agit de cas d’arrestation et d’incarcération. Le droit à la vie n’est protégé ni de manière absolue ni de manière générale. Le raisonnement selon lequel le droit à la vie est un droit fondamental ne veut pas dire que la vie est un droit défendu en général, par exemple la peine de mort est prévue dans le cadre du pacte des droits civils et politiques de 1989, et le protocole 6 de 1985 quant à la convention européenne des Droits de l’Homme.
- Libertés morales : ce sont les libertés relatives à l’opinion, à la croyance, à la religion, à l’expression.
- Libertés associatives : association plus ou moins grande, plus ou moins étroite, tout d’abord au sens technique du terme ave la liberté de s’associer comme dans des syndicats et d’ailleurs un droit reconnu dans le pacte des droits économiques, sociaux et culturels pourtant c’est un droit tout à fait classique que les pays occidentaux reconnaissaient depuis fort longtemps. C’est aussi tout ce qui touche au droit familial et au droit de se marier, mais aussi la vie privée de la personne.
- Garanties procédurales : c’est un petit univers généralement résumé dans une seule disposition, la question tourne donc autour du procès équitable et des garanties procédurales, en anglais on parle de fair trial. Il y a aussi toute une série de garanties qui valent aussi bien au civil ou au pénal ; c’est le droit à un tribunal indépendant et impartial, l’indépendance qui a trait au tribunal, l’impartialité touche à la qualité des juges qui a trait au fait que les juges n’ont pas de lien particulier avec ce qu’il juge. Dans la jurisprudence il y a eu des cas où les juges jugeaient de façon faceless comme au Pérou dans les années 1990 en vertu de l’article 14 du pacte sur les droits civils et politiques ; le tribunal doit être établi par la loi, le procès doit être public, pour le pénal l’accusé doit être informé des accusations portées contre lui et avoir le temps nécessaire pour assurer sa défense il a d’autre part le droit de faire appel à un avocat, mais encore de faire appel à un interprète, de contacter son consulat, de faire venir des témoins à décharge et d’interroger des témoins à charge. Il y a une jurisprudence extrêmement riche sur le procès équitable.
- Droits politiques : droit à la participation en politique ; pour des pactes universels, ces droits politiques sont extrêmement timides et timorés, on les retrouve à l’article 25 du pacte sur les droits civils et politiques. La seule garantie qui est encore assez faible est que le droit de participation politique soit accordé sans discrimination qui est un tant soit peu énoncé dans le pacte avec les discriminations en fonction de la race, de la couleur, de l’opinion, etc., et sans restriction déraisonnable ce qui permet d’interpréter en fonction de ses propres conceptions.
- Droits économiques et sociaux : ce sont les droits emblématiques du pacte I de 1966, on les retrouve dans d’autres instruments, ce sont les droits à la sécurité sociale, droit au logement ou encore droit au travail ; ces droits sociaux et économiques étaient soutenus dans les années 1960 surtout par le bloc socialiste c’est pourquoi il y a eu deux pactes.
Dans le droit des Droits de l’Homme les obligations ne figurent pas, des juristes et des hommes de l’église regrettent qu’on ait oublié les devoirs, mais cela vient en fait de l’origine des Droits de l’Homme qui limitent l’intervention massive dans les sphères de libertés de l’individu afin d’assurer certaines libertés individuelles considérées comme essentielles parce qu’on se méfit de l’État autant à gauche qu’à droite, il y a des méfiances vis-à-vis de l’État, il y a des garanties de liberté et des contre-pouvoirs qui sont à ce moment-là des droits.
Nous utilisons ainsi le terme des obligations positives qui ne sont pas mentionnées dans les textes, il s’agit d’un développement jurisprudentiel, ce sont donc en d’autres termes, les tribunaux ou les comités qui ont développé peu à peu ces obligations positives greffées sur les dispositions contenues dans les textes.
L’obligation positive est toujours basée sur l’idée que pour donner un effet pratique aux Droits de l’Homme mentionné dans les textes, il est nécessaire que l’État s’abstienne d’intervenir dans la liberté de l’individu, mais aussi que l’État agisse pour protéger la liberté de l’individu.
L’obligation positive réinsérait une certaine dose de devoir d’action de l’État avec le souci de rendre le droit pratique et effectif parce que sinon il risquait d’être latéralement violé si bien que l’individu n’en bénéficierait suffisamment, en d’autres termes le droit ne serait pas suffisamment effectif. Ce qui est nécessaire pour donner une effectivité pratique au droit est considéré comme inhérent au droit.
Si un individu disparaît de manière suspecte et on le retrouve dans une condition physique ou psychologique précaire ou bien son cadavre, il y a une sorte de lacune, l’État pourrait s’engager dans des actes de torture parce qu’il bénéficierait du doute et il n’aurait pas le fardeau de la preuve ; les tribunaux ont développé que s’il y a un décès suspect il faut une enquête, examiner les signes « bizarres » sur le corps.
C’est une obligation positive de faire une enquête rattachée au droit contre la torture et au droit à la vie afin de donner plus d’effet à l’interdiction ou au droit garanti qui autrement pourrait être trop facilement donné ; le fardeau de la preuve retourne sur l’État et ensuite on voit dans le meilleur des cas.
Dans le cas de bombardement en Tchétchénie, la Cour raisonne en vertu du texte qu’il peut applique, à savoir la convention européenne des Droits de l’Homme, c’est l’article 2 qui l’intéresse qui est le droit à la vie ; l’obligation se situe dans la préparation de l’attaque, si les forces d’attaque ou de police n’ont pas une préparation suffisante, alors on considéra que l’État aura failli à préparer son intervention et donc le droit à la vie aura été violé.
Il aura été violé non pas par le fait d’ôter la vie, il y a une obligation par le fait que de préparer convenablement l’attaque aura été violée.
L’effet horizontal est une idée qui avait été défendue par quelque auteurs selon laquelle si les Droits de l’Homme et les droits fondamentaux dans une constitution étatique sont vraiment si importants qu’on le dit - fondamentaux parce qu’ils ont directement trait à la dignité humaine - alors ces auteurs concluent qu’il serait étrange que seul l’État à travers ses organes doive garantir les droits de l’homme et que les personnes privées dans la société ni soit pas tenu.
Des personnes privées doivent aussi dans le cas échéant garantir vis-à-vis d’autres personnes privées le respect des droits fondamentaux ; non seulement l’État y est tenu, mais aux vues de l’importance il faut que des entités privées y garantissent.
Aujourd’hui, on retrouve cette tendance avec la corporate responsibility, dans d’autres domaines il est très difficile d’appliquer cette idée.
Il y a une question de génération, on parle de la première, deuxième et troisième génération des Droits de l’Homme :
- première génération - droits classiques, civils et politiques - : l’État doit s’abstenir d’intervenir dans les sphères de liberté de l’individu, ce sont les droits classiques occidentaux soit la liberté de l’individu face à l’État
- deuxième génération - droits économiques, sociaux et culturels - : ils ont leur racine dans la révolution sociale de la fin du XIXème siècle début du XXème siècle, l’État à l’obligation vis-à-vis des plus faibles dans la société de prévoir des mécanismes de réajustement.
Il y a une tension entre la première et la deuxième génération, si l’État prend trop au sérieux la deuxième génération il peut tuer la première génération, il faut garder toujours un certain équilibre.
- troisième génération - droits collectifs qui ne sont généralement pas justiciables comme le droit à la paix - : c’est un droit programme qui a quelques effets juridiquement assez faibles, il peut y avoir des dispositions pénales qui interdisent la rhétorique de guerre ou certaines formes de haine vis-à-vis de l’étranger ; de telles légitimations pénales sont fondées sur l’idée qu’il faut favoriser l’entente entre les peuples soit sur l’idée qu’il y a un droit général à la paix.
Il y a en matière de Droits de l’Homme plus que partout ailleurs un volet juridique et politique, mais les deux sont moins séparés ici que dans les autres branches du droit international, car la question des Droits de l’Homme suscite des questions passionnées d’un côté comme de l’autre, les deux fondent les limites, il y a quelque part du militantisme qui crée une tendance par militantisme de dépasser la limite du droit et d’aller vers ce qu’ils estiment comme progressiste.
Cela donne lieu à des problèmes où l’on critique par exemple la Cour des Droits de l’Homme, on accuse la Cour de faire du militantisme et plus encore des membres individuels, il y a cette difficulté particulière que des contestataires des Droits de l’Homme appellent péjorativement le droit de l’hommisme qui serait la seule vérité existante.
C’est une matière où il y a des tensions particulièrement vives, même dans le droit humanitaire il n’y a pas ces mêmes lignes de fracture.
Il faut faire encore quelques remarques qui sont des points intéressants, voire importants, sur lesquels on fait souvent erreur.
Un individu ne peut jamais saisir la Cour parce qu’elle n’est ouverte qu’aux États à l’article 34 de son statut, cela ne veut pas dire qu’un individu ne peut pas porter une affaire devant la Cour, mais c’est son État qui devra le faire en vertu de son ressortissant.
Un individu peut au contraire saisir la Cour européenne des Droits de l’Homme qui rend des jugements contraignants. La Cour jusqu’à présent s’abstient, mais pas toujours, de demander à l’État de prendre des mesures spécifiques condamnant les États à des prestations financières.
Une erreur souvent faite est de penser que les droits accordés, comme la liberté morale ou d’opinion par exemple, soient quelque part intégralement garantis dans tous les cas et qu’on ne puisse pas les limiter, or cela est une erreur.
Il y a des exceptions qui valent pour tous les droits sauf pour la torture, dans la convention européenne des Droits de l’Homme on lit les droits garantis, mais qu’il est possible de limiter le droit pour un intérêt prépondérant, lorsqu’on limite ce droit de manière proportionnelle et qu’on n’entame pas son noyau fondamental.
Il est évident que tous ces droits ne peuvent être garantis dans l’ensemble et parce qu’ils se heurtent les uns aux autres, il est possible qu’il faille limiter le droit d’un tel contre un autre, par exemple le droit à la propriété ou l’État peut parfois exproprier ; lorsqu’il y a un intérêt public prépondérant et de façon proportionnelle il faut pour exproprier comme dans le cas précédent, dans certains pays la propagande guerrière n’est pas tolérée.
Il y a la possibilité de limiter les droits s’il y a un intérêt public prépondérant, mais ce genre de chose est contrôlé pour voir si cela est nécessaire.
En plus de cela, il y a la possibilité de suspendre certains droits fondamentaux et de les limiter en période de crise de l’État qui sont les périodes d’urgence – emergency situations – dans le cadre de conflit ou d’insurrections sur le territoire de l’État ; on appelle cela de la dérogation.
Les Droits de l’Homme sont éminemment contextuels, ce sont des droits qui sont contextuels relatifs, il y a des oppositions entre les Droits de l’Homme et des législations, c’est un jeu extrêmement complexe et il faut voir l’ensemble pour juger correctement de cette branche du droit.
On avance souvent l’argument que les Droits de l’Homme classique sont de souche occidentale et qu’il ne peut en réalité avoir des Droits de l’Homme universel, car c’est toujours une vision de la manière dont l’homme est dans la société, de la manière dont il interagit, il y a des réalités socioculturelles, on en conclut que de vrais droits universels n’existent pas vraiment et que leur sens concret et donné dans les États et les cultures diverses.
D’un côté, l’argument est vrai dans le sens où il faut éviter l’arrogance des États occidentaux, les Occidentaux sont des universalités, il est tout à fait évident qu’il y a des pensées diverses sur les rôles des personnes dans la société ; c’est la raison pour laquelle dans les organes des Nations-Unies les pays de l’occident sont minorisés. Soit c’est consensus et tout le monde est d’accord, s’il y a un vote à proprement parlé, nous sommes presque toujours en minorité, les pays des tiers-mondes ont d’autres priorités que les Droits de l’Homme comme les droits au développement.
L’autre partie de la réponse est qu’on ne serait allé trop lié, lorsqu’il s’agit de protéger les droits fondamentaux on retrouve des propositions fondamentales ; dans les droits civils classiques ont converge vers des positions qu’on estime difficile de ne pas être universelles.
Il faut éviter l’écueil que certaines personnes ont l’impression de dire que si on accorde plus de droits, si on multiplie les droits on va vers plus de progrès, de bien-être, que les Droits de l’Homme fonctionneront mieux.
Il faut se souvenir d’une vérité juridique élémentaire, on peut avoir une obligation qui pèse sur l’État de faire quelque chose sans que l’État ne soit obligé de faire quelque chose, mais on ne peut avoir de droit subjectif sans une obligation, car si personne n’était obligé, il serait dans l’apesanteur ; si on additionne des droits existants, la question est qui est titulaire de droits et des obligations supplémentaires.
La densité de la torture est une affaire difficile, nous allons nous en tenir à la Convention contre la torture de 1984 qui définit la torture.
- Quels sont les éléments de la torture en matière de torture ? Comment la torture ressort ?
Il y a tout d’abord un acte ou une omission intentionnelle, il n’y a donc pas de torture par erreur selon la manière dominante de construire la torture.
Dans une affaire autrichienne où quelqu’un a été enfermé dans une cellule et oublié pendant 15 jours dans une cellule, il n’y avait pas d’intention et donc pas de torture selon la définition.
L’objet matériel de la torture est l’infliction d’une douleur physique ou mentale infligée à un individu humain soit une douleur ou souffrance aigüe.
Il faut apprécier, il faut une appréciation qui se fait selon les circonstances, cela signifie que puisque la torture est basée sur un jugement et une appréciation de ce qui est aigu il n’y a pas de délimitation claire et nette de ce que constitue la torture et ce que constitue inhumain et ce qui constitue un traitement dégradant.
La souffrance aigüe peut être physique ou mentale comme forcer des personnes d’assister à la torture ou à l’assassinat de tous les membres de sa famille.
La torture doit être faite avec un but qui est décrit de manière assez circonvenue comme l’obtention d’information ou de confession ou de punition ou d’humiliation ou de coercition.
Une torture qui serait faite sans but ne correspond pas à une torture en matière de Droits de l’Homme, cela serait plutôt un acte d’infraction qui tomberait dans le domaine du Code pénal.
Enfin, pour le domaine des Droits de l’Homme, au moins l’une des personnes qui commet l’infliction doit être un agent de l’État ou au moins doit agir avec l’acquiescement d’agents de l’État, en d’autres termes il n’y a pas de torture en la présence de personnes privées.
Cette délimitation vient du fait que le droit des Droits de l’Homme et lié à la nécessité publique, il serait erroné de conclure si un agent de l’État n’est pas présent alors l’acte est licite, mais en réalité il tombe sous le compte du Code pénal qui protège l’intégrité physique.
La torture contre crime contre l’humanité comme crime de guerre ou comme génocide ne suppose pas qu’elle soit infligée par un agent de l’État dans le droit pénal ; l’affaire clef est l’affaire Kunarac de 2001 de la chambre de première instance.
Comme la torture ne prend que le premier pallié, ceux qui concèdent une souffrance ou une douleur aigüe, cela signifie qu’il y a des catégories plus basses parce qu’on souhaite protéger d’invasions qui apparaissent dans la Convention européenne de Droits de l’Homme à l’article 3 qui interdit les actes inhumains et les traitements dégradants.
Les traitements dégradants sont des traitements qui sont de nature à créer chez les victimes un sentiment de peur, d’angoisse et d’infériorité propre à les humilier ou à l’avilir.
Tout ce juge par le contexte.
Entre les deux, il y a le traitement inhumain qui est le moins bien défini, c’est un traitement qui cause des souffrances suffisamment vives du point de vue de l’individu qui les subit si bien qu’il y a une interdiction.
L’affaire Ortiz contre Guatemala de 1996 au niveau de la commission interaméricaine des Droits de l’Homme, il s’agit d’une sœur donc d’une religieuse qui était soupçonnée d’avoir des liens avec des subversifs, elle fut prélevée par des groupes paramilitaires et on lui a infligé des traitements de choix en commençant par la bruler avec des cigarettes, ensuite vint le viole, aux coups avec des objets divers, mais aussi avec les poings et enfin elle a été introduite dans un puits assez profond et infestée de cadavres et de rats.
Un traitement classique de torture et celle du sous-marin, ces personnes amassait des récipients remplis d’extrêmement, d’urine, de vomissement et de sperme ; on faisait plonger les personnes si bien que compulsivement on ouvre la bouche.
L’exemple classique est l’affaire Irlande contre Royaume-Uni de janvier 1978[1], époque où la relation entre le Royaume uni est l’Irlande du Nord était tendue ; les britanniques présents appliquent vis-à-vis du terrorisme de l’IRA des techniques d’interrogation.
Ces techniques étaient tout d’abord des personnes arrêtées à ce stade suspecté d’avoir des relations à l’IRA de rester pendant des heures debout contre un mur dans une position inconfortable, ensuite ces personnes étaient encapuchonnées pour qu’elles perdent le sens de l’environnement, puis les personnes étaient privées de sommeils qui tend le système nerveux puis ces personnes étaient soumise pendant des heures de la journée à un sifflement aigu et continu, enfin privation de nourriture et de boisson.
La Cour européenne des droits de l’homme a considéré qu’il s’agissait d’un traitement inhumain, mais pas de la torture.
Dans le traitement dégradant, il y avait différents exemples comme le plus classique qui sont les punitions corporelles, il y a des cas classiques comme l’affaire Tyers de 1978 série A numéro 26 ; il s’agit d’écoliers où il y avait des punitions corporelles par des coups de verge.
La Cour a estimé qu’en 1976 que cela était un traitement dégradant et que cette pratique était contraire à la coutume.
Dans l’affaire Raminen de 1997[2], il s’agissait d’un objecteur de conscience qui ne voulait faire le service militaire qui fut cueilli tôt le matin, menotté et emmené ; la Cour a estimé que pour un individu qui n’est pas violent, cette mise en scène aurait pu être beaucoup plus civile.
Les trois seuils, torture, traitements inhumains et traitements dégradants ne peuvent être définis de manière certaine parce qu’ils sont graduels et par conséquent la jurisprudence ou même des tribunaux pénaux mettent l’accent sur le caractère contextuel, c’est-à-dire qu’on ne peut définir de manière absolue ces seuils parce qu’ils dépendent de facteurs qui varient de cas en cas.
La Cour européenne des Droits de l’Homme dit que cela dépend de la nature et du contexte du traitement, de la modalité d’exécution, de la durée d’exécution, des effets physiques ou mentaux ou encore du sexe et de l’âge de la victime.
La jurisprudence pénale suggère qu’il faille parfois prendre en compte des facteurs culturels ou religieux, dans certaines sociétés le viol est terrible parce que c’est un déshonneur total comme dans l’affaire Limaj de 2005, chambre de première instance au paragraphe 237.
Ces infractions au pénal et qualifications en matière de Droits de l’Homme ont une certaine porosité parce qu’elles dépendent du contexte.
Le droit pénal international[modifier | modifier le wikicode]
L’aspect de la responsabilité pénale de l’individu, au XIXème siècle le droit international pénal se résumait à peu de choses en fonction du dogme dominant à l’époque selon lequel l’individu n’était pas sujet du droit international.
Au plan international il y avait la définition des crimes, mais la répression des crimes n’était pas l’affaire du droit international et il n’existait pas de tribunaux internationaux ;tout au plus définissait-on un crime et laissions la répression à un tribunal interne afin de poursuivre les crimes définis internationalement et introduits dans le code interne des États et dans les législations pénales.
Au XXème siècle, on s’est préoccupé d’avoir un régime plus développé, on a continué à définir des crimes, l’évolution est qu’on s’adjoint à la tradition : le droit international ne s’est plus borné à définir certains crimes, mais aussi s’est occupé à la répression.
Au XIXème siècle, les crimes définis internationalement étaient principalement des crimes privés comme la piraterie, la traite des esclaves. Les crimes du XXème siècle étaient des crimes souvent intensément politiques, c’est-à-dire l’État à travers ses organes les perpétuent comme les crimes de guerre, génocides et crime contre l’humanité.
La répression pouvait paraître insuffisant pour la seule raison que lorsque l’État commet lui-même ces crimes on ne peut s’attendre à ce que ce même État réprime ses propres dirigeants, par conséquent, il a fallu adjoindre aux organes nationaux défaillants des juridictions internationales.
C’est le fait de créer des juridictions internationales qui s’occupent de la répression des crimes où réside la nouveauté.
Du point de vue de l’individu, cela a un impact immédiat parce qu’il n’était pas sujet d’un droit pénal international tout simplement parce que le droit pénal du XIXème siècle était une affaire purement interétatique, les États se mettent d’accord sur la définition d’un crime soit sur le droit coutumier ou sur un traité : l’individu reste un sujet de droit interne.
Lorsque des tribunaux internationaux s’occupent de la répression de certains crimes, l’individu se trouve directement assujetti à la compétence pénale d’un tribunal international, il n’est plus sujet pénal du droit interne, mais aussi du droit international bien qu’il ne le soit qu’exceptionnellement quantitativement et qualitativement.
Quantitativement, peu de personnes ont été jugées devant un tribunal international depuis 1945, qualitativement c’est également restreint puisque les crimes passés devant un tribunal international sont sélectifs.
1945 est la défaite des forces de l’Axe y inclut le Japon, ce n’est pas sans précèdent dans l’histoire qu’on ait essayé de poursuivre des crimes internationaux, mais cela n’a pas abouti comme les procès de Leipzig. Après 1945 les conditions politiques étaient plus favorables, l’accord de Londres qui institue un tribunal international ouvre la voie aux procès internationaux.
Il y a eu quatre séries de procès dans l’après-guerre entre 1946 et 1949 :
- ceux devant le Tribunal militaire international qui est institué par un traité suite à l’accord de Londres de 1945 instaurant le statut du Tribunal militaire international, on retrouve la définition des crimes pour lequel le tribunal est compétent à l’article 6.
- le tribunal de Tokyo ou tribunal pénal pour l’Extrême-Orient est un tribunal qui fut instauré pour juger surtout les criminels de guerres japonais mais aussi pour juger ceux qui avaient organisé les agressions japonaises par exemple en Chine. Le tribunal pénal pour l’Extrême-Orient n’était pas juridiquement un tribunal international même si matériellement il l’était ; il n’a pas été instauré par un accord ou un acte juridique international équivalent. Le tribunal la de Tokyo a été instauré par un décret du général MacArthur qui était le commandant suprême des forces en Extrême-Orient, il avait la faculté selon le droit applicable soit de l’occupation militaire d’instaurer un tribunal : c’est un tribunal américain du point de vue formel, mais les États-Unis ne voulaient pas que ce soit un tribunal uniquement américain, ont été associés les autres alliés, et une série d’États victime d’agressions japonaises, le président était australien. C’est un tribunal qui a un statut fort différent de celui du tribunal militaire international de Nuremberg.
- il y a eu des tribunaux pénaux dans les zones d’occupation en Allemagne notamment dans la zone américaine au sud et la zone d’occupation britannique au nord ; les sièges des tribunaux pénaux américains étaient à Nuremberg si bien que des personnes confondent le Tribunal militaire international et le tribunal américain. Les tribunaux britanniques avaient leur siège à Hambourg, ce sont des tribunaux basés sur le droit de l’occupation. Ces tribunaux ont été instaurés et ont instruit des procès fort importants comme le tribunal américain de Nuremberg a jugé des personnes au moins aussi importantes que les personnes jugées devant le Grand Tribunal. Il y a ainsi eu les procès des médecins qui faisaient de expérimentations épouvantables, le procès du haut commandement de la Wehrmacht, les Schutzstaffel faisaient du nettoyage ethnique efficace à l’Est, parfois 30 à 40 milles personnes exécutées en une journée, ou alors les juristes du Reich ou encore le procès des politiques. C ’est toute une série de procès de la plus haute importance publié dans les manuels V et P. Les britanniques ont eu des procès avec moins d’éclat et les français n’avaient pas établie de tribunaux quant aux soviétiques, ils n’ont pas jugé les tribunaux, ils exécutaient directement. En occident il y avait des voix aussi pour une justice plus expéditive comme ce fut le cas des britanniques, c’est à cause du procureur américain Jackson et les liens qu’il avait avec le président Roosevelt qui est intervenu pour l’intervention d’un tribunal, c’est aux américains que nous devons l’approche légaliste avec Nuremberg.
- procès nationaux : il y a eu dans toute une série de pays des procès contre des collaborateurs, des criminels nazis ; les Pays-Bas ont souffert d’une occupation horrible et toute une série de criminels nazis a été jugée aux Pays-Bas qui ont instauré une juridiction spéciale avec une Cour de cassation spéciale.
Il faut prendre ensemble ces quatre cercles pour avoir le résultat du pénal après la Deuxième Guerre mondiale, c’est-à-dire la répression pénale qui s’est organisée dans ces couches.
Les juges du tribunal de Nuremberg étaient les juges des quatre alliés, ce qui est particulier est de mettre des soviétiques des américains, des britanniques et des français dans un même tribunal. Il y a 25 accusés, des acquittements et toute une série de condamnations à mort à l’autre bout du spectre, la peine de mort était alors concédée comme normale en cas de crime de guerre.
Les règles étaient constituées de règles du droit humain, sur les moyens et les méthodes de guerre ; le Tribunal militaire international a jugé également le crime contre la paix c’est-à-dire l’acte d’agression et enfin le tribunal avait compétence pour poursuivre les crimes contre l’humanité.
Pourquoi est-ce que le crime contre l’humanité a-t-il été inventé après la Deuxième guerre mondiale ?[modifier | modifier le wikicode]
Les crimes de guerre ne suffisaient pas sur un point décisif, les crimes de guerre sont la violation du droit et des coutumes de la guerre or le droit de la guerre protège fondamentalement les ressortissants ennemis lors du conflit armé, ce sont les militaires de la partie belligérante adverse qui sont protégés par les conventions, les civils de la partie adverse qui sont protégés contre des actes injustes diligentés par le belligérant ennemi.
Le droit de la guerre en revanche ne s’est jamais préoccupé de la manière dont l’État traite ses propres ressortissants, le droit des conflits armés s’occupe de ceux qui ont besoin de protection, ceux qui ont besoin de protection sont ceux qui peuvent souffrir d’injustices.
Du moment que ces personnes ont notre nationalité ou sont de nationalité cobelligérante, en fonction de cela il y a un crime de guerre ou pas et c’est cela qui a été considéré comme étant choquant que l’on puisse poursuivre parfois et parfois pas des actes de même gravité simplement en fonction du fait plus ou moins hasardeux que la victime ait une nationalité.
Le crime contre l’humanité a été inséré dans le statut du Tribunal militaire internationale pour répondre à cette lacune, la nationalité ne compte pas dans le cadre du crime contre l’humanité.
On a reproché au Tribunal militaire internationale d’être la justice du vainqueur et d’avoir réprimé des infractions nouvelles.
C’est la justice du vainqueur littéralement, les quatre alliés ont créé et composé ce tribunal, de ce point de vue formellement on appréciera le progrès accompli avec le Tribunal international aujourd’hui ; en revanche si on veut suggérer que c’était un tribunal des vainqueurs et que la justice internationale a été biaisée, le témoignage historique parle clairement, ce sont des procès où des standards ont été sauvés.
Sur les accusés principaux il y a eu des acquittements, la procédure a été d’une contradictoire tout à fait exemplaire, les alliés se sont même abstenu d’incriminer des actes qui étaient pourtant des crimes de guerre lorsqu’ils savaient qu’ils n’avaient pas été entièrement propres en la matière. Par exemple, on ne trouve pas de poursuites pour des bombardements de terreur pour la simple raison que les alliés eux-mêmes avaient procédé à de tels bombardements.
Dans l’ensemble, c’est une justice du vainqueur, mais matériellement, les standards les plus élevés ont été maintenus, Jackson y a veillé personnellement, les gens qui étaient là avaient une certaine opinion et une certaine attention sur l’importance historique de ce moment et sur le fait qu’ils seraient jugés plus tard pour ces jugements.
Il y a des incriminations rétroactives, l’agression n’était pas clairement prohibée avant 1945, ces interdictions ne relevaient pas du droit pénal, l’interdiction et l’obligation ne de pas utiliser la force donne lieu à une répression pénale individuelle, le crime contre l’humanité est une nouvelle incrimination : « nullum crime sine lege, lege praevia ».
Là aussi il y a une certaine défaillance à Nuremberg qui doit être traité, le crime contre l’humanité a été essayé d’être temporisé devant être commis dans le contexte d’un conflit armé, un crime contre l’humanité ne pouvait être poursuivi par le tribunal s’il n’était pas lié au conflit armé : on a voulu maintenir un lien entre le crime contre l’humanité et les crimes de guerre commis dans le contexte d’un conflit armé.
Il ne fut possible qu’il en fut autrement, il y a toujours un précédent dans le droit coutumier, toutefois il ne fait pas de doute que ces crimes étaient punissables d’après tous les codes internes existants de tous les pays, on a simplement pris certaines libertés, la créativité a été un peu plus grande dans le crime d’agression.
Après 1945, il y a une longue pose concernant les tribunaux pénaux. Entre 1949 qui sont les derniers procès dans les zones d’occupation et 1993 est surtout du travail normatif et de répression nationale au niveau interne. En 1948 avec la Convention internationale contre le Génocide apparaît un nouveau crime, à Nuremberg n’apparaît aucune condamnation pour génocide, notion non définie à l’époque.
Les crimes contre les juifs n’ont pas été poursuivis pour génocide à Nuremberg, le sous-chef est la persécution qui a tenu lieu d’incrimination de génocide alors que l’incrimination pour génocide n’était pas définie.
Lorsqu’on parle du génocide arménien, il y a matériellement des éléments de génocide, formellement le crime n’existait pas en 1921, 1922 et 1923 : du point de vue juridique il n’y a pas d’incrimination, historique il y a génocide.
Ensuite, c’est à l’Assemblée générale et à la Commission du Droit international que le droit international a été porté, tout d’abord à l’Assemblée générale qui a donné à ces principes une extension universelle, ensuite c’est la Commission du Droit international qui s’est occupé pendant de longues années de codifier le Code pénal international qui était le projet d’un code des crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité qui a commencé dans les années 1950 et a dû être arrêté en 1960 parce qu’il y eut un problème sur la définition de l’agression.
Les années 1990 sont bien une décennie du droit international pénal et des tribunaux pénaux, c’est tellement vrai que tout le monde dans la doctrine écrit sur ce sujet.
Le Tribunal pénal pour l’ex-Yougoslavie et le Tribunal pénal pour le Rwanda ont été créés par le Conseil de Sécurité selon une compétence donnée par la Charte des Nations-Unies. On retrouve ces compétences au chapitre VII de la Charte qui permet au Conseil de Sécurité de prendre, lorsque la paix et la sécurité internationale sont en cause, des mesures contraignantes ; ainsi on peut créer rapidement un tribunal international à compétences coercitives pour les États membres qui peuvent le créer par une décision et le revêtir d’une compétence obligatoire.
La seule alternative viable était de passer par le Conseil de Sécurité qui est le seul organe pouvant prendre une décision.
Ces deux tribunaux sont appelés des tribunaux ad hoc créé dans un cadre particulier par une résolution, 808 pour l’ex-Yougoslave et la 855 pour le Rwanda ; il y a eu encore un ou un tribunal ad hoc fut créé qui est le Tribunal pour le Liban ou un juge de Genève, Robert Roth siégea[3].
Ce tribunal est aussi une création du Conseil de Sécurité en vertu du chapitre VII avec la particularité que le gouvernement libanais a demandé lui-même au Conseil de Sécurité de créer ce tribunal parce que le gouvernement libanais ne pensait pas avoir du parlement la possibilité de poursuivre certains attentats commis dans cette période.
La particularité de ce tribunal est qu’il y a eu l’incrimination de certains crimes selon le Code pénal libanais, matériellement c’est un tribunal particulier, formellement c’est un tribunal ad hoc créé par une résolution du Conseil de Sécurité.
Il y a aussi les tribunaux dits « hybrides » ou « mixtes », parfois il s’agit de chambres internationales insérées dans le système pénal interne comme dans le cas du système judiciaire du Cambodge, le plus célèbre des tribunaux hybride et le tribunal pénal pour la Sierra Leone qui a rendu un tas de jugements sur des matières différentes notamment des arrêts importants en matière d’enfant-soldat.
Le tribunal Sierra Leone est un tribunal hybride parce qu’il n’a pas été créé par une résolution contraignante du Conseil de Sécurité, mais par les Nations-Unies et l’État en cause.
C’est donc sur un accord entre les Nations-Unies est l’État concerné que sont établis les tribunaux mixtes et non pas sur une résolution contraignante du Conseil de Sécurité, ce la signifie aussi que les mesures de ces tribunaux ne s’imposent pas de la même manière à tous les États membres.
Pourquoi a-t-on créé une série de tribunaux ou de chambre de type hybride/mixte ?[modifier | modifier le wikicode]
Il y a tout un tas de raisons qui ne sont pas juridiques ou exclusivement juridiques que des motifs d’opportunité, de prudence, de bonne gestion, etc.
Dans les tribunaux mixtes, il y a une représentation à la fois internationale et locale, il y a des juges locaux et des juges internationaux, c’est mixte du point de vue de la composition et des procédures appliquées, cela a été vu comme une possibilité d’engager l’État local dans un processus légal, de former du personnel, de permettre au système local d’évoluer.
On a estimé que l’enrôlement de l’État local été d’une nature à faire progresser le système judiciaire local.
Il y avait aussi des problèmes financiers avec les tribunaux ad hoc, à la moitié des années 1990 les Nations-Unies rencontraient des problèmes budgétaires. Toutefois, ce n’est pas imputé automatiquement au budget des Nations-Unies.
Il y a la possibilité d’engager plus facilement la Chine et la Russie qui devenaient critiques vis-à-vis des tribunaux ad hoc et d’avoir un consentement plus facile, après tout la Sierra Leone a consenti, c’est la raison pour laquelle il a été possible de créer le tribunal du Liban.
La Cour Pénale Internationale est le dernier maillon du point de vue idéal, c’est un tribunal permanent, une Cour, on appelle Cour un tribunal permanent en droit international.
La Cour Pénal Internationale était l’idée, de la rencontre, des organisations non gouvernementales, et de toute une série d’États, d’extraire la sécurité internationale des mains des cinq puissances du Conseil de Sécurité ; il est évident que pour la Yougoslavie ou le Rwanda on peut introduire un tribunal ad hoc.
C’était la préoccupation d’avoir une Cour permanente organisée d’avance et non pas créée au cas par cas, d’avoir une Cour institutionnelle qui fonctionne sur des règles égales et qui ne soit pas une juridiction d’exception manipulée au cas par cas.
La Cour a été créée par une conférence à Rome en 1998, le statut fut adopté suite à des négociations longues et ardues, jamais auparavant une conférence n’avait été le fait d’autant d’États et d’organisations non gouvernementales, ces dernières ont été très présente à Rome dont le Comité international de la Croix Rouge.
Le statut de la Cour de Rome est entré en vigueur en juillet 2002 suite à 60 ratifications et un certain délai, le 11 mars 2003 la Cour a commencé à fonctionner.
Ce fonctionnement de la Cour a jusqu’à présent été assez difficile : la Cour n’a rendu à ce jour que 2 arrêts, elle a instruit des affaires, mais les problèmes se sont présentés soit parce qu’elle n’avait pas assez de pouvoir de forcer des personnes à comparaître devant elle, soit parce que les procédures durent et sont lourdes, soit parce que cela est trop coûteux. La juridiction est trop nouvelle pour être jugée à ce stade, mais il est vrai qu’il y a des problèmes structurels, elle est encore beaucoup trop influencée par la procédure anglo-saxonne qui est mal adaptée.
Par exemple le tribunal pour l’ex-Yougoslavie coûtait de 10 à 15 fois selon les années plus que la Cour International de Justice ; dans l’ensemble l’expérience valait d’être tentée.
Quel est l’organigramme de la Cour ?[modifier | modifier le wikicode]
Il y a une série d’organes, chacun avec des fonctions qui lui sont propres, il y a comme dans tout tribunal en grief registry qui est l’administration du tribunal qui fait tous les actes administratifs, fait des dossiers, s’occupe de la traduction, reçoit les pièces, fait des statistiques, fait la correspondance, tout cela est a l’article 43 du statut.
Il y a un bureau avec le procureur ; ces fonctions sont décrites à l’article 42 du statut, il instruit à charge et en principe à décharge.
Ensuite il y a la section préliminaire, les pouvoirs sont précisés aux articles 56 et suivants ; c’est un organe assez particulier, il doit confirmer les charges du procureur ou les rejeter dans certains cas. C’est un organe intercalé.
Il y a la section de première instance – trial division – ce sont les différentes chambres devant lesquels se déroule les procès, tout se passe en première instance.
Enfin il y a la section d’appel qui sont les chambres du tribunal pour les appels interjetés contre les décisions de première instance et aussi pour certaines autres décisions d’une certaine importance comme des appels relatifs aux décisions du procureur comme admettre ou ne pas admettre de preuve, il y a la possibilité de faire appel a certains actes du procureur.
Quelles sont les compétences de la Cour Internationale ?[modifier | modifier le wikicode]
La réponse se trouve dans les articles 5 à 8 et désormais 8 bis du statut. Pour l’article d’agression, il faut lire l’article 8bis inséré dans la conférence de Kampala en 2010.
Il faut remarquer qu’il y a des absences notables comme les crimes de terrorisme, cela ne veut pas dire que les actes de terrorisme ne peuvent être poursuit, un acte qui induit la terreur peut être induit comme crime de guerre dans le cas de conflit ; il n’y a pas définition généralement acceptée du terrorisme toutefois on continue à se disputer diplomatiquement sur certains aspects de cette définition comme les guerres de libération nationale.
Un autre problème traditionnel est le terrorisme d’État, pour certains l’État ne peut jamais commettre un acte de terrorisme pour d’autre cela est possible lorsqu’il recourt à la terreur. Pour Israël le terrorisme d’État n’existe pas, il n’y a pas de notion juridique.
En dernier lieu sur les compétences partielles il faut signaler l’article 22 dans les statuts de la Cour qui institue le principe de nullum crime sine lege qui est le principe de la légalité, le statut prévoit dans cette disposition que ne pourront être poursuivis que des crimes qui ont trouvé leur place dans le statut.
Il faut regarder dans l’article 7, article 8, toutes les incriminations, si une infraction ne se trouve pas codifiée dans le statut, la Cour ne peut pas la poursuivre ; le terrorisme n’est pas dans le champ de la compétence de la Cour, mais un crime de guerre pourrait exister même s’il n’est pas spécifiquement mentionné dans la liste. Si on peut déterminer qu’il y existe un crime de guerre en droit coutumier, la Cour ne pourrait pas poursuivre, il faut que le crime soit explicitement mentionné dans le statut.
Cela n’est pas valable pour le Tribunal pénal de l’ex-Yougoslavie et du Rwanda, les crimes ne sont pas limités aux crimes définis dans les statuts, le tribunal pour l’ex-Yougoslavie prend en compte des crimes relevant du droit coutumier.
Cette vision stricte du statut relève de l’article 22.
Pour quelle période temporelle la Cour peut être compétente ? Quand les crimes doivent-ils avoir été commis ?[modifier | modifier le wikicode]
L’information pertinente se trouve dans l’article 11, la grande règle est la non-rétroactivité.
Cette règle renvoie au droit international pénal, cette non-rétroactivité est ressortie également en droit des traités puisque le statut de la Cour Pénale Internationale et un traité et les traités ne s’appliquent pas rétroactivement à l’article 28 de la Convention de Vienne.
- Que-ce que cet article signifie dans le cadre de la Cour Pénale Internationale ?
La Cour ne peut poursuivre des crimes commis avant le 1er juillet 2002 lorsque le statut entre en vigueur, la date ou le statut enter en vigueur coïncide avec le 1er juillet 2002, mais comme c’est un traité il y a des États qui ont adhéré à ce statut plus tard, pour ces États l’entrée en vigueur du statut est une date plus tardive, une date à laquelle le traité entre en vigueur pour eux, il faut donc vérifier par rapport à ces États-là lorsque leur territoire est en cause ou leur ressortissant est en cause.
Il y a des discussions intéressantes sur la faculté à renoncer au principe de rétroactivité ; la doctrine accepte par exemple qu’un État puisse se soumettre à la compétence de la Cour pour des actes qui seraient commis avant la date d’entrée en vigueur pour lui, mais après le 1er juillet 2002.
Si l’État X a ratifié le statut de la Cour en 2008, entrée en vigueur le 1er juillet 2008, l’État pourrait signaler à la Cour qu’il accepte sa compétence pour un acte commis précédemment.
- Pourquoi cet argument qui peut paraitre relativement particulier ?
C’est une conclusion que la doctrine tire à contrario de l’article 12.3 ; un État pas lié par le statut peut accepter la compétence de la Cour, il serait singulier qu’un État non membre au statut puisse en faire plus qu’un État lié au statut.
Si l’État non parti peut accepter la compétence de la Cour avant 2002, un État parti doit pouvoir en faire tout autant.
Il faut distinguer la non-rétroactivité par rapport au crime et la non-rétroactivité par l’organe qui les juge, la seule rétroactivité dont il s’agit est la rétroactivité par un organe c’est-à-dire la compétence de la Cour de pouvoir juger ces crimes, cela ne contraint pas au droit pénal.
Il existe également certaines exceptions à la non-rétroactivité, il peut y avoir des crimes continus par exemple si on détient illégalement une personne ou si on la fait disparaître est un crime continu, tant qu’on la détient illicitement.
- Que se passe-t-il s’il y a une détention arbitraire qui commence en 2001 et se poursuit en 2002 et 2003 ?
Il y a une infraction commise dans une tranche temporelle où la Cour a les compétences et il y a une fraction où la Cour n’a pas les compétences pour l’autre fraction temporelle.
La nature d’exception et les éléments de preuve, dans le crime de génocide il faut prouver une intention spéciale de détruire en tout ou en partie un groupe national ethnique, racial ou religieux, il faut établir une intention spéciale ; on établit une intention par des preuves circonstancielles, il ne serait pas contraire au principe de non-rétroactivité d’établir l’intention en se fondant aussi sur les éléments du prédateur.
Les éléments de preuve qui permettent de prouver tel ou tel élément de crime peuvent être ramassés sur une tranche temporelle plus large.
La première remarque à propos de la compétence spatiale et personnelle, aussi singulier, étonnant, extraordinaire que cela puisse paraître, ne jouit pas d’une compétence universelle ; en d’autres termes les États pris individuellement peuvent posséder une compétence universelle alors que la Cour Pénale Internationale qui serait plus logiquement désignée pour exercer cette compétence n’en possède pas.
Cela revient à dire que la Cour ne possède la compétence que dans certaines situations déterminées lorsque certains liens existent, ils sont de trois types :
- la Cour est compétente en vertu du principe de territorialité : lorsqu’un État a ratifié le statut de la Cour Pénale Internationale ou lorsqu’il y a adhéré, tous les crimes qui tombent sous la compétence matérielle de la Cour tombent dans la compétence de la Cour Pénale Internationale.
- la Cour Pénale Internationale est compétente du point de vue de la personnalité active : pour les États qui ont ratifié le statut ou qui ont adhéré, tout ressortissant d’un État parti lorsqu’il commet un crime tombant sous la compétence de la Cour Pénale Internationale, la Cour Pénale Internationale est compétente. Des États non partis moyennant une reconnaissance ad hoc peuvent se soumettre à la compétence de la Cour Pénale Internationale pouvant reconnaître que pour certains crimes ou des situations entières sur le territoire ou des crimes ou situations pour lesquels leur ressortissant aurait commis des crimes répressible et soumis à la compétence de la Cour. L’État a un certain choix en vertu de l’article 12.3 permettant un élargissement de compétence.
- saisine par le Conseil de Sécurité : cela constitue une base de compétence autonome, cela signifie que le Conseil de Sécurité lorsqu’il saisit la Cour Pénale Internationale crée par ce même fait la compétence de cette Cour Pénale en vertu de l’article 13 du Statut devant reposer sur une résolution en vertu du chapitre VII de la Charte. Cette résolution adoptée sur la base des articles 39 et suivant et sur la base de la Charte fonde la compétence en vertu du statut de la Cour Pénale Internationale est le seul texte qui fonde une compétence de cette Cour. La particularité de cette capacité de saisissement résulte dans le fait qu’elle soit contraignante, devenant opposable à tous les membres de Nations-Unies y compris aux États qui n’ont pas ratifié ou adhéré au statut. Les membres des Nations-Unies sont tenus en vertu des articles 25 et 103.
On remarque qu’il n’y a pas la personnalité passive, la grande absente est aussi la compétence universelle.
La compétence de la Cour est automatique, il ne faut aucun autre acte pour que la compétence de la Cour soit établie, il suffit que le crime se soit passé sur le territoire d’un État ayant ratifié le statut.
En cas de contestation de la compétence de la Cour ; il peut y avoir des cas ou la compétence n’est pas certaine notamment dans le cas de la compétence temporelle ou de savoir si un ressortissant est bien de tel ou tel État ; la règle générale est que la Cour décide, cette règle se trouve mentionnée dans le statut à l’article 19. En cas de contestation de compétence, le tribunal saisi doit pouvoir décider de sa compétence.
Les mécanismes de saisine de la Cour Pénale Internationale n’est pas la même chose que la compétence, savoir qui peut la saisir et selon quelle modalité n’est pas identique même si à propos du Conseil de Sécurité les deux aspects convergent puisque la saisine vaut titre de compétence.
Les mécanismes de saisine de la Cour pénale internationale, qui peut la saisir, ces mécanismes sont prévus aux articles 13, 14 et 17, on voit apparaître trois mécanismes de saisine.
- un État partie au statut de la Cour Pénale Internationale peut déférer une situation au procureur : un État ayant ratifié ou adhéré au statut, peut saisir la CPI. Il peut le faire à propos d’une situation uniquement et non pas d’un crime ; la situation est définie dans le statut de la CPI comme une situation où un ou plusieurs crimes peuvent avoir été commis, crimes qui relèvent de la compétence de la Cour bien entendu. C’est donc un ensemble, un complexe une situation, un contenant, un ensemble d’évènements qui se caractérisent par la commission d’un ou de plusieurs crimes présumés à ce stade ; on exclut a contrario qu’un État puisse saisir la Cour à propos d’un crime particulier ou de plusieurs crimes particuliers, il doit saisir la Cour sur l’ensemble de la situation. Il faut soumettre le paquet, la situation d’ensemble, c’est à la Cour ensuite, à savoir le procureur, quel dossier il peut instruire ; on ne souhaite pas que les États puissent manipuler. Les États partis peuvent soumettre des situations qui les concernent eux-mêmes soit soumettre des situations qui soumettent d’autres États-parties. Pensait-on sans doute que les États signaleraient des situations chez les autres. Les États ont signalé surtout des situations sur leur territoire, ils se sont d’une certaine manière défaussés sur La Haye. Pendant de nombreuses années, les États africains qui ont soumis des cas à la Cour l’on fait selon le self-differ, cela renvoie à l’article 14.
- situation que peut déférer à la Cour Pénale Internationale le Conseil de Sécurité : le Conseil de Sécurité peut saisir la Cour valant pour titre de compétence, mais restant à la base un mécanisme de saisi, le Conseil peut saisir sur la base du chapitre VII et l’article 13.d du statut de la Cour dans un cas ou un crime semble avoir été commis.
- la Cour peut être saisie également par le procureur : le procureur peut d’office, proprio motu, ouvrir une enquête, article 13.c ; il peut estimer que quelque part dans un État où à propos d’une situation pour laquelle la Cour est compétente, il y a lieu de lancer une enquête, et le procureur peut le faire tant en ce qui concerne une situation, mais il peut le faire également à propos d’un ou plusieurs crimes, le procureur est le seul qui n’est pas obligé d’instruire à propos d’une situation, mais à propos de tel ou tel crime. On lui permet une sélectivité, car on a plus confiance que le procureur agira non seulement en fonction de son éthique professionnelle, mais aussi pour des raisons de fond et non pas politique. À Rome lors de la négociation pour le statut toute une série d’États été réservé d’ouvrir de sa propre initiative une enquête, on craignait des procureurs trop courageux, gênants, politisés qui ouvriraient des enquêtes de manière fort mal venue là ou les États ne le souhaitent pas ; ce fut pour beaucoup d’États un épouvantail de taille, c’est pourquoi on a essayé de limiter le plus possible le pouvoir du procureur pour faire en sorte qu’il ne puisse pas prendre un effort malvenu. Le procureur doit se faire avaliser les charges qu’il souhaite se faire retenir par la Chambre préliminaire qui sert à avaliser les charges du procureur lorsque celui-ci ouvre une enquête par lui-même, les États membres voulaient limiter l’action du procureur.
Il faut signaler la présence de l’article 16 dans le statut de la CPI qui est un article majeur à l’opposition au procès, inséré dans une espèce de contre compensation conte l’octroie au procureur de diligenter des enquêtes d’office. Cela faisait peur à beaucoup d’États notamment les États puissants, ses autres moyens sont un obstacle politique.
En d’autres termes, le Conseil de Sécurité ne peut pas seulement saisir la Cour en vertu de l’article 13.b et lancer une nouvelle procédure, mais il peut faire aussi le contraire, il peut bloquer, geler une procédure. Cette motivation octroyée au Conseil était de dire que parfois des enquêtes pénales peuvent déranger le Conseil de Sécurité lorsqu’il est dans une phase critique, lorsque celui-ci s’efforce de ramener la paix. Le Conseil de Sécurité doit se confronter à des pays en conflits armés, pour ramener la paix il y faut des discussions difficiles parfois avec des personnes peu recommandables ; des enquêtes de la CPI ou des enquêtes peuvent pourrir le processus et mettre en danger le retour vers la paix, c’est pourquoi on a estimé que le Conseil de Sécurité ne peut dessaisir la compétence de la Cour, mais la geler, il y une primauté du maintien de la paix sur la justice pénale en vertu de l’article 16.
Le seul cas jusqu’à présent dans lequel l’article 16 a été invoqué avec succès est un cas ou il n’aurait pas du être utilisé parce qu’il s’agissait d’un chantage d’un membre du Conseil de Sécurité pour obtenir un avantage : c’est la résolution 1422 de l’année 2002 où les États-Unis ont obtenu une immunité totale complète de leur personnel vis-à-vis de la CPI, les américains ont dit que si cette résolution n’était pas votée, il ne participerait plus à des opérations de maintien de la paix.
Il suffit que tel ou tel de ces États ait ratifié le statut de la Cour et que les forces américaines soient prises dans la compétence de la Cour en vertu du principe de territorialité, voilà pourquoi les États-Unis on obtenu ce qu’il voulait, chose renouvelée en 2007.
Le principe de complémentarité et de subsidiarité est de haute importance ; contrairement à d’autres tribunaux internationaux, la Cour Pénale Internationale n’a qu’une compétence subsidiaire aux autres États, le but idéal est que la Cour ne soit pas nécessaire, mais qu’au contraire les États membres prennent l’initiative d’insérer dans leur droit interne les infractions à poursuivre et qu’ils organisent leur système pénal en interne pour poursuivre ces infractions en interne.
Ce sont les États qui doivent exercer leurs compétences et on veut les stimuler.
On retrouve ce principe de complémentarité énoncée dans plusieurs places du statut notamment dans le préambule § 4 et §6 et à l’article 1.
- Quelle est la raison de la règle ?
La première raison est pragmatique, la Cour Pénale Internationale ne peut instruire toutes les affaires dans le monde ; on ne peut concevoir la chose autre que selon la subsidiarité.
La seconde raison est que la justice locale est souvent meilleure que la justice lointaine ; un tribunal local est toujours mieux armé, c’est une justice plus proche et une justice où il est possible de faire davantage confiance du point de vue culturel. En principe on souhaite que la justice puisse être fait par les acteurs.
Il faut essayer "to empower" la justice locale, il n’y a pas lieu de la court-circuiter immédiatement ; si la justice n’est pas incapable, il n’y a pas de raisons de remplacer telle ou telle capitale par La Haye, siège de la CPI. L’exception à la règle de la subsidiarité est en vertu du chapitre VII de la Charte ; quand le Conseil de Sécurité saisit, c’est qu’il saisit la Cour, il y a primauté de la Cour Pénale Internationale lorsque le Conseil la saisit sur la base d’une résolution chapitre VII.
Le contenu de la règle de complémentarité est relativement facile dans ses fondements, les difficultés tournent autour de l’interprétation de certains termes ; lorsque la Cour est saisie d’une situation ou lorsque le procureur instruit un crime particulier – jusqu’à présent le procureur n’a pas eu à ouvrir d’enquête d’office -, le procureur informe les États partis, mais aussi les États tiers lorsqu’ils ont des liens avec la compétence leur donnant la possibilité d’instruire eux-mêmes cette affaire.
Il y a un délai, mais qui n’est pas de droit strict, ce délai est d’un mois après la notification à l’article 18 du statut.
Si un État parti ou non parti, sollicité par l’information, décide d’attraire l’affaire vers lui, le procureur y défaire, il donne la priorité à l’État en cause, mais reste saisi de l’affaire, le procureur se tient informé devant les tribunaux nationaux compétents, et s’il estime que certaines conditions sont réunies, il peut attraite l’affaire vers la Cour Pénale Internationale
Quelles sont les affaires qui permettent au procureur d’attirer les affaires vers la CPI ?[modifier | modifier le wikicode]
On les retrouve à l’article 17, il s’agit d’un côté d’une absence de volonté de l’État de poursuivre unwilling et de l’autre l’incapacité de l’État à poursuivre « unable ».
Ces deux paramètres n’ont pas encore reçu d’interprétation ; la Libye actuellement réclame la priorité en estimant qu’il est parfaitement capable et volontaire de faire un procès en Libye. La CPI a des doutes considérables.
Le terme unwilling, donc l’absence de volonté de poursuivre, se manifeste par exemple lorsque les procédures nationales ne sont qu’une espèce de paravent pour abriter une personne d’une poursuite réelle, des simulacres de procédures : ce sont les retards justifiés de procédure, lorsque le procès s’éternise, tant est si bien que selon les cas, ils peuvent aussi se prescrire, dans certain pays des crimes sont prescriptible dans d’autres, imprescriptibles.
L’incapacité de poursuivre s’articule plus autour de raisons objectives, on pense ici notamment à des situations d’État en déliquescences lorsqu’après une guerre civile tout le système judiciaire s’est effondré et que cela prendra un certain temps pour le reconstruire ; un État n’est pas en mesure d’instruire un procès ou d’assurer son équité. Une autre raison serait l’obstacle de lois d’amnistie en vigueur qui empêche objectivement pour des raisons juridiques les tribunaux internes puissent poursuivre soit en totalité ou soit en partie.
Le procureur doit juger et évaluer une situation en fonction de ses informations jusqu’à y compris après la sentence rendue.
Il est possible que l’artificialité n’apparaisse qu’après le jugement rendu, la procédure peut être simulée lorsque la peine infligée est complètement dérisoire.
On peut condamner une personne selon une procédure rapide et qui semble être impartiale et indépendante, mais quelques semaines après la peine une grâce intervient et la personne est libérée ; il pourrait apparaître après coup que la procédure n’était qu’un simulacre.
La Cour jusqu’à présent a rendu deux arrêts de forme en dix ans d’existence, mais elle est saisie de toute une série de situations : situation en Ouganda ou le procès est en cours devant l’une des chambres, la situation relative à la République démocratique du Congo où a déjà eu lieu un jugement, la situation au Darfour, au Soudan, la situation dans la République Centrafricaine, la situation du Kenya, la situation en Libye ou le Conseil de Sécurité en 2011 a saisi la Cour, la situation en Côte d’Ivoire et la situation au Mali.
Le travail de la Cour Pénale Internationale est basé avant tout et surtout sur la coopération entre les États, elle n’a aucune force de police afin d’arrêter les suspects, elle n’a aucun moyen de contraindre directement les États sauf signaler au Conseil de Sécurité des problèmes de coopération ; sans la coopération des États, la Cour n’est au fond rien.
Cela peut paraître décevant, mais c’est une réalité du fait qu’au niveau international nous n’avons pas de force exécutive. La collaboration des États est capitale, on le retrouve au niveau de la distribution du travail, et il faut la coopération entre les États membres.
Enfin, la Cour Pénale Internationale est basée sur un accord en portant toutes les traces et les stigmates : la Cour n’est pas là et ne peut pas être là pour instruire sur une base d’égalité parfaite sur tous les crimes commis dans le monde.
Cela est régulier concernant la base conventionnelle de la Cour, en tout premier lieu la Cour n’est pas omnicompétence, cela est dû au fait que le droit des traités est ainsi fait, le traité s’applique aux États qui l’ont ratifié, qui plus est il y a des mécanismes de saisis, des crimes peuvent être commis, mais si la Cour n’est pas saisie rien ne se passera.
La Cour apporte quelque chose par la sensibilisation des États, mais les lacunes et les inégalités qui subsistent sont le fait de sa nature qui est une nature conventionnelle.
Il faut juger la Cour par rapport aux réalisations qui sont possiblement les siennes, mais il ne faut pas la juger et la condamner pour des raisons qui ne peuvent être les siennes à cause de la limite statutaire.
Où est-ce que le génocide est régimenté ?[modifier | modifier le wikicode]
Le génocide est l’un des crimes qui tombe dans la compétence de la Cour Pénale Internationale.
D’abord, les aspects généraux, tout d’abord, où est-ce que le génocide est régimenté ? On trouve ce crime mentionné est défini à l’article 6 du statut de la CPI, mais aussi dans l’article 4 du tribunal pénal pour l’ex-Yougoslavie.
La définition est rigoureusement identique dans tous les textes, car elle est reprise de l’article 2 de la Convention contre le Génocide de 1948 ; ce n’est pas le cas pour la notion de crime contre l’humanité rendant la situation beaucoup plus difficile du point de vue juridique et marquant l’évolutivité du crime du point de vue du droit coutumier.
Quant à l’objet du crime si on devait faire une fiche signalétique, dire ce qui fait la particularité intime du crime de génocide est l’aspect suivant : le crime de génocide se caractérise par la volonté du perpétuateur du crime de détruire des groupes humains entiers.
On nie la possibilité et le droit d’existence à des groupes humains entiers que l’on souhaite éradiquer dans une approche qui est basée sur la dépersonnalisation, on ne voit plus les individus comme des individus dans leur particularité, mais dans leur numéro de matricule que l’on souhaite éradiquer.
Il y a parfois une logique de cheptel dans le crime de génocide : on considère quelque part ces personnes d’un groupe déterminé comme du cheptel que l’on doit mener à l’abattoir.
Ce qui définit le profile juridique du crime, il y a trois grands éléments du crime de génocide :
- c’est une série d’actes prohibés.
- il ne faut pas commettre ces crimes contre des groupes protégés.
- intention de détruire en tout ou en partie un ou plusieurs de ces groupes : l’auteur des actes en cause à travers ces actes doit vouloir détruire en tout ou en partie un groupe protégé, c’est une question de représentation mentale.
Dans le droit pénal, la distinction clef en matière d’infraction est d’un côté l’élément constitutif objectif et de l’autre l’élément constitutif subjectif. Pour prononcer une sentence de condamnation, il faut toujours vérifier que sur une sanction déterminée que ces deux éléments aient été réalisés. Par exemple, pour ce qui concerne le vol il y a une série d’éléments constitutifs objectifs comme le fait qu’il faut s’approprier une chose matérielle qui appartient à autrui. Il y a aussi un élément subjectif qui est la volonté de s’approprier la chose et la représentation que la chose est celle appartenant à un autre. Si on ne se représente pas que la chose appartient à un autre dans l’élément subjectif on ne peut commettre un vol.
Les éléments objectifs ne sont que des conditions, il faut en plus un élément constitutif subjectif fait de connaissance et de volonté.
En terme bref, l’objectif est ce que l’on voit, dans l’homicide c’est assister à la mort de quelqu’un assistant à la scène.
Il y a certains actes prohibés et groupes protégés, simplement il y a un élément essentiel qui est l’intention de détruire. Si on ne parvient pas à déterminer l’intention il n’y a qu’une négligence, c’est au procureur d’établir l’intention est pour cela il doit se fonder sur des indices.
Il y a quatre groupes protégés contre le génocide :
- groupes nationaux ;
- groupes ethniques ;
- groupes raciaux ;
- groupe religieux.
Le groupe national a toujours été entendu dans la jurisprudence des tribunaux pénaux comme un groupe composé alternativement de deux types de personnes :
- d’abord un groupe national qui unit toutes les personnes ayant la même citoyenneté étant le lien de rattachement à un État comme un passeport.
- On a considéré comme un groupe national les minorités nationales : les minorités ont la même nationalité que la majorité, mais on les rattache au groupe national.
Le groupe ethnique a été défini dans la jurisprudence comme un groupe basé sur une langue et une culture commune : on sonde les traditions culturelles et linguistiques. Il faut connaître les réalités socioculturelles, parfois un groupe ethnique est peu de chose. Dans le cas du Rwanda, les Tutsi sont un groupe ethnique selon la jurisprudence, mais ne se distingue pas au niveau de la langue et de la culture de la majorité, c’est une ethnicité qui ressort des papiers.
Les groupes raciaux sont déterminés par la filiation par le croisement des génomes : en 1948, ce qu’on voulait dire de ce critère était fondé sur des caractéristiques physiques et héréditaires.
Les groupes religieux sont selon la jurisprudence des groupes fondés sur les convictions religieuses et une pratique commune. Les convictions religieuses ou les pratiques religieuses sont des convictions ou des pratiques basées sur des croyances spirituelles, mais les limites extérieures d’un idéal spirituel ne sont pas très claires. Ainsi en doctrine on conçoit depuis récemment si un groupe athée peut être conçu comme un groupe religieux.
La définition de ces groupes qui est alternative n’est pas étanche et d’autre part ces catégories sont colorées, empreintes de caractéristiques socioculturelles.
- Se pose une question quant à savoir la définition de ces groupes puisqu’elle fait partie de l’élément constitution objectif ; dès lors, on pourrait poser la question de savoir si ces groupes doivent être définis selon ce que le perpétrateur pense ou alors que le groupe possède les qualités mentionnées de manière objective.
La Cour a tranché et adopté une position mixte de compromis entre le fait que le groupe soit constitué objectivement et la vision subjective selon ce que pense le perpétrateur.
La position intermédiaire consiste à prendre une définition objective comme point de départ, le juge essaie de déterminer si sur le terrain existe quelque chose comme un groupe national, ethnique, racial ou religieux, mais ensuite le juge élargi cette considération objective en prenant en compte des facteurs subjectifs et socioculturels dans la constitution et la perception de ces groupes ;
Parfois des personnes se constituent en groupe parce qu’elles ont une sensation commune fondée ou pas de stigmatisation, parfois des groupes se forment dans la destiné adverse, il y a un facteur subjectif avec la perception d’une solidarité dans une persécution ; de l’autre côté, le juge peut prendre en compte de ce que le perpétrateur pense ou considérait dans quelle mesure le perpétrateur pensait que ce groupe formait un groupe, national, religieux, ou racial.
S’il n’y a pas d’élément objectif, il ne commet qu’une tentative, mais comme il n’y a pas de groupe objectivement constitué il n’y a pas de crime, on essaie de comprendre ce qu’est un groupe en tenant compte des facteurs socioculturels de stigmatisation, les perceptions forment aussi un groupe parce que le groupe perçoit quelque chose en commun.
La question de l’exhaustivité permet de savoirs si on ne commet un génocide contre un groupe national, ethnique, religieux ou racial.
La Cour Pénale Internationale n’a qu’une compétence à propos des crimes couchés dans son statut, elle ne peut connaître d’aucun crime qui ne serait pas prévu dans le droit écrit de son statut selon l’article 22.
La jurisprudence a d’abord flotté, toutefois si on lit l’arrêt Akayesu au tribunal pénal du Rwanda en 1998, le tribunal explique que la liste est exhaustive pour ce qui constitue un groupe, mais la liste n’est pas exhaustive pour ce qui concerne les groupes eux-mêmes.
Selon la Chambre de première instance, les quatre groupes mentionnés dans la Convention contre le génocide et le statut du Tribunal pour le Rwanda, ont des caractéristiques communes, tout groupe contre lequel un génocide est commis devrait avoir une caractéristique commune : le groupe en cause doit être stable et permanent.
Dans l’esprit des rédacteurs de la Convention de 1948, le groupe national se constitue, on voyait l’infamie du crime dans le fait de persécuter et de détruire pour des qualités qu’elle ne peut pas.
La jurisprudence a part la suite abandonnée cette idée parce qu’on pourrait y ajouter d’autres groupes en fonction du fait qu’ils soient stables et durables ; nullum crime sine lege, on ne peut élargir, car cela signifierait qu’on étendrait la responsabilité pénale qui irait au-delà de ce qui est prévisible pour l’auteur de l’infraction.
Il faut rapidement analyser ces différentes entrées ; éthiquement on peut dire qu’elles visent toutes sauf la lettre e l’existence physique ou biologique du groupe.
L’existence physique, si on élimine des membres du groupe, on détruit le groupe, on s’en prend à l’existence physique de personnes déjà existantes en essayant de les détruire.
Il est aussi possible de s’en prendre à la subsistance du groupe dans le temps, on n’élimine pas de personnes qui existent déjà, mais on fait en sorte que le groupe ne se reproduise pas, on s’en prend à l’existence biologique.
En revanche, les rédacteurs de la Convention de 1948, et depuis lors la jurisprudence dans une ligne non brisée, mais linéaire et constante, ont refusé d’élargir la notion de génocide à toute forme de génocide culturel.
Le génocide culturel est tout ce qui concerne la destruction des moyens d’expression du groupe, de l’utilisation de la langue ; cela est thématisé dans la doctrine de génocide culturel, mais juridiquement le génocide culturel ne tombe pas dans l’infraction pénale.
La raison essentielle pourquoi on n’a pas voulu l’insérer dans le crime de génocide est que toute forme de discrimination ne devrait pas être élevée au rang de génocide.
Le meurtre est l’élimination physique des membres du groupe en les tuant, s’il faut entendre un homicide intentionnel et aussi un homicide contraire au droit ; un homicide n’est pas nécessairement contraire au droit comme dans le cas de la légitime défense comme ultima ratio, parfois le droit en fait même le devoir pour les bourreaux dans les systèmes où la peine de mort est appliquée.
L’illégalité n’est pas une condition de trop, il s’agit d’homicides illégaux, le terme homicide est neutre. Le meurtre est connoté juridiquement.
Il faut que le meurtre soit intentionnel ; quand on parle de l’intention en droit pénal cela peut viser plusieurs choses comme le dol direct et le dol éventuel, mais il y a une chose à retenir,l’intention peut être soit directe en agissant directement et intentionnellement.
Il peut arriver que quelqu’un ait du dol éventuel, c’est une intention moins forte, c’est une situation dans laquelle une personne a pensée à ce qu’il pourrait arriver à travers ses actes, ne souhaite pas que cela se passe, mais décide d’agir comme il l’avait prévu, mais accepte les conséquences du résultat de son action. Le dole éventuel suffit – indirect intended - .
L’esprit de la lettre b est d’avoir la création d’une catégorie de « mort-vivant », aliéner le groupe en portant des atteintes graves à son intégrité physique ou mentale comme des actes qui portent atteinte à la santé des membres du groupe même s’ils n’ont pas l’intention immédiate de les tuer, mais on s’en prend à l’intégrité physique du groupe de manière à ce qu’il soit détruit, qu’il soit prostré, que sa viabilité ne soit plus assurée. Des personnes sont parfois mises en condition d’assister au viol, au meurtre de personnes proches.
La lettre c est similaire à la lettre b, il s’agit de moyens de donner la mort indirecte, c’est celui de viser à la mort des personnes par des manières indirectes et plus lentes que dans la lettre a. Les mesures lettre c sont indirectes et insidieuse menant à la mort des personnes. C’est par exemple si des groupes n’ont pas accès à des médecins, si des groupes sont chassés de chez eux, des groupes soumis à un travail excessif, le refus d’accès à de l’hygiène ou à des vêtements minimaux.
La lettre d vise à entraver les naissances au sein du groupe, on ne s’intéresse pas aux personnes qui existent déjà comme entraver la possibilité au groupe de procréer. Il s’agit de toutes mesures coercitives dans lesquelles on s’assure que les naissances dans le groupe ne pourront avoir lieu. Il peut s’agir de la stérilisation, de mutilations sexuelles, du contrôle des naissances, de séparation des sexes.
La jurisprudence mentionne des moyens plus subtils comme l’utilisation traumatique du viol ou encore le cas d’une société dans laquelle la nationalité et l’ethnie, l’appartenance au groupe de l’enfant se détermine selon le père et non pas selon la mère en utilisant massivement le viol pour que les enfants du père soit de l’ethnie du père.
La lettre e a été insérée sur proposition de la Grèce sujette au transfert d’enfants de la Grèce vers d’autres pays, pour avoir cette application il faut que le transfert de ces enfants soit forcé, il n’y a pas de libre consentement et en plus on définit l’enfant comme toute personne qui n’a pas atteint 18 ans.
La politique de l’enfant unique en Chine est-elle un génocide ? Non, car le but de la politique de l’enfant unique n’est pas de détruire en tout ou en partie un groupe national, mais plutôt de faire en sorte qu’il n’explose pas dans toutes les directions ; on ne peut avoir un crime de génocide dans ce sens.
Il en va de même si l’interruption de grossesse est libre puisque l’interruption de grossesse devrait être une interruption forcée.
faut-il la participation d’un État ?[modifier | modifier le wikicode]
- Un État à travers ses fonctionnaires et ses organes commet des génocides ; faut-il la participation d’un État ?
La jurisprudence nous apprend de manière extrêmement claire qu’un tel lien avec un plan ou une politique étatique n’est pas requis comme l’affaire Jelisic au paragraphe 48. Ce n’est pas une nécessité juridique, mais historiquement ce sont des actes perpétrés par des agents étatiques soit par le soutien de ceux-ci.
Si un tel plan ou une politique existe, cela a une certaine incidence, si cela existe cela permet d’étayer l’intention de détruire, car si on a un plan, cela signifie que l’on a réfléchi et il est plus facile de prouver l’intention de détruire.
Mens Rea - intention de commettre une infraction criminelle - est l’élément constitutif subjectif est subdivisé en deux volets en ce qui concerne le génocide :
- intention selon les règles générales tel que prévus à l’article 30 du statut de la CPI : chacun des actes prohibés, lorsqu’il est commis, doit être commis avec intention ce qui comporte l’intention directe, le dole éventuel, en d’autres termes il n’est jamais possible de commettre un génocide par négligence, il n’est pas possible de commettre l’un des cinq actes par négligence.
- dol spécial : intention de détruire en toute ou en partie un groupe. C’est un élément supplémentaire subjectif, non seulement faut-il l’intention, mais en plus à travers cet acte, l’auteur doit avoir une intention de détruire en tout ou en partie ce groupe.
Il y a quelques délits et crimes qui prévoient un tel double élément comme un meurtre avec une intention de discriminer, en allemand on appelle cela Delikte mit überschießender Innentendenz.
Il faut déterminer comment détruire en tout ou en partie un groupe, comment détruit-on un groupe en tout ou en partie ? Quel doit être le résultat ? Suffit-ce seulement l’intention ou un certain résultat ?
C’est la portée de la destruction qui est en cause, il faut d’abord déterminer quel groupe veut-on détruire, même Hitler ne pouvait avoir la prétention folle d’éradiquer les juifs dans tout le monde.
Si on tue tous les juifs d’Allemagne, est-ce que cela suffit de dire si on a détruit en tout ou en partie le groupe ethnique et religieux juif ?
La jurisprudence nous apprend que, pour parler de génocide, il faut la destruction d’une fraction substantielle du groupe, il doit y avoir un certain résultat produit. Selon cette même jurisprudence notamment l’affaire Krstić peut être soit déclinée selon le mode quantitatif soit selon le mode qualitatif.
La manière de voir quantitative de détruire une fraction substantielle du groupe est numérique c’est-à-dire qu’il faut un nombre considérable de victimes.
La manière qualitative de considérer la destruction d’une fraction substantielle du groupe est de considérer que lorsqu’on s’en prend à des fractions particulièrement représentatives du groupe comme ses élites et ses dirigeants, alors on le décapite quelque part.
La jurisprudence reconnait donc qu’on peut faire le travail soit en s’attaquant de front en essayant d’éliminer le plus grand nombre possible de personnes soit aussi qualitativement en visant des personnes choisies pour leurs symboliques dans le groupe.
Le terme en partie renvoi évidemment aussi à des groupes frappés dans une zone géographique limitée, dans l’affaire Krstić, la Cour a répondu par l’affirmative, c’est la seule situation dans l’ex-Yougoslavie ou le génocide a été admis dans le cas de la situation de Tuzla et de Srebrenica, car la cour a admis que les musulmans de Bosnie avaient une valeur symboliquement importante pour que le fait de s’en prendre à ceux-là constitue un génocide. C’est en fonction d’un critère socioculturel de quelle manière elle se considérait elle-même et de quelle manière les autres la considéraient. Cette valeur symbolique a fait en sorte qu’on l’a considéré en groupe en tant que tel.
Les délimitations ne sont pas simples et même dans le génocide, surgissent des questions de grandes difficultés.
Annexes[modifier | modifier le wikicode]
- DOMINICÉ, Christian. L’émergence de l’individu en droit international public In : L’ordre juridique international entre tradition et innovation [en ligne]. Genève : Graduate Institute Publications, 1997 (généré le 31 décembre 2015). Disponible sur Internet : <http://books.openedition.org/iheid/1341>. ISBN : 9782940549214
- Sperduti Giuseppe. La personne humaine et le droit international. In: Annuaire français de droit international, volume 7, 1961. pp. 141-162. Url : http://www.persee.fr/doc/afdi_0066-3085_1961_num_7_1_1081
Références[modifier | modifier le wikicode]
- ↑ Arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme, Irlande c. Royaume-Uni (18 janvier 1978)
- ↑ Aarrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 16 décembre 1997 dans l’affaire Raninen contre la Finlande
- ↑ http://www.unige.ch/droit/collaborateurs/?robert_roth