Nationalismes et décolonisation : 1950 – 1970
La question des liens entre mouvements nationalistes et processus de décolonisation demeure un thème central dans l’historiographie contemporaine. Si les premières aspirations indépendantistes apparaissent dès l’entre-deux-guerres, c’est surtout dans l’après-1945 que le phénomène prend une ampleur décisive, en particulier dans les grands empires coloniaux français et britanniques. La période 1950 – 1970 est ainsi marquée par une accélération sans précédent du démantèlement des structures impériales et par la multiplication de nouveaux États souverains.
Se pose alors la question des origines intellectuelles et politiques de ces nationalismes. Faut-il y voir une exportation directe d’un modèle européen, celui du nationalisme forgé au XIXᵉ siècle et diffusé comme un « produit » idéologique à travers l’expérience coloniale, ou bien une réappropriation créative qui combine influences occidentales et dynamiques locales ? Chaque mouvement indépendantiste s’inscrit dans un univers codifié par le langage du nationalisme moderne, mais les trajectoires divergent : certains visent la construction d’un État-nation sur le modèle européen, d’autres envisagent des fédérations ou des ensembles plus vastes, en Afrique comme en Asie.
Ces choix ne relèvent pas uniquement d’une imitation contrainte, mais répondent aussi à des traditions d’opposition et de résistance enracinées dans des contextes culturels, sociaux et religieux spécifiques. La diversité des compositions ethniques, les mémoires de domination coloniale et les tensions régionales façonnent des nationalismes multiples, qui ne peuvent être réduits à une simple copie du modèle occidental. Comme le rappelle Thiesse, « rien n’est plus international que les mouvements nationalistes » : leur diffusion est globale, mais leur incarnation est toujours singulière.
À l’échelle du système international, l’essor des nationalismes et la décolonisation participent à une véritable recomposition politique mondiale. Le chiffre actuel de 193 États reconnus illustre combien le XXᵉ siècle fut le siècle des indépendances, marqué par la convergence de luttes locales et de dynamiques globales qui ont redessiné la carte politique de la planète.
Emergence des mouvement nationaux[modifier | modifier le wikicode]
Les mouvements nationaux dans les colonies ne surgissent pas brusquement au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Ils s’enracinent dans une histoire plus longue qui trouve des parallèles avec les dynamiques observées dans les empires multinationaux européens du XIXᵉ siècle. Dans l’Empire des Habsbourg, dans l’Empire ottoman ou encore dans celui du Tsar, des peuples soumis cherchaient à obtenir reconnaissance politique, autonomie culturelle, voire indépendance. Le monde colonial connaît un phénomène comparable : un pouvoir impérial impose son autorité sur des populations diverses et suscite en retour des résistances qui s’expriment sous forme de revendications identitaires et politiques.
L’essor de ces mouvements s’explique par plusieurs facteurs. La diffusion des idées politiques européennes au XIXᵉ siècle, transmise par l’école, les missions religieuses, la presse ou les réseaux associatifs, joue un rôle déterminant. De nouvelles élites locales émergent, souvent formées dans les métropoles, qui se réapproprient le langage du nationalisme et de la souveraineté. L’intégration des colonies dans l’économie mondiale provoque par ailleurs des bouleversements sociaux et la formation de classes urbaines et commerçantes plus sensibles aux discours politiques modernes.
Ces mouvements ne sont pourtant pas de simples répliques du modèle européen. Ils s’appuient aussi sur des traditions autochtones de résistance, nourries par les révoltes paysannes, les mouvements religieux et les mémoires d’empires ou de royaumes antérieurs à la conquête coloniale. En Inde, le Congrès national indien articule la référence aux valeurs politiques modernes avec un ancrage culturel et spirituel propre. En Afrique, la variété des traditions politiques et la mosaïque ethnique donnent naissance à des formes de nationalisme multiples et souvent concurrentes.
La dynamique de formation des mouvements nationaux coloniaux repose donc sur une hybridation. Le langage du nationalisme moderne, issu d’un transfert intellectuel venu d’Europe, se combine avec des réalités sociales, culturelles et historiques locales. C’est cette articulation qui explique la diversité des trajectoires et des rythmes de décolonisation observés à travers le monde.
État actuel de la recherche : vers une histoire globale du nationalisme[modifier | modifier le wikicode]
L’étude des nationalismes coloniaux et postcoloniaux s’inscrit aujourd’hui dans un cadre historiographique élargi qui dépasse les approches strictement nationales ou régionales. Les chercheurs tendent de plus en plus à situer le nationalisme dans une histoire globale, attentive aux circulations, aux transferts et aux réappropriations. Ce changement de perspective permet de comprendre pourquoi un phénomène né en Europe au XIXᵉ siècle a pu trouver des échos aussi puissants dans les sociétés colonisées, tout en se transformant au contact de contextes culturels et sociaux radicalement différents.
Dans The History of Nationalism, John Breuilly a contribué à systématiser cette réflexion. Le nationalisme y est envisagé non comme une essence intemporelle, mais comme un objet d’analyse à la croisée de plusieurs dimensions : la religion, qui confère une légitimité transcendante aux revendications politiques ; la langue, qui devient un marqueur identitaire et un outil de mobilisation ; le territoire, qui offre un cadre cohérent à la projection d’un État-nation ; et enfin l’internationalisme, dont le rôle est longtemps resté sous-estimé. La question centrale est de savoir à quel moment et de quelle manière l’internationalisme entre en dialogue avec les nationalismes, non pas pour les nier, mais pour les renforcer, les structurer ou parfois les concurrencer.
Les mouvements de décolonisation montrent bien cette complexité. Le nationalisme indien, en s’appuyant sur des réseaux internationaux d’intellectuels et de militants, a su faire de la lutte anticoloniale une cause universelle. Les indépendantistes vietnamiens ont inscrit leur combat dans une dialectique mondiale, oscillant entre solidarités communistes et affirmation nationale. Dans le cas africain, la création de l’Organisation de l’unité africaine en 1963 illustre l’articulation entre revendications nationales et projet panafricain, où l’internationalisme régional devient le prolongement des luttes nationales.
L’historiographie actuelle tend donc à dépasser la vision d’un nationalisme isolé, confiné à un espace donné, pour le penser comme un phénomène global, constamment nourri d’échanges, d’alliances et de confrontations. Ce regard permet de mieux saisir pourquoi les trajectoires de décolonisation, tout en étant profondément enracinées dans des contextes locaux, participent d’un même mouvement de recomposition politique mondiale.
Problématique[modifier | modifier le wikicode]
L’étude du nationalisme hors d’Europe pose une série de questions fondamentales. Faut-il considérer ce phénomène comme l’exportation d’une idée née dans le cadre européen du XIXᵉ siècle, ou comme le développement autonome de formes politiques et culturelles enracinées dans des contextes locaux ? La diffusion du modèle de l’État-nation, forgé à la suite des révolutions américaine et française puis rapidement adopté en Amérique latine, illustre la force d’attraction d’un format politique perçu comme universel. Mais cette diffusion soulève immédiatement une interrogation : dans les colonies, ce modèle fut-il imposé par les logiques internationales de reconnaissance étatique, ou bien revendiqué et réapproprié comme un instrument d’émancipation ?
Le rapport entre nationalisme et internationalisme constitue une deuxième ligne de questionnement. Les mouvements d’indépendance se développent véritablement au XXᵉ siècle, dans un monde déjà fortement internationalisé par les guerres mondiales, la Société des Nations, puis les Nations unies. Contrairement aux nationalismes européens du XIXᵉ siècle, qui se déployaient dans un cadre d’empires continentaux, les nationalismes anticoloniaux se forment et s’affirment sous le regard d’une communauté internationale en pleine recomposition. Cette dimension globale explique pourquoi les luttes anticoloniales ne peuvent être dissociées de leurs articulations avec d’autres forces transnationales, qu’il s’agisse du communisme, du panafricanisme, du panarabisme ou du mouvement des non-alignés.
Une troisième interrogation concerne les contraintes spécifiques du contexte de la guerre froide. Entre 1947 et les années 1970, les nouveaux États qui accèdent à l’indépendance doivent immédiatement se positionner face à la bipolarisation du système international. Chaque choix souverain en matière politique, économique ou militaire est interprété comme un signal, perçu tantôt comme une affiliation à l’un des blocs, tantôt comme une tentative de maintenir une autonomie stratégique. L’option du non-alignement incarne alors la recherche d’une troisième voie, destinée à échapper à une tutelle néocoloniale tout en affirmant une capacité de décision propre.
Le processus de décolonisation se déploie donc dans un espace contraint, marqué à la fois par l’héritage des modèles étatiques européens et par la structuration d’un ordre international dominé par les blocs. Comprendre ce double mouvement, diffusion d’un modèle et affirmation de trajectoires singulières, est au cœur de la réflexion sur les nationalismes et la décolonisation dans la seconde moitié du XXᵉ siècle.
L’Inde : la marche vers l’indépendance[modifier | modifier le wikicode]
Le mouvement national indien s’inscrit parmi les plus anciens et les plus structurés du monde colonial. Sa genèse remonte à 1885 avec la création à Bombay de l’Indian National Congress, organisation née sous l’impulsion d’une élite urbaine, instruite, anglophone et familiarisée avec la vie administrative de l’empire. Paradoxalement, les autorités britanniques ont encouragé cette institutionnalisation, pensant canaliser les aspirations politiques locales dans un cadre contrôlé. L’Inde n’était pas alors unifiée : on y dénombrait une vingtaine de grandes entités politiques, des centaines de principautés et plus de cent dialectes. L’idée même d’une « Inde » unifiée n’avait pas d’ancrage historique profond. La colonisation, en créant un cadre administratif commun et en intégrant progressivement le territoire à l’empire britannique, a contribué à forger un embryon d’identité collective.
Le statut de l’Inde dans l’empire était singulier. Considérée comme « l’empire dans l’empire », elle relevait directement de la Couronne depuis 1858, la reine Victoria ayant pris le titre d’impératrice des Indes. Le vice-roi, représentant de Londres, gouvernait avec une administration légère, s’appuyant sur les élites locales et préservant une grande hétérogénéité des systèmes de gouvernance traditionnels. Cette forme de domination indirecte a permis à une partie des élites indiennes d’acquérir une expérience politique et administrative qui nourrira ultérieurement les revendications d’autonomie.
Le début du XXᵉ siècle voit se multiplier les clivages internes et les jalons d’un nationalisme différencié. En 1906, la création de la Ligue musulmane à Dacca marque la volonté de distinguer une identité musulmane de la ligne portée par le Congrès, qui se prononce alors pour le svaraj (autonomie). La rivalité entre un nationalisme inclusif, fondé sur l’idée d’unité indienne, et un projet plus communautaire, fondé sur l’appartenance religieuse, s’installe durablement. En parallèle, des figures culturelles comme Rabindranath Tagore, prix Nobel de littérature en 1913, donnent une visibilité internationale à une civilisation indienne capable de rivaliser sur le plan intellectuel et artistique avec l’Occident.
La Première Guerre mondiale constitue une étape décisive. Plus de 1,7 million d’Indiens combattent dans les rangs britanniques, principalement en Mésopotamie, en Palestine et en Afrique orientale. Leur participation nourrit l’attente d’une reconnaissance politique. Mais le Government of India Act de 1919, qui accorde quelques réformes administratives et représentatives, déçoit les espoirs d’autonomie réelle. La répression de manifestations, notamment après le massacre d’Amritsar, radicalise l’opinion.
C’est dans ce contexte que s’impose Gandhi. Fort de son expérience en Afrique du Sud, où il a combattu la discrimination raciale, il devient la figure centrale du Congrès après 1915. Son projet repose sur la non-violence (ahimsa) et la non-coopération. Le boycott des textiles britanniques, combiné à la relance du tissage artisanal indien, n’est pas seulement une stratégie économique : c’est une réflexion sur l’autosuffisance et sur les fondements matériels de la souveraineté. À partir de 1920, le Congrès fait de la désobéissance civile pacifique le cœur de sa stratégie de mobilisation, transformant le mouvement national en une force de masse.
Dans les années 1930, le débat sur l’avenir politique de l’Inde s’intensifie. En 1928, Motilal Nehru propose un statut de dominion, sur le modèle du Canada ou de l’Australie, mais les autorités britanniques rejettent cette option et refusent de reconnaître la pluralité communautaire. En 1930, le poète-philosophe Mohammad Iqbal formule l’idée d’un État musulman séparé, prélude à la création future du Pakistan. Gandhi, de son côté, transfère une partie du leadership à Jawaharlal Nehru, qui incarne une vision moderniste et égalitaire, insistant sur l’abolition des castes et l’unité nationale.
Les élections provinciales de 1937, remportées largement par le Congrès, renforcent sa légitimité, mais soulignent aussi la persistance du clivage avec la Ligue musulmane. La Seconde Guerre mondiale exacerbe cette division : le Congrès critique l’implication de l’Inde dans le conflit sans consultation, tandis que la Ligue musulmane adopte en 1940 la « résolution de Lahore » qui revendique un État musulman indépendant.
À la fin du conflit, le gouvernement travailliste d’Attlee ouvre la voie à l’indépendance. Les négociations entre le Congrès et la Ligue musulmane échouent, rendant inévitable la partition. En 1947, l’Union indienne et le Pakistan deviennent indépendants. L’événement est accompagné de violences massives : plus d’un million de morts et des millions de réfugiés lors des transferts de populations entre les deux États. Jawaharlal Nehru devient le premier ministre de l’Inde indépendante, tandis que Muhammad Ali Jinnah prend la tête du Pakistan.
Le cas indien illustre la complexité des nationalismes coloniaux. Il met en évidence le rôle des élites éduquées dans la diffusion du modèle politique occidental, tout en montrant la puissance des facteurs locaux – diversité culturelle, fractures religieuses, inégalités sociales – dans la configuration du mouvement. L’indépendance indienne apparaît comme le produit d’un long processus, où la référence au modèle de l’État-nation européen s’entrelace avec une dynamique proprement indienne, inscrite dans une histoire de luttes sociales, culturelles et politiques.
Le moment wilsonien : 1918 – 1919[modifier | modifier le wikicode]
À la fin de la Première Guerre mondiale, le discours du président américain Woodrow Wilson confère une nouvelle dimension aux aspirations nationales à travers le principe du « droit des peuples à disposer d’eux-mêmes ». Énoncé dans le cadre des Quatorze Points de janvier 1918 et repris lors des négociations de paix, ce principe se présente comme une promesse universelle, susceptible de transformer la carte du monde. Dans de nombreux territoires colonisés, ce langage résonne comme une légitimation morale et politique de revendications jusque-là marginalisées.
L’impact de ce moment est considérable. Les élites coloniales, souvent familiarisées avec les idées politiques occidentales, perçoivent dans la rhétorique wilsonienne la reconnaissance d’un droit nouveau. Des militants vietnamiens comme Nguyễn Ái Quốc – le futur Hô Chi Minh – se rendent à Paris en 1919 pour soumettre des pétitions aux autorités de la Conférence de la paix. En Égypte, en Inde, en Corée, des manifestations invoquent le droit à l’autodétermination pour justifier la fin de la domination impériale. La promesse wilsonienne agit comme un catalyseur, contribuant à structurer un vocabulaire commun aux nationalismes émergents.
Les limites apparaissent cependant très vite. Wilson lui-même n’envisage pas ce principe comme applicable aux colonies, mais plutôt aux nations européennes issues de l’effondrement des empires allemand, austro-hongrois et ottoman. La priorité donnée à l’Europe et la mise en place du système des mandats de la Société des Nations montrent combien l’application du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes est sélective et contrainte. Les territoires arabes, africains et asiatiques restent soumis à la tutelle des puissances victorieuses, ce qui suscite une profonde désillusion.
Malgré ces restrictions, le moment wilsonien laisse une trace durable. Il alimente les discours des leaders anticoloniaux et inscrit la revendication d’indépendance dans un registre désormais internationalisé. Même si la promesse fut trahie dans l’immédiat, elle contribua à légitimer la cause des nationalismes coloniaux et à leur donner une portée universelle, préparant le terrain pour les mobilisations des décennies suivantes.
Ho Chi Minh[modifier | modifier le wikicode]
La trajectoire d’Hô Chi Minh illustre de manière exemplaire la résonance mondiale du moment wilsonien et la manière dont les élites colonisées ont su mobiliser les opportunités offertes par le contexte international. En 1919, présent à Paris sous le nom de Nguyễn Ái Quốc, il fréquente les cercles nationalistes vietnamiens et contribue à la rédaction d’un manifeste adressé aux autorités de la Conférence de la paix. Le texte s’appuie directement sur le principe wilsonien du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes pour réclamer des réformes politiques, la fin des discriminations et une reconnaissance des droits du peuple vietnamien. L’initiative reste sans réponse, mais elle marque l’entrée du futur dirigeant vietnamien sur la scène politique internationale.
La désillusion face au silence des puissances occidentales oriente Hô Chi Minh vers d’autres horizons idéologiques. Deux ans plus tard, lorsque Lénine réorganise le Komintern et lance un appel aux peuples colonisés pour rejoindre une lutte anti-impérialiste mondiale, le jeune militant y voit une alternative crédible. L’internationalisme communiste offre un cadre d’action qui dépasse les frontières coloniales et propose une solidarité concrète entre peuples dominés. À Paris, Hô Chi Minh s’initie aux doctrines marxistes-léninistes et s’impose progressivement comme un acteur central des réseaux révolutionnaires.
Cette double expérience – l’échec du recours au wilsonisme et l’adhésion à l’internationalisme communiste – structure durablement sa pensée politique. Le nationalisme vietnamien qu’il incarne se nourrit à la fois de références locales (libération nationale, mémoire des révoltes contre la domination chinoise et française) et d’un ancrage international (mouvement communiste mondial). Cette hybridation explique la capacité du futur leader à articuler une lutte d’indépendance enracinée dans le contexte indochinois et un combat idéologique présenté comme partie intégrante de la révolution mondiale.
Autodétermination : l’impact international d’un concept[modifier | modifier le wikicode]
Le principe d’autodétermination connaît une diffusion sans précédent à la fin de la Première Guerre mondiale. Dans son ouvrage The Wilsonian Moment. Self-Determination and the International Origins of Anticolonial Nationalism, Erez Manela montre comment les proclamations du président Wilson résonnèrent bien au-delà de l’Europe et inspirèrent des mobilisations dans différentes parties du monde colonial. Son analyse porte sur quatre régions – l’Égypte, l’Inde, la Chine et la Corée – où émergent simultanément des soulèvements, des revendications et des pétitions invoquant explicitement les Quatorze Points et la promesse wilsonienne. Dans chaque cas, les acteurs nationalistes citent le président américain comme référence morale, et l’idée d’autodétermination devient un langage commun pour formuler des revendications locales.
Manela insiste sur la portée internationale de ce moment. Le discours wilsonien fournit aux élites coloniales un vocabulaire légitime, adossé à la nouvelle diplomatie internationale, pour exprimer leurs aspirations. L’autodétermination devient ainsi un concept opérationnel, capable d’être mobilisé dans des contextes très différents pour exiger des réformes, la reconnaissance d’une identité nationale, voire l’indépendance. En ce sens, 1919 marque une rupture : l’antagonisme colonial ne se joue plus seulement dans l’espace local, il prend place dans une arène internationale où la légitimité du langage politique compte autant que la force des armes.
L’interprétation de Manela a cependant suscité des débats. En se focalisant sur l’onde de choc wilsonienne, il tend à sous-estimer l’existence préalable de traditions locales de résistance et de pensée anticoloniale. L’américano-centrisme de sa perspective donne l’impression que les mouvements nationalistes seraient nés d’une simple réaction au discours d’un président américain, alors qu’ils s’enracinent dans des réalités plus anciennes : révoltes populaires, critiques des élites intellectuelles colonisées, circulation des écrits anti-impérialistes. De même, le rôle du « moment léninien » est souvent minimisé. En 1920, les appels du Komintern aux peuples colonisés ouvrent une autre voie internationale à la lutte anticoloniale, fondée sur la solidarité révolutionnaire et sur l’articulation entre indépendance nationale et combat social.
La notion d’autodétermination doit donc être pensée comme le produit d’une causalité multiple. Le discours wilsonien agit comme un accélérateur et un catalyseur, mais il s’inscrit dans un champ idéologique déjà nourri par des traditions locales de résistance et par l’émergence de contre-discours révolutionnaires. Sa force tient autant à la légitimité qu’il confère qu’aux usages stratégiques qu’en font des acteurs coloniaux capables de l’articuler à leurs propres luttes.
Situation géopolitique : année 1930[modifier | modifier le wikicode]

Au lendemain de la Première Guerre mondiale, la redistribution des territoires coloniaux accentue l’ampleur des empires français et britannique. En vertu des traités de paix, les anciennes colonies allemandes et certains territoires ottomans sont placés sous mandat de la Société des Nations (SDN). La France et le Royaume-Uni deviennent ainsi gestionnaires du Cameroun, du Togo, du Ruanda-Urundi, du Sud-Ouest africain ou encore de vastes territoires au Moyen-Orient, dont la Palestine, la Syrie, le Liban et l’Irak. Officiellement, ces mandats ne sont pas conçus comme une annexion, mais comme une administration provisoire visant à guider les peuples concernés vers l’autonomie. Dans les faits, ils se traduisent par une gestion coloniale classique, mais sous le regard d’une commission internationale chargée de surveiller la « bonne gouvernance » des puissances mandataires.
Ce système de mandats représente un précédent important : pour la première fois, la domination coloniale est relativisée par une instance internationale. Les peuples soumis n’acquièrent pas encore l’indépendance, mais ils obtiennent une reconnaissance implicite de leurs droits à évoluer vers l’autonomie. Le contrôle exercé par la SDN nourrit les espoirs nationalistes, car il introduit l’idée que les puissances coloniales ne peuvent plus agir en toute impunité et qu’une communauté internationale peut se saisir des revendications.
Les années 1920 voient parallèlement la montée en puissance d’une mondialisation des idées politiques. Le siège de la SDN à Genève devient un carrefour où circulent diplomates, journalistes, syndicalistes et militants nationalistes. Cette intensification des échanges favorise la diffusion des discours anticoloniaux. Les élites colonisées, souvent formées en Europe ou en contact avec les réseaux transnationaux, trouvent dans ce nouvel espace international un lieu où articuler leurs revendications. La perspective d’adhésion à la SDN constitue également un horizon mobilisateur : certains territoires dotés de semi-autonomie, comme l’Égypte ou l’Irak, peuvent aspirer à devenir membres de l’organisation, donnant un signal puissant aux autres mouvements indépendantistes.
Cependant, cet élan est progressivement brisé dans les années 1930. La montée des régimes autoritaires et les rivalités entre grandes puissances affaiblissent la SDN et réduisent sa capacité d’action. L’Italie fasciste en Éthiopie, le Japon impérial en Mandchourie ou encore l’Allemagne nazie en Europe centrale démontrent l’impuissance de l’organisation. Dans ce contexte de tensions, les revendications indépendantistes sont marginalisées ou réprimées, car les puissances coloniales privilégient la consolidation de leurs empires face à la menace de la guerre.
L’entre-deux-guerres constitue ainsi une étape paradoxale. D’un côté, les nationalismes coloniaux trouvent dans la SDN et dans la circulation internationale des idées un nouvel espace d’expression et de légitimation. De l’autre, les blocages politiques et les conflits des années 1930 empêchent toute concrétisation immédiate de ces aspirations. Ce n’est qu’après 1945 que les promesses esquissées par le système des mandats et les principes de la SDN trouveront un prolongement effectif dans le processus accéléré de décolonisation.
La décolonisation dans l’après guerre : année 1940 au années 1960[modifier | modifier le wikicode]
La Seconde Guerre mondiale constitue un tournant majeur dans l’histoire de la décolonisation. Le conflit affaiblit profondément les puissances coloniales européennes, économiquement ruinées et militairement dépendantes de l’aide américaine et soviétique. Les empires qui semblaient solides dans l’entre-deux-guerres apparaissent désormais fragiles. Les colonies, mobilisées pour l’effort de guerre en hommes et en ressources, sortent du conflit avec des attentes accrues : participation au combat devait se traduire par des droits nouveaux, voire par l’accès à l’indépendance.
L’Asie fut le premier foyer d’accélération du processus. Dès 1945, l’Indonésie proclame son indépendance, rapidement suivie par le Vietnam, bien que la reconnaissance internationale tarde et que la France tente de rétablir son autorité. La guerre d’Indochine (1946–1954) et la guerre d’Indépendance en Indonésie (1945–1949) illustrent la brutalité des affrontements entre métropoles et mouvements nationalistes. L’Inde et le Pakistan accèdent à l’indépendance en 1947, marquant un jalon essentiel et entraînant une recomposition géopolitique majeure en Asie du Sud. Dans les années 1950, la Birmanie, Ceylan (Sri Lanka), la Malaisie et les Philippines rejoignent à leur tour le camp des États souverains.
L’Afrique entre plus tardivement dans la dynamique, mais la progression est spectaculaire dans les années 1950 et 1960. Le cas algérien, avec une guerre d’indépendance longue et violente (1954–1962), contraste avec le modèle plus négocié adopté en Afrique subsaharienne. La conférence de Bandung (1955), réunissant vingt-neuf États d’Asie et d’Afrique nouvellement indépendants, consacre l’émergence d’une solidarité afro-asiatique et place la décolonisation au cœur des débats internationaux. Dans les années 1960, l’Afrique connaît une vague d’indépendances sans précédent : Ghana (1957), Nigeria (1960), Congo (1960), Sénégal (1960), Côte d’Ivoire (1960), Tanzanie (1961), Kenya (1963), Zambie (1964). En une décennie, la carte politique du continent est bouleversée.
Les institutions internationales jouent un rôle déterminant dans ce processus. La Charte des Nations Unies de 1945, en reprenant le principe de l’autodétermination, confère une légitimité juridique aux revendications nationalistes. L’ONU devient un forum central pour les nouveaux États indépendants, qui y trouvent un espace d’expression et un levier diplomatique. La résolution 1514 de l’Assemblée générale, adoptée en 1960 et qualifiée de « Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et peuples coloniaux », constitue un texte fondateur qui accélère la reconnaissance internationale des nouveaux États.
La guerre froide ajoute une dimension stratégique au processus. Les États-Unis et l’URSS, tout en poursuivant leurs propres intérêts, encouragent la décolonisation pour affaiblir l’influence des anciennes puissances européennes et élargir leurs zones d’influence respectives. Les mouvements nationalistes savent exploiter cette rivalité : certains choisissent une affiliation idéologique claire, d’autres cherchent à maintenir une neutralité en rejoignant le Mouvement des non-alignés, fondé en 1961 à Belgrade.
La décolonisation d’après-guerre ne se réduit pas à un processus uniforme. Certains territoires accèdent pacifiquement à l’indépendance par des négociations, comme l’Inde ou les colonies britanniques d’Afrique. D’autres connaissent des guerres prolongées et violentes, comme l’Algérie, le Kenya ou l’Indochine. D’autres encore restent durablement sous domination coloniale, comme les colonies portugaises (Angola, Mozambique, Guinée-Bissau), qui ne connaîtront leur indépendance qu’au milieu des années 1970.
L’après-1945 marque donc une rupture décisive : en l’espace de deux décennies, le monde passe d’un système dominé par de vastes empires coloniaux à une configuration où des dizaines de nouveaux États-nations redessinent la carte politique mondiale. L’héritage des nationalismes coloniaux, combiné à l’affaiblissement européen et à la polarisation de la guerre froide, explique la rapidité et l’ampleur de cette transformation.
Les étapes de la décolonisation de l’Asie[modifier | modifier le wikicode]

La Seconde Guerre mondiale bouleverse l’équilibre impérial en Asie et ouvre une ère de transformations radicales. L’effondrement momentané des empires coloniaux sous l’occupation japonaise, combiné à l’épuisement des puissances européennes, accélère l’émergence de mouvements nationalistes déjà anciens mais désormais structurés et armés. L’Asie devient dès 1945 le laboratoire de la décolonisation mondiale, inaugurant un processus qui se poursuivra ensuite en Afrique et au Moyen-Orient.
En Indochine, la proclamation de l’indépendance par Hô Chi Minh en septembre 1945 marque une étape décisive. La France, affaiblie par la guerre mais déterminée à préserver son empire, refuse d’accepter cette rupture. Commence alors la guerre d’Indochine, véritable conflit de décolonisation où les nationalistes vietnamiens, structurés autour du Viet Minh, affrontent les forces françaises. La guerre dure près de neuf ans et se conclut en 1954 par la défaite de Dien Bien Phu, qui symbolise l’incapacité d’une puissance coloniale à maintenir par la force sa domination. Les accords de Genève reconnaissent l’indépendance du Vietnam, du Laos et du Cambodge, tout en divisant provisoirement le Vietnam en deux zones, prélude à la guerre américaine. Cette expérience devient un modèle pour d’autres luttes armées : elle prouve qu’une mobilisation nationale, soutenue par l’internationalisme communiste, peut l’emporter contre une grande puissance européenne.
En Indonésie, l’occupation japonaise entre 1942 et 1945 a détruit l’autorité néerlandaise et favorisé la mobilisation nationaliste. Sukarno et Hatta proclament l’indépendance en août 1945, quelques jours après la capitulation japonaise. Les Pays-Bas, refusant cette indépendance, déclenchent une guerre de reconquête qui dure quatre ans. Le conflit, très violent, attire l’attention de l’ONU et de l’opinion internationale, qui exercent une pression croissante sur les Pays-Bas. En 1949, ceux-ci reconnaissent l’indépendance de l’Indonésie. Cet épisode montre que la décolonisation n’est pas seulement le produit de négociations bilatérales mais aussi d’un nouveau contexte international où l’ONU devient un acteur central.
L’Inde constitue un autre foyer majeur. Les années 1930 avaient déjà vu la montée en puissance du Parti du Congrès et de Gandhi, dont la stratégie de non-violence et de désobéissance civile a transformé le nationalisme en un mouvement de masse. La guerre accentue les tensions : l’effort demandé aux Indiens par les Britanniques ne se traduit pas par une promesse claire d’indépendance. En 1947, le gouvernement travailliste d’Attlee choisit de mettre fin à la domination britannique. L’indépendance est proclamée, mais au prix d’une partition entre l’Union indienne et le Pakistan, qui entraîne des déplacements massifs de populations et des massacres à grande échelle. Le cas indien illustre une trajectoire spécifique : l’indépendance est obtenue par la négociation et la pression politique plus que par la guerre, mais elle révèle les fractures communautaires que la colonisation avait contribué à exacerber.
À la suite de l’Inde, d’autres colonies britanniques d’Asie obtiennent rapidement leur indépendance. La Birmanie devient indépendante en 1948, suivie de Ceylan (aujourd’hui Sri Lanka) la même année. La Malaisie, où l’opposition armée communiste avait secoué la domination britannique, accède à l’indépendance en 1957 après une phase de transition. Ces indépendances se caractérisent par une relative négociation, mais elles laissent en héritage des tensions internes profondes, qu’il s’agisse des conflits ethniques au Sri Lanka ou des affrontements politiques en Birmanie.
Aux Philippines, la situation est particulière. Ancienne colonie espagnole passée sous domination américaine après 1898, l’archipel avait obtenu la promesse d’une indépendance progressive. Après avoir été un théâtre central de la guerre du Pacifique, les Philippines deviennent indépendantes en 1946. Le processus illustre la spécificité du modèle américain, qui associe indépendance politique et maintien d’une forte influence économique et militaire.
La situation est plus complexe en Asie du Nord-Est. La Corée, colonie japonaise depuis 1910, est divisée en 1945 entre un Nord soutenu par l’URSS et un Sud soutenu par les États-Unis. Cette partition entraîne la guerre de Corée (1950–1953), qui inscrit la décolonisation coréenne dans la logique de la guerre froide. La Chine, quant à elle, retrouve sa souveraineté après la guerre, mais se trouve immédiatement plongée dans la guerre civile entre nationalistes et communistes, se soldant par la victoire de Mao Zedong en 1949. Taïwan, refuge du gouvernement nationaliste, demeure une question non résolue.
Enfin, il faut rappeler que l’Asie abrite une autre forme d’empire : l’Union soviétique. Les républiques d’Asie centrale, intégrées de force au système soviétique, n’accèdent pas à l’indépendance dans les années 1940–1960. Elles devront attendre la dislocation de l’URSS en 1991 pour devenir des États souverains. Leur cas illustre que la décolonisation asiatique n’est pas un processus homogène : certains peuples obtiennent leur indépendance dès 1945, d’autres presque un demi-siècle plus tard.
La décolonisation de l’Asie révèle une pluralité de trajectoires. Certains États obtiennent leur indépendance par la lutte armée (Vietnam, Indonésie), d’autres par des négociations politiques (Inde, Malaisie, Ceylan), d’autres encore par une transition encadrée (Philippines). La guerre froide ajoute une dimension nouvelle : chaque indépendance est scrutée comme un choix de camp ou comme une tentative de rejoindre la « troisième voie » du non-alignement. Malgré ces différences, le mouvement global est convergent : en l’espace de deux décennies, l’Asie passe du statut de continent dominé à celui d’acteur central du système international.
Les étapes de la décolonisation de l’Afrique[modifier | modifier le wikicode]
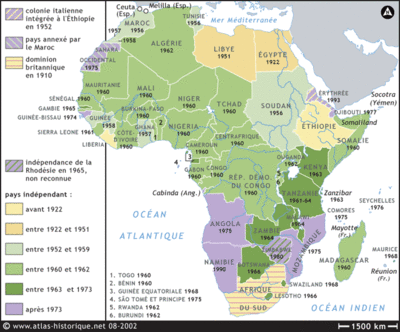
La décolonisation africaine se caractérise par un processus en vagues successives, accéléré par le contexte de l’après-guerre et par la reconfiguration géopolitique liée à la guerre froide. Si certains pays accèdent précocement à l’indépendance, comme l’Égypte en 1922 ou la Libye en 1951, le mouvement prend véritablement son essor dans les années 1950 et culmine avec l’année 1960, souvent qualifiée « d’année des indépendances ». En deux décennies, la carte politique du continent est bouleversée, passant d’une mosaïque de possessions coloniales à un ensemble d’États souverains.
L’Afrique connaît des formes d’émancipation limitées avant même la Seconde Guerre mondiale. L’Égypte, protectorat britannique depuis 1882, obtient son indépendance en 1922, même si la présence militaire britannique se maintient jusqu’aux années 1950. L’Éthiopie, seule grande puissance africaine à avoir résisté à la colonisation, connaît une brève occupation italienne (1936–1941) mais recouvre son indépendance à la faveur de la défaite de l’Axe. La Libye devient indépendante en 1951, sous l’impulsion des Nations unies, marquant la première indépendance issue du système international mis en place après 1945.
Les années 1950 voient l’affirmation des premiers grands leaders africains. Kwame Nkrumah au Ghana, Jomo Kenyatta au Kenya, Sékou Touré en Guinée incarnent l’émergence d’élites politiques africaines capables de transformer les revendications sociales en programmes nationalistes. Le Ghana, ancienne Côte-de-l’Or britannique, devient en 1957 le premier pays d’Afrique subsaharienne à accéder à l’indépendance, inaugurant une dynamique régionale. La Guinée choisit l’indépendance immédiate en 1958 lors du référendum proposé par De Gaulle, marquant une rupture avec le modèle de coopération franco-africaine.
L’année 1960 est un jalon historique : dix-sept pays accèdent à l’indépendance, dont le Nigeria, le Sénégal, le Mali, la Côte d’Ivoire, le Cameroun, le Togo et le Congo. Cette vague reflète la fois la pression nationaliste interne et l’évolution de la politique française, qui, sous De Gaulle, préfère une indépendance encadrée à une confrontation ouverte comme en Indochine ou en Algérie. Le ralliement massif de nouveaux États à l’ONU modifie profondément les équilibres diplomatiques mondiaux et confère une nouvelle légitimité au principe de décolonisation.
L’Algérie occupe une place singulière. Considérée non comme une colonie mais comme partie intégrante du territoire français, elle fut colonisée de peuplement et abritait une importante population européenne. La guerre d’indépendance (1954–1962) oppose le Front de libération nationale (FLN) aux forces françaises, plongeant la métropole dans une crise politique majeure. L’issue, avec les accords d’Évian en 1962, représente un traumatisme pour la France et une victoire symbolique pour les mouvements anticoloniaux du monde entier. L’indépendance algérienne nourrit aussi un nationalisme français renouvelé, en réaction à la perte de l’empire, et contribue indirectement à l’émergence de nouvelles formations politiques, dont le Front national.
Alors que la plupart des colonies britanniques et françaises deviennent indépendantes dans les années 1960, les colonies portugaises restent soumises à une domination coloniale intransigeante. Les guerres d’indépendance en Angola, au Mozambique et en Guinée-Bissau durent plus d’une décennie, mobilisant des guérillas soutenues par les puissances du bloc socialiste. Ce n’est qu’après la Révolution des Œillets de 1974 au Portugal que ces pays accèdent à l’indépendance en 1975.
L’Afrique australe constitue le dernier bastion du colonialisme et de l’apartheid. La Rhodésie du Sud proclame unilatéralement son indépendance en 1965, mais son régime ségrégationniste n’est pas reconnu internationalement et ne s’effondrera qu’en 1980 avec la création du Zimbabwe. La Namibie, administrée par l’Afrique du Sud, n’obtient son indépendance qu’en 1990, et l’apartheid sud-africain ne prend officiellement fin qu’en 1994.
Le processus africain s’inscrit constamment dans la logique de la guerre froide. Les États-Unis et l’URSS cherchent à attirer les nouveaux États dans leur orbite. Certains régimes s’alignent clairement, comme l’Angola ou l’Éthiopie après la révolution de 1974, tandis que d’autres tentent de maintenir une neutralité stratégique en rejoignant le Mouvement des non-alignés. Ce contexte explique à la fois les guerres civiles prolongées (Mozambique, Angola, Congo) et les ingérences extérieures qui marquent la période postcoloniale.
La décolonisation africaine a produit une carte politique nouvelle, mais les conditions dans lesquelles elle s’est opérée – hâte, frontières arbitraires héritées de la colonisation, faiblesse des structures étatiques – ont laissé en héritage des fragilités durables. Néanmoins, ce processus a profondément modifié l’équilibre mondial, transformant l’Afrique en un acteur collectif majeur dans les forums internationaux, notamment à l’ONU, et inscrivant ses luttes dans l’histoire globale de la décolonisation.
La diffusion mondiale de l’État-Nation[modifier | modifier le wikicode]
L’extension planétaire du modèle de l’État-nation constitue l’un des phénomènes majeurs du XXᵉ siècle. En 1914, seuls quelques dizaines d’États souverains existaient, principalement en Europe et en Amérique. En 1970, plus de 130 États siégeaient à l’Organisation des Nations unies, chiffre porté aujourd’hui à près de 200. Cette multiplication n’est pas le simple résultat d’une « exportation » du modèle occidental. Elle relève d’un processus complexe, où le nationalisme s’est diffusé par capillarité, circulations et réappropriations, pour être recomposé dans des contextes culturels, sociaux et politiques variés.
L’État-nation est issu d’un cadre intellectuel européen forgé entre la Révolution française et le XIXᵉ siècle. Il repose sur l’idée que la souveraineté doit s’incarner dans un peuple unifié, partageant une langue, une histoire, une culture et un territoire. Très tôt, ce modèle a été considéré comme universel. Les révolutions d’indépendance en Amérique latine (1808–1825) ont déjà montré la capacité du nationalisme à se diffuser hors d’Europe, en puisant à la fois dans les Lumières et dans des traditions locales de résistance. Mais ce n’est qu’au XXᵉ siècle, dans le contexte de la décolonisation, que le modèle se généralise véritablement.
Il faut toutefois éviter de considérer cette diffusion comme un simple « copier-coller » d’une idée occidentale. Les chercheurs comme Benedict Anderson, Eric Hobsbawm ou Ernest Gellner ont montré que le nationalisme n’est pas une essence intemporelle, mais une construction historique qui s’enracine dans des pratiques sociales concrètes. L’imprimé, la scolarisation, l’administration coloniale, la militarisation et les circulations migratoires ont fourni les supports matériels de cette diffusion. Chaque société colonisée s’est appropriée le nationalisme en l’articulant à ses propres référents : religieux, ethniques, linguistiques ou mémoriels. L’État-nation est devenu à la fois un modèle international de reconnaissance et un instrument local de mobilisation.
La spécificité des nationalismes coloniaux réside dans leur double ancrage. D’un côté, ils empruntent au répertoire international un langage politique – celui de la souveraineté nationale – qui leur permet de se faire entendre dans les arènes internationales. De l’autre, ils puisent dans les traditions locales pour construire une légitimité endogène. En Inde, Gandhi associe les principes modernes de souveraineté au répertoire symbolique du swadeshi et de l’ahimsa. En Afrique, les mobilisations s’appuient autant sur l’héritage des royaumes précoloniaux (Ashanti, Buganda, Kongo) que sur le langage du socialisme africain porté par Nkrumah, Sékou Touré ou Julius Nyerere. Dans le monde arabe, le panarabisme articule le modèle de l’État-nation à l’imaginaire d’une communauté linguistique et culturelle transnationale.
Cette hybridation produit des formes multiples de nationalismes, qui ne peuvent être réduites à une imitation de l’Occident. Loin d’être une idée imposée, l’État-nation devient l’outil à travers lequel les sociétés colonisées traduisent leurs propres aspirations en un langage universellement reconnu.
La diffusion mondiale du nationalisme n’a pas seulement transformé les colonies ; elle a eu un effet profond sur les métropoles elles-mêmes. Les empires européens ont été contraints de confronter la contradiction entre les principes universels qu’ils proclamaient – droits de l’homme, autodétermination, démocratie – et la réalité de la domination coloniale. Les mobilisations anticoloniales ont mis en lumière ce paradoxe et fragilisé la légitimité des empires.
En France, la guerre d’Algérie a profondément déstabilisé la IVᵉ République, conduisant à la chute du régime et au retour de De Gaulle. En Grande-Bretagne, la décolonisation a nourri un débat sur la nature de la puissance britannique et son repositionnement comme puissance atlantique et européenne. Dans le Portugal de Salazar, le refus de céder sur l’empire a contribué à isoler le régime et précipité sa chute en 1974. Les luttes anticoloniales, en forçant les métropoles à se réinventer, montrent que la diffusion de l’État-nation est aussi une histoire « de retour », qui transforme les centres autant que les périphéries.
Le nationalisme doit ainsi être compris comme un phénomène transnational. Les idées circulent par les élites formées dans les métropoles, par les diasporas, par les réseaux militants et religieux, par les conférences internationales comme celles de Bandung (1955) ou de Belgrade (1961). Des figures comme Hô Chi Minh, Gandhi ou Nkrumah ont incarné cette dimension en reliant leurs luttes locales à des causes globales : le communisme, le non-alignement, l’anticolonialisme.
Le concept d’« histoire transnationale » permet de dépasser l’opposition stérile entre « importation » et « développement autonome ». Les nationalismes ne sont pas des copies, ni des inventions totalement endogènes : ils sont le produit d’échanges, de confrontations et de réinventions. L’État-nation est devenu une norme internationale parce qu’il était reconnu comme la seule forme politique légitime par la communauté mondiale, notamment à l’ONU. Mais il a été adopté parce qu’il permettait aux sociétés colonisées d’inscrire leurs luttes dans un cadre à la fois localement signifiant et globalement audible.
Enfin, il faut rappeler que la diffusion du modèle étatique n’a pas mis fin aux tensions. Dans de nombreux cas, la transposition du cadre de l’État-nation sur des sociétés multilingues et multiethniques a généré des conflits, des sécessions ou des guerres civiles (Nigeria, Congo, Inde-Pakistan). Le modèle a triomphé comme format universel, mais sa mise en œuvre a révélé ses limites. C’est aussi ce qui explique l’émergence de projets transnationaux – panafricanisme, panarabisme, mouvements régionalistes – qui ont cherché à compléter ou à dépasser l’État-nation.
Annexes[modifier | modifier le wikicode]
- Jean-Jacques Becker « L'ombre du nationalisme serbe », Vingtième Siècle. Revue d'histoire 1/ 2001 (no 69) , p. 7-29 .
- Foreign Affairs,. (2015). How Europe Conquered the World. Retrieved 8 October 2015, from https://www.foreignaffairs.com/articles/europe/2015-10-07/how-europe-conquered-world